Pontécoulant : "Essai sur la facture instrumentale".
ESSAI
SUR LA
FACTURE INSTRUMENTALE
Considérée dans ses Rapports
AVEC
L’ART L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE
Par
LE COMTE DE PONTÉCOULANT.
PARIS
A LA LIBRAIRIE NOUVELLE,
Boulevard des Italiens.
MDCCCLVII.
PREMIERE PARTIE -
DE LA
FACTURE INSTRUMENTALE
DEPUIS SON ORIGINE JUSQU’EN 1789.
À MON AMI AD. SAX
CHEVALIER. DE LA LÉGION D’HONNEUR ET DE LA COURONNE DE CHÊNE,
PROFESSEUR DE SAXOPHONE
AU CONSERVATOIRE IMPÉRIAL DE MUSIQUE,
FACTEUR-Bté DE LA MAISON MILITAIRE DE L’EMPEREUR,
1re Médaille 1841 (Exp. Belgique), Médaille d’argent 1844 (Exp. France),
Grande Médaille d’or du Mérite 1846 (Prusse), Médaille d’or 1849 (Exp. France)
COUNCIL MEDAL
À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE LONDRES 1851,
GRANDE MÉDAILLE D’HONNEUR
A L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS
Mon cher Adolphe,
C’est à vous que j’offre cet essai, non pas seulement comme un témoignage de mon amitié, mais encore comme un hommage rendu à ce profond sentiment musical, ainsi qu’à cet esprit scrutateur intelligent et inventif, qui vous a fait entreprendre et mener à bien de si beaux et de si nombreux travaux, lesquels vous ont mérité l’honneur d’être choisi par les compositeurs les plus éminents pour organiser et diriger les orchestres de la scène sur nos deux premiers théâtres lyriques.
Ne soyez pas étonné de voir tous vos titres figurer en tête de ce livre : Chacun, d’eux étant le prix d’une victoire et un témoignage irrécusable de la sanction publique donnée à votre talent, ainsi qu’à vos inventions, j’ai cru devoir les rappeler tous dans un ouvrage consacré spécialement à la FACTURE INSTRUMENTALE.
A vous donc mon amitié ; à votre talent mon témoignage.
Le Comte AD. DE PONTÉCOULANT.
Paris, juillet 1857.
PRÉFACE
A une époque où le cercle des connaissances les plus variées s’élargit de jour en jour davantage, il y a des choses qu’il n’est plus permis d’ignorer. C’est donc travailler utilement pour la Facture instrumentale que de lui rappeler son origine, de tracer son histoire, celle de ses travaux, et de constater ses progrès. Par la lecture de ce livre, qui lui fait connaître ce qu’il est et ce qui est, le Facteur pourra marcher d’un pas assuré dans une voie nouvelle, sans crainte de se fourvoyer dans un sentier déjà parcouru.
Quelques ouvrages, contenant des recherches sur certaines parties de la facture, ont été publiés ; on trouve également, éparpillés dans les encyclopédies, quelques articles écrits par des mains habiles et savantes, mais tous sont incomplets ; aucun de ces écrivains ne s’est occupé de l’ensemble de cette belle industrie. Nous avons pensé que la Facture instrumentale méritait moins de dédain et qu’elle était digne, par ses rapports avec l’Art, l’Industrie et le Commerce, d’un travail tout spécial.
Nous nous sommes trouvés arrêté dès nos premiers pas ; nous avons été fort embarrassé dans la division de notre plan : il nous fallait parler de ce qui n’est plus et de ce qui est. Mais, pour nous, où se termine le passé ? où commence le présent ? Quelle époque de l’histoire nous servira de ligne de démarcation entre ce qui est et ce qui fut ? Nous nous sommes enfin décidé à prendre pour limite l’année 1789 ère de la liberté rendue au travail, de la destruction des monopoles, de l’abolition des privilèges. Nous arrêtons à cette grande époque de notre révolution sociale la partie historique de la facture et la description des Instruments anciens ; là se termine naturellement notre première partie.
Reprenant ensuite notre travail, et faisant marcher de front les résumés historiques des progrès de la musique et ceux de la facture instrumentale, nous décrivons les Instruments nouveaux à mesure qu’ils se présentent à l’horizon musical.
Pour ne pas nous égarer dans la marche que nous avons adoptée, nous avons établi des jalons sur notre route. Nous avons pris les années où il y a eu des Expositions industrielles comme autant de haltes où la facture se repose pour prendre un nouvel essor. Ainsi, après 1789, notre première station sera 1806. Ayant de dépasser ces points de repère, nous mentionnerons, pour chaque famille d’instruments, les tendances d’améliorations constatées par les brevets d’invention ou de perfectionnement. Les livrets officiels des Expositions nous permettront de dire avec certitude le nom de ceux qui y ont pris part, de préciser le nombre et la famille des instruments exposés ; enfin, nous joindrons, autant que cela sera possible, l’appréciation du jury aux récompenses distribuées. Nous continuerons ainsi notre travail de station en station, ou d’Exposition en Exposition, sans pouvoir nous égarer, jusqu’à celle de 1855.
Le but de notre ouvrage serait manqué, si nous ne présentions pas au lecteur la preuve matérielle du progrès incessant de la Facture instrumentale. Cette preuve existe dans les documents commerciaux distribués annuellement aux Chambres par M. le Ministre du commerce. Ces tableaux, dont nous donnons le relevé depuis l’année 1827 jusqu’en 1856, établissent, d’une manière irrécusable, que la France, tributaire de l’étranger dans les premières années, a changé de rôle les années suivantes, et s’est par la suite affranchie : c’est elle qui s’est chargée maintenant de fournir à ses voisins ce qu’elle allait jadis leur demander.
Nous faisons suivre ces tableaux commerciaux d’une statistique industrielle sur chaque spécialité de la facture instrumentale, statistique faite par ordre du gouvernement.
Une petite biographie des facteurs anciens et modernes est le complément de notre travail, auquel nous avons joint une série d’éphémérides intéressantes pour 1 ‘histoire de la Facture.
On sera peut-être étonné de la diversité des matières traitées dans cet ouvrage, mais nous avons pensé que tout ce qui touche à la Musique est du domaine de la Facture instrumentale. Pour nous, qui dit Facteur dit un homme d’élite, sachant se servir également bien du compas ou de la lime, maniant et la plume et le rabot, et résumant en lui toutes les connaissances que comporte la science musicale.
Nous n’avons pas la prétention d’avoir fait un ouvrage complet. Nous ne le présentons au public que comme un simple essai. Cet écrit, que nous n’avons fait imprimer qu’à un fort petit nombre d’exemplaires, est, pour ainsi dire le programme de ce que nous voulons faire plus tard. Nous tenons tellement à être vrai et exact, que nous prions tous les lecteurs qui auraient quelques observations à faire ou quelques renseignements à donner, de vouloir bien nous les faire parvenir ; nous serons véritablement heureux de rectifier une erreur, ou de compléter ce qui aurait manqué dans cette édition.
L’AUTEUR,
ESSAI
SUR LA
FACTURE INSTRUMENTALE.
CHAPITRE PREMIER.
INTRODUCTION.
On s’est longtemps mépris sur les véritables conditions de la prospérité des peuples. Des esprits éminents, mais dominés par des préjugés étroits, ont fait consister la puissance des États dans le développement de leurs forces militaires. La prééminence du conquérant sur le législateur, la supériorité de l’esprit guerrier sur le travail pacifique étaient des faits qui semblaient acquis et, acceptés. Le temps et le progrès des lumières ont anéanti cette opinion, dernier vestige des époques de barbarie, et l’on a fini par comprendre que le génie qui produit, féconde et civilise, est au-dessus du génie qui détruit et couvre le sol de débris. La guerre n’est plus considérée comme l’état normal des sociétés, mais comme un accident, une nécessité fatale et une extrémité cruelle à laquelle ou ne doit recourir qu’après avoir épuisé tous les moyens de conciliation possibles. L’activité intellectuelle, l’énergie de la volonté, le travail sous des formes diverses, telles sont les forces du monde actuel.
Les sciences, l’industrie et les arts, dont rien ne comprime plus l’expansion, vivifient tout de leur souffle. Il ne s’agit plus aujourd’hui, pour les États civilisés, de faire de nouvelles conquêtes, mais de tirer parti de leurs richesses naturelles ; de développer leurs productions, de mettre en œuvre et de perfectionner leurs découvertes ; voilà la plus vive préoccupation de notre époque. Le devoir des gouvernements est de seconder cette tendance irrésistible. Il y aurait même pour eux de graves inconvénients et d’immenses périls à laisser sans protection et sans encouragement certaines forces productives qui, toutes faibles qu’elles puissent paraître, n’en concourent pas moins au bien-être général.
Les partisans du laisser-faire n’ont jamais eu nos sympathies. Nous ne comprenons pas un gouvernement qui resterait spectateur impassible des difficultés, des tâtonnements au milieu desquels se débattent quelques branches du travail ; ce serait réduire l’autorité à un rôle bien infime ; ce serait la dépouiller d’un de ses plus beaux privilèges que de lui refuser une action directe sur l’industrie et sur les arts, ces deux éléments les plus essentiels de la vie des peuples.
L’accroissement du bien-être et l’élévation progressive des classes laborieuses ne sont-elles pas la conséquence nécessaire de toutes les industries ? L’adoucissement des mœurs et une plus large expansion de sympathies généreuses ne sont-ils pas le résultat inévitable du perfectionnement des arts ? Comment donc le pouvoir pourrait-il, sans méconnaître sa mission, ne pas se préoccuper de ces deux grandes manifestations de l’activité sociale ?
L’histoire vient donner son passé comme appui à nos assertions. Tous les souverains qui ont laissé des souvenirs et des traces profondes de leur passage sur la terre ne doivent la renommée dont ils jouissent encore qu’à la protection accordée par eux à l’industrie et aux arts.
Pourquoi les noms des Médicis sont-ils parvenus jusqu’à nous, entourés d’un prestige ineffaçable ? C’est qu’ils rendirent Florence heureuse et puissante en y développant tous les arts utiles et agréables, le sentiment du beau, et les jouissances délicates qui naissent de la culture de l’esprit.
Pourquoi la physionomie de Louis XIV rayonne-t-elle d’un si vif éclat dans la postérité? Est-ce à cause des victoires qu’il a gagnées et des provinces qu’il a conquises à la France ? Non. Ce qui a rendu Louis XIV si glorieux, si grand, c’est la renaissance des arts à laquelle il a présidé. C’est à l’essor de l’industrie et du commerce, c’est à cette protection et à cette faveur dont il a comblé la peinture, la poésie et la musique, c’est à ces belles institutions dont deux hommes d’État d’une puissante initiative, Richelieu et Colbert, dotèrent le pays, que Louis XIV doit le rayonnement de sa couronne.
D’où vient que Napoléon 1er reste la plus imposante figure des temps modernes ? Nous le disons sans nulle hésitation, c’est bien moins à ses brillantes conquêtes qu’à son génie organisateur qu’il doit l’auréole resplendissante dont son nom est entouré.
Ce grand monarque, qui appelait dans ses conseils les Cambacérès, les Treillard, les Portalis, provoquait la science des Chaptal, des Fourcroi, des Gay-Lussac, etc., et se plaisait également à interroger les beaux arts dans les personnes de Lebrun, de Bosio, de David et de Le Sueur ; il couvrait de son égide toutes les arts utiles au pays, donnait l’impulsion à toutes les branches du travail national, et ne laissait sans encouragement aucune des tentatives qui avaient pour but l’accroissement de la production sous toutes les formes et le progrès de la richesse publique.
Il nous serait facile de multiplier les exemples ; mais à quoi bon nous efforcer de mettre en relief et en lumière ce qui est évident : Que la force et la stabilité des gouvernements sont en raison directe du mouvement qu’ils savent imprimer à l’industrie et aux arts ? Le développement du travail et, par conséquent, de l’aisance générale, est le plus puissant élément de sécurité et la plus solide garantie de l’ordre public.
Dans les sociétés dont les forces intellectuelles et, physiques reçoivent constamment une utile direction, la marche du pouvoir n’est embarrassée par aucun obstacle ; son action bienfaisante se déploie avec une merveilleuse facilité ; d’immenses ressources sont à sa disposition ; il n’est jamais obligé de recourir à de ruineux expédients ; il trouve dans l’augmentation de ses revenus le moyen de subvenir aux dépenses publiques et il est en mesure de réaliser les plus beaux projets et de mener à fin les entreprises les plus vastes.
Tout s’enchaîne dans l’organisation sociale ; la stabilité des gouvernements, ainsi que la sécurité des individus naissent du bien-être général, qui lui-même est la conséquence de l’essor imprimé à l’industrie et aux arts.
En affirmant que l’autorité doit tout son appui à ces deux grands intérêts, à ces deux forces véritables, nous énonçons donc un principe absolu, et qui ne nous parait susceptible d’aucune restriction.
On aurait tort de prétendre que les encouragements de l’État doivent être réservés exclusivement aux industries prospères et florissantes. Il est juste, il est utile que là munificence officielle s’étende, avec quelque préférence, sur toute industrie faible et inférieure même à celles des Etats voisins, quand cette faiblesse et cette infériorité ne tiennent ni à la nature du sol, ni au génie de la nation. Le devoir des gouvernants est alors de s’efforcer de faire disparaître un état de choses né souvent de circonstances passagères. Ils doivent non-seulement appeler sur ces industries, encore peu développées, l’attention et l’intérêt, mais encourager aussi les associations de capitaux ayant pour but de les exploiter, et accorder des distinctions particulières aux hommes d’initiative qui se dévouent à leur propagation ; ce ne sera pas là une œuvre stérile. Combien n’a-t-on pas vu d’industries, timides et incertaines à leur début, grandir, s’étendre et enrichir un État qui avait d’abord méconnu leur importance ?
Il arrive parfois qu’après avoir été longtemps tributaire d’un peuple voisin pour telle ou telle branche de travail, une nation change de rôle et arrive, par une série de perfectionnements successifs, à une éclatante supériorité. Nous le disons donc sans craindre d’être démenti, aucune industrie, quelle qu’elle soit, ne doit être frappée d’un dédain systématique. La plus chétive concourt, dans une certaine mesure, au bien-être général et apporte son obole au trésor commun. La plus imparfaite est susceptible de progresser. Quand l’enfant marche à peine, qu’il trébuche encore à chaque pas, c’est au chef de la famille qu’il appartient de le protéger, de le guider jusqu’à l’âge de sa virilité et de sa force.
De nos jours, l’industrie, prenant rang comme puissance politique, grandit dans la taille et les proportions de ses ouvrages. Tout inventeur, soit dans les sciences, soit dans les arts, a droit au respect et à la reconnaissance des hommes, quelque minime que soit cette invention, puisque cet inventeur cherche à être utile à ses semblables ; il les appelle à la participation de ce rayon céleste émané de la divine puissance, qui l’éclaire ; car c’est un rayon divin qui frappe son intelligence, qui fait agir son imagination.
Chose digne de remarque, les hommes les plus renommés de leur époque par leurs travaux sont également les plus pieux. Mais, par piété, nous n’entendons pas bigoterie, momerie, mais bien foi, croyance. Il n’y a pas eu de grands hommes athées ; selon nous, l’athéisme n’a jamais existé. Il n’y a pas eu de peuple sans croyance ; et si l’on examine avec attention les doctrines ou les œuvres vraiment grandes, on reconnaîtra qu’elles ont toutes eu des analogies avec les croyances du pays et du temps dans lesquels elles ont paru. On répète souvent que la religion, et la théologie s’opposaient jadis à toutes les découvertes dans les sciences et dans les arts et on les accuse d’avoir été, pendant longtemps, un obstacle à leurs progrès ; cependant la musique a grandi dans les temples ; l’astronomie y a trouvé son berceau. C’est à tort que l’on voudrait séparer la religion des arts et de la science. « L’esprit, dit Mallebranche, devient plus pur, plus lumineux, plus fort, plus étendu à proportion que s’augmente l’union qu’il a avec Dieu, parce que c’est elle qui fait toute sa perfection. » , Francois Bâcon, dans les ouvrages duquel les encyclopédistes du dix-huitième siècle ont, pour ainsi dire, puisé leurs différents arguments contre la religion, a dit lui-même que la religion est l’aromate qui empêche la science de se corrompre. » Les arts libéraux doivent à la religion leur plus beau lustre.
La musique est née dans les Églises, et quand elle disparut à la suite des Barbares, ce fut au Clergé catholique, à saint Ambroise, à saint Grégoire, à Vitellien que l’on dut sa renaissance. A chaque progrès de cet art sublime, on peut accoler le nom d’un prêtre ou d’un moine, véritables régénérateurs de la musique. C’est même au Clergé que la France doit son Académie Impériale de Musique : un cardinal, Richelieu, fit construire la salle ; un cardinal, Mazarin, rassembla les acteurs ; un abbé en fut le directeur ; un organiste de paroisse composa la première musique, et les cathédrales fournirent les chanteurs. Ce fut également un prêtre régulier, Guy d’Arezzo, qui donna à l’Europe cette écriture musicale qui durera sans doute aussi longtemps que l’écriture ordinaire. S’il eût vécu de nos jours, ce Guy d’Arezzo, certaines personnes lui eussent sans doute préféré, comme mérite, un des nombreux fabricants de romances de notre temps. Il y a force gens qui eussent rangé cette sublime idée de notation au nombre des petites inventions ! Il n’y a pas de petite invention ; elles ont toutes une grandeur et une utilité relatives. Nous saisissons l’occasion qui nous est offerte pour en finir avec cette proposition, sur laquelle nous avons entendu tant raisonner ou déraisonner pendant l’Exposition de 1855 ; cette proposition intéresse trop la facture instrumentale pour la laisser passer inaperçue.
Dans les galeries du Palais de Cristal maintes personnes semblaient étonnées de ce que le jury eût accordé le même degré de récompense à la facture instrumentale qu’aux autres branches de l’industrie. Elles disaient, ces personnes, parmi lesquelles se trouvait un compositeur distingué, que le facteur d’instruments était à la musique comme le fabricant de couleurs à la peinture. Pauvres gens ! qui ne font pas de distinction entre l’homme de génie qui imagine, qui invente un instrument, et le manipulateur qui, avec certaines matières, imite les couleurs primitives dont il trouve le type immuable dans la nature, et avec lesquelles le peintre combine les divers tons dont il a besoin. Pauvres gens ! qui n’ont jamais songé à ce qu’il faut de réflexion et de savoir pour reconnaître d’abord la lacune qui existe dans les timbres de tous les instruments composant un orchestre ; puis ensuite ce qu’il faut de génie, de talent et de tâtonnements pour arriver à combler parfaitement cette lacune.
On veut toujours mettre la peinture au-dessus de la musique, cependant on a tort, car la première est un art d’imitation et rien de plus ; la musique, au contraire, est créatrice, elle exprime ce qu’elle sent. La peinture trouve ses modèles dans la nature, le musicien cherche ses mélodies dans son cœur. Un instrument nouveau, qui a sa raison d’être, dont 1’utilité est reconnue, et dont la place est marquée dans l’orchestre dès son apparition, mérite à son auteur, non pas la simple approbation, souvent dédaigneuse, du compositeur, mais sa reconnaissance tout entière ; car, avec cet instrument, son harmonie sera plus complète, ses timbres plus variés ; avec cet instrument, son imagination lui fournira de nouvelles combinaisons dont il obtiendra des effets nouveaux. Demandez à Rossini, à Meyerbeer, à Halévy, s’ils ne sont point du même avis et s’ils ne se sont pas emparés, aussitôt leur apparition, des instruments nouvellement créés, pour obtenir de nouveaux effets. Rossini introduit le cornet à piston dans son Guillaume Tell ; Halévy donne entrée dans son orchestre au mélophone ; Donizetti écrit pour la clarinette-basse de Sax dans Dom Sébastien ; Meyerbeer admet non-seulement le saxophone, cette délicieuse voix nouvelle, mais il demande davantage encore : il prend toutes les familles créées ou perfectionnées par cet habile facteur dont les instruments portent le nom.
Selon le raisonnement de ces personnes, qui discouraient si légèrement, sur la facture instrumentale, celui qui savait faire un bon usage de l’instrument était bien au-dessus de celui qui l’avait inventé. Mais, avec ce système, on élèvera une statue au plus mince romancier, et on rabaissera Guttenberg au niveau d’un simple préparateur de couleurs ; avec ce système, on eût dû donner dans l’industrie lyonnaise la grande médaille d’honneur, au dessinateur de ses riches étoffes, et accorder une simple mention honorable à Jacquart, l’inventeur du métier qui illustre son nom, et sans lequel on n’eut pu exécuter ces dessins. La musique doit souvent à l’inventeur d’un instrument nouveau une grande partie de sa gloire, comme la fabrique lyonnaise la doit à cet ingénieux métier. Le gouvernement ne saurait trop encourager, il l’a bien compris, tous les inventeurs ; il doit, en général, distinction et récompense à l’homme qui, par son génie et ses travaux, a su doter son pays d’une invention utile.
Mais, bien souvent, à la question d’art vient se joindre la question industrielle, et l’amour-propre national se complique d’un intérêt de commerce. Le gouvernement alors, nous l’avons déjà dit, ne doit reculer devant aucune considération, devant aucune dépense, car cette dépense n’est plus une simple avance, c’est une semence féconde, répandue avec la certitude d’une abondante récolte. Avec ce mode d’administrer, on met son pays à la tète des autres gouvernements, on le fait marcher dans le progrès ; il peut se passer des nations voisines et même les forcer de devenir ses tributaires ; c’est de cette manière que l’on parvient à ouvrir une large voie à l’exportation, c’est-à-dire un débouché à la fabrique et au travail.
Le gouvernement de Napoléon III a imité celui de son oncle, qui ne se bornait pas à attendre l’homme de génie dont les œuvres devaient donner au pays un accroissement de richesse. Obligé, par les soins incessants que réclame le gouvernement de son Empire, à lui consacrer tout son temps, il s’est fait remplacer par le premier Prince du sang ; il a voulu être ainsi, par représentation sans cesse au milieu des industriels. C’était au nom de l’Empereur que le prince Napoléon, allant au-devant des découvertes, provoquait celles qui lui semblaient le plus utiles ; accordait des conseils, des encouragements, pour exciter le génie des inventeurs et lui donner l’essor. C’est à cette magnifique initiative que la France sera redevable, nous n’en doutons pas, de plusieurs industries qui feront peut-être sa fortune et sa gloire.
Le gouvernement de Napoléon III a bien compris que cette action tutélaire, si utile dans l’ordre matériel, est, dans l’ordre moral, d’une nécessité indispensable, et qu’elle doit s’appliquer surtout aux arts et aux industries qui ont le sentiment pour principal mobile, et parmi lesquels la musique tient le premier rang.
Tout a été dit sur le rôle civilisateur de la musique ; on sait l’influence prodigieuse qui lui a été attribuée sur les mœurs et les sentiments par l’antiquité : les fictions mythologiques et les témoignages plus graves des historiens s’accordent à constater ses puissants effets. Il y a sans doute beaucoup d’exagération dans les traditions qui sont parvenues jusqu’à nous ; cependant la fable n’est pas toujours aussi absurde qu’elle en a l’apparence ; elle cache souvent un sens profond et sert de supplément à l’histoire. Qu’est-ce donc que le chant des Sirènes ? qu’est-ce que la lyre d’Amphion et celle d’Orphée, si ce n’est la musique grecque dont le magique pouvoir transformait les populations grossières et les initiait aux délicatesses et aux élégances de la civilisation ?
Depuis la Renaissance surtout, la musique a trouvé en Italie et en Allemagne de puissants protecteurs. Il y a quelques années, l’enseignement de cet art était encore, en France, dans un état d’infériorité vraiment pénible ; on regardait cet enseignement comme une superfluité, comme une chose de luxe, et on lui refusait partout les plus chétives allocations budgétaires ; mais, depuis cette époque, un bien grand progrès s’est accompli.
La musique fait maintenant partie de l’éducation ; elle a pénétré dans toutes les écoles ; les sociétés chorales ou d’instrumentistes, organisées sur tous les points de la France, contribuent de plus en plus à en propager les bienfaits.
La musique a un auxiliaire nécessaire et puissant, indispensable même dans la facture instrumentale ; cette industrie a partagé toutes les vicissitudes et participé aux progrès de l’art dont elle est l’expression. Au siècle dernier et au commencement du siècle actuel, cette industrie était encore concentrée dans un petit nombre d’établissements qui suffisaient alors aux besoins très limités de la consommation. La facture des instruments à vent se réveilla la première de la longue torpeur dans laquelle elle végétait, lorsqu’on dut après 1789, pourvoir d’instruments les quatorze armées que la République mit tout à coup sur pied ; il fallut aussi, pour assister aux grandes fêtes de la République et aux revues de la garde nationale, des armes sonores à ce régiment d’instrumentistes improvisés, par le patriotisme de M. Sarette, auquel on doit la création de notre Conservatoire.
Depuis plusieurs années, toutes les autres branches de cette industrie ont pris en France un extension si rapide, qu’un instrument d’une importance secondaire, l’accordéon, présentait au total de ses affaires, pendant l’année 1847, un chiffre dépassant un million !
L’instruction de la musique demandait une production active d’instruments ; il fallait concentrer la fabrique pour les obtenir à un meilleur compte. On a vu alors Erard, Pleyel, Pape, Sax, etc., fonder de grands établissements où toutes les parties de l’instrument se faisaient sous leurs yeux. Par ces grandes innovations dans la facture instrumentale, ils ont favorisé le travail en répandant l’aisance, et ont fait participer, par degré, les classes inférieures de la société aux satisfactions intellectuelles réservées si longtemps à une faible mais riche minorité. Avec l’aide de ces grandes fabriques d’instruments, la musique marche vers de plus hautes destinées ; elle étend et affermit de plus en plus sa domination.
En même temps qu’un mouvement progressif se manifestait dans la consommation, la qualité des produits s’est constamment améliorée. Jadis un instrument bien fait était une exception ; aujourd’hui, c’est tout le contraire. La facture a su faire une heureuse application de quelques découvertes modernes. Anciennement, on était faiseur d’instruments, fabricant de flûtes et de trompettes, comme on était faiseur de coffres, fabricant de chaises ou de casseroles. Le savoir, l’étude la science même sont venus ennoblir ceux à qui la musique doit ses moyens d’exécution, et ces fabricants sont devenus non-seulement facteurs, mais encore artistes ; c’est-à-dire que la science leur a prêté un utile secours, leur a fourni de nouveaux éléments et a agrandi la sphère de leur influence. Une autre circonstance a concouru aussi puissamment au progrès de cette industrie. Quelques facteurs étrangers, hommes de génie, doués d’un mérite incontestable, se sont fixés en France, et ont offert, par leurs talents et leurs travaux, de nouvelles et précieuses ressources.
Malgré ces intelligentes tentatives, la France est encore en arrière de l’Angleterre, sous le rapport de la production du nombre, dans certaines familles d’instruments. C’est au gouvernement qu’il appartient de soutenir, par la création de débouchés nouveaux, cette industrie dont l’essor est déjà si brillant et qui peut accroître, dans de notables proportions, la richesse nationale. Des encouragements honorables sont dus à ces hommes d’initiative, qui, tout en ouvrant de nouvelles sources de travail et de bien-être, créent en même temps des inventions destinées à populariser la musique, cet art qui influe d’une manière si heureuse sur les mœurs d’une nation.
CHAPITRE II.
Les beaux-arts ne contribuent pas seulement à l’amusement d’une nation, ils concourent encore à l’utilité générale en épurant son goût ; ils influent sur tout ce qui fait la félicité de l’homme, lequel leur doit son élévation ; ils développent et perfectionnent la délicatesse des sentiments.
L’on ne saurait assigner aux beaux-arts une origine certaine. Les circonstances, les événements les ont fait naître ; les objets qui avaient quelque rapport et une suite entre eux ont été rassemblés ; les connaissances se sont accrues, les observations se sont accumulées ; de là, il s’est formé des hommes érudits qui ont introduit l’ordre, fondé les principes, et qui ont établi, de tous ces faits divers, des corps d’arts et de sciences, lesquels se sont augmentés par degrés. Ainsi, on pourrait dire que les beaux-arts sont l’ouvrage de tout le monde.
Par son ancienneté, la musique sembles être la première de toutes les sciences ; son invention et celle des instruments sont nées du chant, qui a dû précéder la parole, car l’homme n’apporte en naissant que table rase à l’intelligence, et la pensée, ne lui arrivant que par l’intermédiaire des sens, ne saurait qu’exprimer, par des sons gutturaux monosyllabiques, ses besoins ou ses plaisirs ; et, comme je l’ai déjà dit dans l’introduction à mon Histoire des instruments de musique, « si l’on entend par musique l’émission d’un ou plusieurs sons sans méthode, la musique est aussi ancienne que l’homme, car il eut des sensations dès qu’il respira ; son premier cri, ce premier son émis, fut l’expression de ce qu’il sentait. La méthode se trouve également innée dans l’homme ; dès sa plus tendre enfance, sa voix a des sons de plaisir et de douleur, de colère et de tendresse ; les sons inarticulés, espèce de musique naturelle, se développent peu à peu et peignent, d’une manière certaine, quoique grossière, toutes les différentes sensations de son âme, soit de peine ou de bonheur, soit de crainte ou d’audace. Ainsi, la voix du premier homme produisit le premier chant, et, sans doute, le battement de ses mains fut son premier instrument.
La musique a du être la première langue et là seule universelle, comprise de tous, sans étude, sans traduction langue si naturelle, que tous ont essayé de la parler ; si simple, si accessible qu’elle se contente de prendre ses mots dans la nature qui résonne et ne reçoit son expression que du cœur.
La musique, si vénérée dans l’antiquité, parce que, de tous les arts, elle est celui qui a le plus d’action immédiate et communicative sur l’homme, ne fut regardée, dans les siècles suivants, que comme un art futile ; mais, au dix-neuvième siècle, elle a été reconnue aussi utile et aussi nécessaire que les autres arts, parce que, dans la nature, tous sont rangés dans un ordre tel que l’on ne peut se passer d’aucun.
Depuis bientôt dix-huit ans nous nous occupons d’un grand travail sur la facture instrumentale ; nous avons entrepris de tracer l’histoire des instruments de musique depuis l’enfance de l’art, et de la continuer jusqu’à notre époque, en décrivant la nature de ces instruments et leurs formes variées. On trouve bien la description de divers instruments dans quelques vieux auteurs, tels que les traités de Virdung, d’Agricola, de Prætorius, du P. Mersenne, de Laborde, etc., etc. ; mais leurs descriptions sont souvent incomplètes et leurs dessins imaginaires ; le même nom ne signifie pas toujours le même instrument, et s’il faut avoir recours, soit aux poëtes, soit aux historiens, pour résoudre le doute dans lequel on peut se trouver, l’embarras devient encore plus grand. Nous citerons ici les paroles de M. Kastner, chercheur infatigable, auquel nous devons déjà le beau Manuel de Musique militaire, qui, sous ce titre modeste, renferme une histoire complète de cette partie de la science, de savantes dissertations sur les Danses des Morts, de remarquables études sur la Harpe d’Éole, et qui nous promet encore tant d’autres précieuses recherches sur l’art musical :
« Au nombre des causes qui ont contribué à rendre les documents que l’on consulte extrêmement suspects sous le rapport de l’exactitude et de la vérité, il faut signaler la légèreté des écrivains, et surtout des poëtes, aussi bien que la négligence des peintres, des sculpteurs et des statuaires. C’est pourtant à eux que s’adressent d’ordinaire ceux qui veulent plonger leurs regards dans le passé pour en connaître les mœurs et les usages. Le peu qu’on a tracé de l’histoire des instruments est en partie basé sur les indications qu’ils ont fournies.
« ..... De tous les écrivains qui ont traité des antiquités de l’art, Prætorius passe, à juste titre, pour avoir été, un des plus exacts, et cependant que de choses il nous laisse ignorer, que d’anciens documents nous révèlent ! Nous ne saurions pas les noms d’une foule d’instruments employés par les ménestrels et les jongleurs, si des passages de romans, de fabliaux et d’autres pièces ne les avaient fait connaître. Nous ne serions pas mieux renseignés sur les formes données aux instruments à cette époque, si nous n’en avions trouvé des représentations dans les vignettes de vieux manuscrits, dans les gravures des anciens imprimés, dans les sujets de peintures murales, dans les détails d’ornementation des édifices religieux, dans les compositions des vitraux d’églises, enfin dans des tableaux placés à l’intérieur des temples et des couvents.
« Malheureusement ces témoignages n’ont pu fournir que des données incomplètes et souvent même de simples conjectures. Le vague et l’incertitude qu’ils laissent dans l’esprit autorisent les interprétations les plus contradictoires, et l’on peut présumer que, parmi les suppositions auxquelles ils ont donné lieu, les erreurs ne manquent pas. Il en devait être ainsi : ces témoignages n’émanaient pas d’hommes compétents et intéressés, par leur profession ou par la nature de leurs études, à se montrer exacts et bien renseignés sur tout ce qui avait trait à l’art musical ; quelquefois même ils étaient donnés par des ignorants ou des indifférents. Cet inconvénient est inhérent, en général, aux sources qui proviennent de l’antiquité.
« Voici pourquoi : les poëtes, dans leurs citations, sont sujets à réunir et à confondre des choses qui n’ont aucun rapport entre elles, ou bien à les présenter à une place ou sous un point de vue qui en donne une idée tout à fait fausse ; de là des contresens inévitables. Tantôt, chez eux, ce n’est qu’une inadvertance passagère ; tantôt c’est un manque de connaissances fondamentales dans la matière traitée ; mais, le plus souvent, ce sont des concessions faites à la rime ou à l’harmonie du style. Comme on cherche dans les productions de la muse, non la précision scientifique, mais le brillant de l’inspiration, on ne relève ni ne blâme de telles inexactitudes. C’est un tort cependant, car elles ont dans la suite de fâcheux résultats. Il arrive une époque, en effet, ou le livre, oublié des littérateurs à cause de son ancienneté est, à cause de cette ancienneté même, recherché par les archéologues ; ce livre, dans l’opinion des érudits, devient un titre précieux, un document historique. Un mot qu’on y remarque, parce qu’il se trouve amené et placé de telle sorte qu’il parait avoir un sens conforme à l’opinion, que l’on s’est faite (à priori), acquiert la valeur d’un renseignement certain, d’un argument en règle, d’une preuve positive, incontestable. Et pourtant ce mot, que le poëte a pu mettre là au hasard et souvent à la place du terme propre qui lui manquait, signifie peut-être tout autre chose, en réalité, que ce qu’on veut y voir. Indépendamment des noms faussement appliqués à certains objets, il y a les anachronismes, et, indépendamment des anachronismes, les expressions figurées de la langue poétique, lesquelles peuvent donner lieu aux plus plaisantes méprises ; il y a enfin les fautes et les étourderies des poëtes eux-mêmes, celles des copistes et des traducteurs. Si un instrument se trouve mentionné dans un livre, il n’est pas dit pour cela que cet instrument ait été encore en usage dans le temps où le livre parut. Je me figure, ajoute M- Kastner, quelque musicien des temps à venir, étudiant les antiquités de son art et prenant au pied de la lettre certaines expressions consacrées par nos poëtes ; par exemple, ces vers de Lamartine
« Et cédant sans combattre au souffle qui m’inspire,
« L’hymne de la raison s’élance de ma lyre. »
Ou bien
« Heureux le poëte insensible,
« Son luth n’est point baigné de pleurs. »
« Ou bien encore
« Quelquefois seulement, quand mon âme oppressée
«Sent en rythmes nombreux déborder ma pensée,
« Au souffle inspirateur du soir, dans les déserts,
« Ma lyre abandonnée exhale encor des vers.»
« S’il n’est suffisamment instruit, ces divers passages ne manqueront pas de lui faire supposer : 1°, que les poëtes du dix-neuvième siècle étaient de grands musiciens, et que, à l’exemple des rapsodes de la Grèce et des ménestrels du moyen âge, ils chantaient leurs poëmes en s’accompagnant d’un instrument ; 2° que le luth et la lyre leur étaient familiers ; 3°, que ces instruments étaient encore d’un usage général vers le milieu du dix-neuvième siècle, puisqu’ils sont mentionnés par les poëtes de cette époque. Si le hasard veut, après cela, qu’il ait occasion d’examiner des images satiriques ou des monuments sérieux, tableaux, statues, dans lesquels l’artiste ait appliqué à un personnage des temps modernes les traditions iconologiques de l’antiquité ; s’il voit, par exemple, un grand poëte tel que Goëthe, un grand musicien tel que Mozart, représentés tenant en main la lyre, il sera plus que jamais persuadé que la lyre était un instrument cher aux poëtes et aux musiciens du dix-neuvième siècle ; que cet instrument avait même encore, dans ces temps-là, la forme que lui donnaient les anciens Grecs. On va sans doute objecter, qu’il faudrait être plus qu’un ignorant pour commettre de telles balourdises. Mon Dieu ! qui nous dit que nos érudits d’aujourd’hui, en interrogeant le passé, ne soient pas exposés à en commettre tous les jours de semblables !.... »
Nous cessons ici cette longue citation de M. Kastner, auquel nous serons forcé de faire souvent des emprunts ; mais nous y sommes autorisés ; il est si riche, qu’il peut prodiguer ses bienfaits sans crainte de s’appauvrir. Nous terminerons ce paragraphe en signalant, comme preuve des erreurs dans lesquelles peuvent nous entraîner les auteurs anciens, les erreurs des écrivains modernes. Un ouvrage contemporain, l’Encyclopédie méthodique, définit le SISTRE égyptien instrument à cordes, et M. de Villeneuve, dans la traduction de Virgile, qui fait partie de la collection des classiques latins de Panckouke, dit également dans une note, et cela après les travaux de la commission d’Égypte, après le bel ouvrage de Villoteau sur la musique de ce peuple : Le Sistre égyptien était une harpe à quatre cordes. Croira-t-on alors qu’il soit bien facile de découvrir la vérité au milieu de tous ces dires erronés on contradictoires ? Aussi, l’écrivain consciencieux ne marche qu’à tâtons, et il lui faut bien assurer son dernier pas avant d’essayer d’en entreprendre un autre. Voilà ce qui fait que notre grand ouvrage sur les instruments commencé depuis si longtemps, est loin encore d’arriver à sa fin.
Si, de temps à autre, au milieu de nos recherches, nous avons en le bonheur de rencontrer une faible lumière qui nous éclairait sur telle ou telle série d’instruments, nous n’avons jamais rien trouvé qui eut rapport aux facteurs ; si beaucoup d’écrivains ont parlé des produits, aucun ne s’est occupé du producteur. Semblables aux gourmets qui dégustent la truffe, qui savourent avec délices sa chair parfumée sans s’inquiéter d’où lui viennent son arôme et sa saveur, le musicien et le poëte ont usé des instruments sans s’occuper de ces hommes de génie qui les avaient imaginés, ou des habiles ouvriers qui les avaient construits. Cet oubli, disons plus, cette injustice, nous chercherons à la réparer ; et nous réunirons tous nos efforts pour faire jaillir quelques lumières sur ces hommes intelligents auxquels nous devons nos jouissances les plus pures et la perfectibilité de nos sentiments ; car la musique est la voie invisible qui conduit dans le monde supérieur de l’intelligence, monde qui embrasse l’homme, mais que l’homme ne saurait saisir. Dans les autres arts, la nature prend un corps ; dans la musique, loin de se matérialiser, la nature, pour se rendre accessible aux sens, les excite et les spiritualise en quelque sorte pour en être sentie. La musique est tributaire de l’industrie, à laquelle elle demande des instruments simples et grossiers chez les peuples dans l’enfance, délicats et puissants chez les peuples policés.
Longtemps avant que le premier instrument ne fût imaginé, la nature, par l’ébranlement ou le froissement de l’air, avait produit des sons où se dessinaient déjà les premiers accents d’une large et belle harmonie. L’homme, venu plus tard, a pris les combinaisons de la nature à l’état d’imperfection où elle les avait laissées. L’expérience de tous les instants lui ayant bientôt appris que l’air est le principal véhicule du son, il s’est emparé de cette découverte, et il en a tiré un parti admirable. Il a imaginé mille moyens, les uns d’une grande simplicité, les autres d’une science profonde, pour agir sur le médium atmosphérique et en tirer les effets harmoniques les plus riches et les plus variés. De là ces instruments si nombreux, si diversifiés, qu’il s’est complu à créer à toutes les époques de son développement intellectuel et de son existence sociale ; de là ces grossières inventions qui charment les loisirs du sauvage, et ces chefs-d’œuvre de mécanisme qui remplissent aujourd’hui nos orchestres. Dans l’ordre de progression des idées intellectuelles, ordre qui marche toujours du simple au composé, le premier des instruments fût sans doute la flûte, car les instruments à vent durent précéder les instruments à cordes. Combien de droits n’a-t-il pas à notre reconnaissance celui qui, le premier, tailla un roseau et qui, à force d’essais et de raisonnement, en fit un instrument imitant et la voix de l’homme et le chant des oiseaux ! Mais voyez l’ingratitude humaine : le nom de cet homme de génie n’est pas même parvenu jusqu’à nous ; et pourtant son invention a causé tant de jouissances, que sa mémoire méritait d’être conservée d’âge en âge. Il en est ainsi de l’humanité : son histoire vous dira le nom de tous ses tyrans, et vous conservera avec peine celui d’un de ses bienfaiteurs.
D’où vient l’ascendant impérieux que la musique exerce sur l’homme ? Par quelle force donne-t-elle à l’âme ce léger mouvement qui la réveille, ces secousses violentes qui l’ébranlent, ou ces atteintes terribles et profondes qui la pénètrent ? Chacun sait combien les affections de l’âme influent sur l’habitude physique du corps. La douleur, le plaisir et toutes les passions qui en dérivent se rendent visibles par les altérations que les organes éprouvent. Ces impressions sont-elles profondes, constantes ? les altérations subsistent, et c’est ainsi que l’homme, bon ou méchant, offre dans ses traits l’empreinte de son âme ; elle se peint également dans les accents de sa voix.
Qu’est-ce donc que la musique ? C’est l’art, dit-on, de lier les sons selon des lois prescrites ; le son c’est donc la matière musicale toute brute ; pas de son, pas de musique. Le son n’est point un corps ou un être matériel, mais seulement une propriété d’autres corps, notamment de l’air, qui le transmet sous l’influence des agents par lesquels il entre en vibration. Le son, semblable à la beauté, n’est pas plus dans le corps sonore que celle-ci n’est dans les objets. L’un et l’autre existent dans le cœur ou l’imagination. Le son, selon les physiciens, résulte du choc des corps élastiques ; il est le résultat d’une série de vibrations régulières et décroissantes des corps ou de leurs parties ; vibrations qui opèrent dans l’air une série de vibrations analogues. Le bruit, au contraire, résulte du choc des corps non élastiques ; il est le produit d’un ou plusieurs chocs qui ne se répètent pas par vibrations. L’ébranlement ou la vibration de la matière fluide, interposée entre le corps choqué et notre organe, opère sur notre nerf auditif une sensation qui se trouve à l’instant même traduite par notre âme ou notre sentiment. Les nuances des sons varient à l’infini, comme les vibrations qui les produisent, et l’on nomme intervalle le rapport d’un son à un autre.
Le simple déplacement d’an corps entier ne produit pas le son. Il ne faut pas non plus confondre le mouvement d’oscillation avec celui de vibration. Le premier n’est que le va-et-vient d’un corps mu en masse, sans changement de forme ; le second, au contraire, n’a jamais lieu sans que la forme soit changée. Ainsi, lorsque l’on sonne une cloche, pendant un seul mouvement d’oscillation il s’en fait un grand nombre de vibrations ; c’est-à-dire que des deux diamètres de la cloche, l’un correspondant au trajet du battement et l’autre perpendiculaire à ce trajet, l’un s’allonge pendant que l’autre se raccourcit, et cela alternativement, avec une grande rapidité.
Lorsque les vibrations se succèdent assez rapidement pour avoir lieu au moins trente-deux fois dans la durée d’une seconde, le son devient appréciable, c’est-à-dire qu’on. peut le comparer à un degré connu de l’échelle des tons. Avec moins de fréquence les vibrations ne produisent que du bruit.
La gravité ou l’acuité du son dépend du moins ou du plus grand nombre de vibrations dans un temps donné.
La fréquence des vibrations est, dans les instruments à cordes, en raison directe de la tension des cordes, et en raison inverse de la grosseur et de la longueur des cordes ; il en est de même dans les instruments où l’on emploie la peau comme corps sonore. Dans les instruments à vent, elle dépend de la plus ou moins grande longueur du tuyau, et dans les corps métalliques ou de verre, de toutes les dimensions ainsi que de la nature de la matière.
L’octave aiguë d’un son est formée du double des vibrations dans le même temps. Le son le plus grave que l’on ait pu apprécier est celui qui donne 32 vibrations par seconde : ce son est l’ut d’un tuyau ouvert de trente-deux pieds ; sa première octave donne 64 vibrations dans le même espace : c’est l’ut d’un tuyau ouvert de seize pieds ; la deuxième octave donne 128 vibrations : c’est l’ut du violoncelle ; enfin, en doublant toujours, on arrive à la huitième octave dont le nombre des vibrations, dans une seconde, est de 8,192. Passé ce terme, il n’y a plus guère de sons appréciables, et ils sont généralement peu désagréables.
Si le son rencontre un corps capable de vibrer à son unisson, il le met en mouvement avec beaucoup de facilité. La force du son dépend du nombre des rayons sonores ; le nombre des rayons sonores dépend de l’étendue des surfaces vibrantes, de l’étendue des vibrations et de la surface de l’air. Les rayons sonores s’écartent les uns des autres en raison directe double du carré des distances ; par conséquent, la force du son diminue dans la même proportion.
Une partie du plaisir que nous causent l’harmonie et la mélodie vient de la nature des sons dont elles sont formées. Certains sons inarticulés, surtout s’ils sont soutenus, font une impression agréable sur l’âme ; ils semblent l’enlever aux plus pressants intérêts de la vie et la pénétrer sans trouble d’un torrent d’idées touchantes qui bercent et assoupissent souvent ses facultés ; d’autres fois ils aiguillonnent notre sensibilité et excitent notre imagination ; il n’est donc pas aussi absurde que quelques médecins le supposent, de leur reconnaître une force capable d’agir sur le corps mécaniquement. Si dans une église on sent trembler le parquet et les bancs à certains sons de l’orgue ; si de deux cordes semblables, 1’une rend le même son que celle qui est pincée ; si une personne qui éternue, ou qui chante près d’un piano ou d’une harpe, entend les cordes murmurer les mêmes tons, il n’y a certes rien d’étonnant à ce que les fibres les plus, sensibles de l’organisation humaine éprouvent un frémissement quand elles se trouvent à l’unisson des tons produits par des objets extérieurs.
Les modifications que les organes éprouvent dans les passions violentes influent aussi nécessairement sur la qualité des sons et sur leur rapport entre eux. Nous venons de dire qu’ils sont d’autant plus aigus qu’ils sont produits dans des tuyaux ou par des cordes de moindre dimension. Cet effet doit avoir lieu dans les impressions subites : la contraction que subissent les muscles raccourcit les conduits de la voix et rétrécit leur calibre. L’air, violemment chassé, par ce double effet, s’en échappe avec force, et de là proviennent ces cris aigus et perçants, qu’arrachent la douleur, la joie et toutes les impressions vives et rapides.
Bientôt les organes reviennent à leurs dimensions, naturelles par des mouvements non moins précipités ; l’alternative de leurs oscillations modifie successivement les sons de l’aigu au grave et du grave à l’aigu. Tel doit être et tel est en effet le caractère des gémissements auxquels succèdent les soupirs et le silence enfin, lorsque le mouvement oscillatoire est entièrement affaibli.
D’après ce court exposé et la manière dont les qualités des sons se trouvent liées aux affections de l’âme, on conclura aisément que l’accent, les cris et les gestes de l’homme ont dû être son langage primitif, résultat nécessaire et le plus simple de son organisation, le seul qui peut être, entendu de tous les peuples et dans tous les lieux, parce qu’il est seul indépendant des conventions.
Cependant l’homme en société dut bientôt sentir se développer en lui des passions inconnues à l’homme de la nature. Les cris, qui n’étaient que des signes incertains de son plaisir ou de sa douleur, furent insuffisants pour exprimer les mouvements de son âme. Il fallut ajouter à ces caractères vagues, indécis, le concours d’un art que les premiers besoins de la société avait fait éclore, et l’homme, joignant au geste et aux accents le secours de la parole, parvint à rendre avec clarté et précision toutes les nuances du sentiment qu’il éprouvait.
Mais alors, ambitieux qu’il était déjà, l’homme ne fut pas encore satisfait. Ses semblables existant autour de lui ne le contentèrent plus. il lui fallut davantage ; sa vue s’agrandit, et il osa envisager l’avenir. La gloire fit tressaillir son cœur ; il sentit la nécessité de consacrer à la reconnaissance des siècles futurs les bienfaiteurs des sociétés naissantes. L’écriture et la poésie naquirent de ce besoin ; aidant la mémoire, elles fixèrent la tradition. La fidélité en fut garantie par la difficulté de changer les expressions sans s’exposer à rompre la mesure et la cadence. Ce fut là le premier pas vers la musique. Dans une langue imparfaite encore, il ne fallut que l’enthousiasme de la déclamation pour ajouter au mouvement du mètre ce qui lui manquait afin de devenir un chant véritable. Si les poëtes furent les premiers historiens ; ils furent également les premiers musiciens. La musique leur dut longtemps l’empire qu’elle exerça sur les organes grossiers des peuples encore sauvages.
Le cœur aime à voir chez les sociétés dans l’enfance la reconnaissance élever les premiers autels. Aussi les premiers sons de la musique furent des hymnes aux Dieux, c’est-à-dire le récit enthousiaste des actions qui leur valurent l’apothéose. La sculpture, dans son enfance, modela les héros que la poésie et la musique avaient voués à la reconnaissance et à l’admiration. Ce ne fut que dans la société perfectionnée que la musique prostitua ses chants, l’a poésie ses vers, et la sculpture son ciseau.
La musique se contenta donc, à sa naissance, d’embellir de ses accents le récit des actions héroïques. Ses premiers sons furent d’abord simples et grossiers, comme les héros dont elle chanta les bienfaits. Pour bien comprendre combien un art petit différer de lui-même, il suffit de comparer, par la pensée, la musique actuelle avec celle des premiers temps. Alors elle ne connaissait d’autres liens que ceux du mètre auquel elle était assujettie, et elle n’avait sans doute d’autre génie que celui de la langue ou de la poésie des sociétés encore au berceau.
Le souffle des vents se jouant dans les roseaux rendit des sons qui donnèrent la première idée de la flûte ou du chalumeau, et puis, à un morceau de roseau on en ajouta un second plus long on plus court, et puis un troisième, et, ainsi de suite, on construisit la flûte de Pan ou syringe. Cette invention dut occasionner nécessairement des révolutions dans la musique. Cette flûte, composée de tuyaux ayant des longueurs inégales, dont le nombre fut limité pour la commodité de l’instrument, à peine formée, il fallut en diviser la portée, réglée sur l’étendue moyenne de la voix, par le nombre de tuyaux dont on jugea convenable de le former. Bientôt la nécessité d’accorder ces instruments obligea d’en fixer les dimensions : dès lors le rapport des sons entre eux fut déterminé d’une manière invariable. Jusqu’alors, la, musique ou le chant s’était transmis ou propagé par simple imitation. Conçu, pour ainsi dire, par la simple intuition, on n’avait pas songé à le décomposer dans les sons particuliers qui le forment. Le fils avait suivi les inflexions de la voix de son père, sans s’inquiéter des intervalles, qui n’existaient pas encore.
Nous ne pouvons, il est vrai, déterminer avec certitude ce qui fixa les premières conventions ; cependant nous sommes loin d’en conclure qu’elles furent réglées par la nature. Toute quantité ou qualité n’a d’abord d’autre mesure qu’elle-même : elle est unité, parce qu’elle produit en nous une sensation unique. Il faut s’être d’abord formé des unités particulières pour les retrouver dans la grandeur, et alors le nombre remplace l’étendue. Dans une dimension de six mètres, par exemple, on ne voit plus que six points distincts ; tout le reste a disparu, et l’on n’a perception que du nombre six. Il en est ainsi à l’égard des sons successifs ou simultanée ; l’on n’en évalue les différences qu’après avoir préalablement établi les rapports qui doivent les mesurer ; mais aussi tous les intermédiaires s’évanouissent, et l’oreille n’a conscience que des sons élémentaires qu’elle a choisis pour unités. C’est l’application de l’arithmétique à la géométrie, péchant toujours par excès ou par défaut, et nécessairement forcé de s’en tenir à des approximations. Toute unité servant de mesure est nécessairement arbitraire. Tout ce qui fait sensation est l’unité de la nature ; mais où est le rapport de chaque organe avec cette unité élémentaire ? En un mot, les nuances des sons suivent les rapports de l’étendue. Chaque longueur d’une même corde, d’un même tuyau, doit donner et donne un son correspondant.
Trop fugitifs pour pouvoir être comparés entre eux, les sons auront donc été réglés sur les dimensions des corps sonores, c’est-à-dire sur des rapports d’étendue, où l’unité reste toujours arbitraire.
Tous les peuples musiciens doivent avoir eu leur échelle : rendre leurs chants par les signes que nous avons adoptés, c’est opérer la réduction d’une mesure dans une autre, en négligeant nécessairement les fractions au-dessous de l’unité de la plus petite espèce.
Ce n’est pas une idée aussi simple qu’on pourrait le supposer, que celle d’avoir décomposé le chant naturel en sons élémentaires et radicaux. On conçoit que, pour y parvenir, il fallait des organes très exercés, ce qui ne pouvait avoir lieu chez des peuples parmi lesquels l’art de la musique n’existait pas encore. Tout chant dut être alors ce qu’il est aujourd’hui pour des oreilles peu familiarisées avec notre intonation, un son formant unité lui-même, et dans lequel on n’avait sensation déterminée d’aucun autre son particulier. De même, lorsqu’un homme qui ne sait, pas lire prononce un mot, ce mot n’est pour lui que le signe unique, formé pour ainsi dire d’un seul jet. Mais son voisin, exercé à composer et décomposer des mots par les principes de la lecture, y distingue, outre chaque syllabe, le son caractéristique de chaque lettre qui le forme. C’est ainsi qu’un peintre distingue un mélange de couleurs où le vulgaire n’aperçoit qu’une couleur unique.
Il paraît donc certain que ce n’est pas sur la sensation distincte des sons radicaux que les peuples furent conduits à décomposer le chant ; c’est au contraire en combinant des sons choisis pour élément, qu’ils parvinrent à se former un chant artificiel, et c’est aussi par cette voie qu’ils acquirent la facilité de les reconnaître lorsqu’ils se trouvaient, par hasard, dans le chant naturel, où ils peuvent être compris comme tous les rapports imaginables le sont dans l’étendue.
Pour trouver notre échelle dans la nature, où quelques théoriciens prétendent la rencontrer, il faut chercher si, par quelques lois de l’organisation, la voix ne serait pas naturellement portée sur nos intervalles. Ce phénomène n’a pas lieu chez les animaux dont les cris, ainsi que le chant des oiseaux, ne sont point réductibles à notre échelle. L’organisation de l’homme aurait-elle seule ce privilège ? La difficulté de plier notre voix à la marche musicale, la nécessité de l’exercer à notre intonation, semblent prouver qu’elle lui est étrangère. Les conventions de la parole auraient-elles dénaturé nos organes ? Mais on n’a jamais reconnu de traces certaines de nos intonations, ni aucun caractère de notre mélodie dans les cris et le langage accentué des enfants encore livrés aux premières impulsions de la nature.
L’organisation de l’homme ne déterminant pas la voix à se porter sur nos intervalles, c’est donc dans la dimension des premiers instruments, déterminés peut-être par des opinions superstitieuses ou par des circonstances particulières, qu’il faut chercher la première trace de la division des sons et la formation des intervalles. Ici les règles naquirent et l’art commença. Ce fut là le premier pas que la musique fit hors de la nature ; dès ce moment aussi s’élevèrent entre elles des barrières insurmontables. L’échelle diatonique, qui résulta de cette division, rendit à jamais la musique inhabile à. suivre la marche des sons dans leur progression naturelle ; elle substitua les tons aux accents, et les intervalles, que la nature remplit, restèrent nécessairement vides sous les doigts du musicien. Telle serait la peinture si elle était bornée à n’employer que les sept couleurs du prisme pour rendre toutes les teintes de la nature. En effet, l’art procède par intervalles et la nature par accents ; la musique, enchaînée dans sa marche, ne peut imiter cette succession de sons que la nature emploie pour la seule expression des affections de l’âme. L’accent en musique est une inflexion sonore, assez déterminée pour être sentie, mais trop fine pour être évaluée en aliquote de notre échelle. Sans cette inflexion, inspirée par la sensibilité du musicien, la mélodie ne serait trop souvent qu’une succession désagréable de sons. Qu’est-ce donc que la musique aujourd’hui ? L’art de lier les sons selon des lois prescrites. Mais ces lois, sur quels fondements sont-elles établies ? où trouver dans la nature un modèle de notre échelle ? Quel chant y rencontre-t-on formé d’intervalles exacts, réguliers et appréciables ? Selon des théoriciens, il existe une mélodie naturelle, dont nous avons l’instinct et qui nous guide également dans la composition du chant. Sur quoi établir une pareille assertion ? Ne doit-on pas plutôt reconnaître dans cet instinct prétendu, un effet ordinaire de l’habitude ?
Tous les peuples ont eu encore, dit-on, leur musique. Mais cette musique était-elle semblable à la nôtre ? Si tous les peuples ont eu des mesures peur évaluer les grandeurs et les quantités, il ne s’ensuit pas qu’ils aient tous compté par mètres, décimètres, etc., et nous aurions tort de prétendre que le mètre et ses divisions sont la mesure naturelle des grandeurs, parce qu’il nous a plu de les adopter pour en évaluer les rapports.
Les oiseaux chantent ; les cris des animaux sont un chant véritable, dit-on encore. Cela dépend de l’acception qu’on veut donner au mot chant. Mais chantent-ils comme nous, ou chantons-nous comme eux ? On aime, on admire le chant du rossignol. Qui cependant se chargera d’écrire la basse fondamentale de ce chant ? La mélodie que nous y trouvons en est tout à fait indépendante ; elle ne ressemble en rien à la nôtre, et loin d’admettre nos intervalles, elle les exclut même nécessairement.
Examinons l’instrument avec lequel on parvient à imiter assez fidèlement le ramage accentué du rossignol. C’est à l’aide d’un chalumeau, dans l’intérieur duquel on fait mouvoir un piston, qu’on réussit à rendre les inflexions les plus variées de la voix du roi des chanteurs aériens. Allongé ou raccourci, le tuyau, dans lequel on souffle alternativement, fournit autant de nuances dans les sons qu’il est de points compris dans l’étendue qu’il a parcourue. Les sons, loin d’y procéder par intervalles appréciables, ne peuvent s’y lier que par des nuances insensibles : d’où il suit qu’un instrument organisé selon l’échelle musicale ne saurait imiter le chant des oiseaux, tandis qu’un chalumeau grossier, par un effet simple et naturel, en saisit, avec facilité, les inflexions les plus rapides et les plus variées.
La musique résiste donc à l’expression qu’on lui attribue, par les obstacles qui naissent des premières règles qu’elle s’est imposées. Loin de favoriser l’imitation, elle met le génie du musicien aux prises avec les principes de son art, et ses efforts les plus victorieux se réduisent à saisir, au hasard, quelques cris des passions qu’il se propose d’imiter. Réduits à douze sons distincts, pour tout moyen, que voulez-vous que fasse la musique ? En vain les musiciens disent que l’oreille n’en apprécie pas d’autres. Mais elle les sent, et la voix, ainsi que les instruments, les donnent. Une distance est-elle moins réelle parce qu’elle se trouve incommensurable avec les unités qu’il nous a plu de choisir ; et doit-on la compter pour rien, parce qu’on ne daigne pas la mesurer ? Il suffit de faire couler le doigt sur un instrument à cordes pour sentir qu’entre deux tons consécutifs il est une infinité de sons que la nature donne, que l’oreille distingue et que la musique cependant n’admet pas.
Les Grecs avaient bien apprécié cette pénurie dont la musique était frappée par des lois fixes, au delà desquelles elle ne pouvait chercher de nouvelles ressources ; mais ils attachaient à toute innovation une importance qui peut nous paraître aujourd’hui minutieuse et puérile : c’est que les Grecs avaient en eux un sentiment bien réfléchi du pouvoir des beaux-arts sur l’esprit des nations. Ils croyaient la musique dépendante de l’habitude, et, selon eux, avant que celle-ci n’eût consacré l’introduction de nouveaux éléments dans cet art, la musique, aurait perdu pour un temps une partie de sa puissance. Liée avec la poésie, dont elle en animait les accents, elle lui devait aussi sa force et son énergie. De cet accord, qu’eût troublé une combinaison nouvelle, résultait un ascendant impérieux, à l’aide duquel la République pouvait remuer, à son gré, les esprits, les enflammer, ou les calmer et les soumettre. C’était dans des jeux solennels, au milieu des fêtes, que, par la voix de la musique, elle se faisait entendre aux peuples rassemblés. C’est là que le concours de mille circonstances concentrait un foyer actif et brûlant où tous les cœurs venaient s’embraser de l’amour de la patrie et de la gloire. Toute innovation eût affaibli cette union intime. On voit donc que la musique se trouvait ainsi liée à la politique, et l’on ne doit pas être surpris d’entendre dire à Platon que le plus léger changement dans la musique entraînerait, à sa suite, une révolution dans la République. On ne sera point étonné si les peuples la regardèrent comme un bienfait des Dieux, et alors, devenue sacrée par son origine, il ne dut plus être permis aux hommes d’y toucher. Les Égyptiens avaient eu antérieurement le même respect pour la science musicale, et comme ils en attribuaient l’invention à Isis, il eût été irréligieux d’y apporter le moindre changement. Les Romains furent trop occupés de leurs conquêtes pour donner beaucoup de temps aux beaux-arts. Ils avaient tout emprunté, et, bien loin d’améliorer leur emprunt, ils laissèrent le dépôt se détériorer et s’anéantir ; mais, si, sous leur Empire, la science en elle-même fit peu de progrès, la musique ne cessa pas d’être cultivée comme un art éminent, et nous y verrons les instruments venir en aide à la voix et s’efforcer même de la remplacer.
La voix humaine, avec, l’étendue que lui a donnée la nature, peut être considérée comme l’instrument le plus parfait. Tour à tour violon, hautbois, flûte, cor, le larynx humain n’est pas plus un instrument à corde qu’un instrument à vent. C’est un instrument particulier, un instrument parfait, qui semble participer de tous les autres. Il est certain que l’instrumentation n’a été inventée que pour imiter ou accompagner la voix ; mais, réduite à ce point de vue, cette instrumentation joue pour la facture instrumentale un rôle trop important pour ne pas mériter toute l’attention et tout l’intérêt de ceux qui s’occupent d’études musicales.
C’est chez le peuple Égyptien que se développèrent les premiers éléments de la musique instrumentale. L’histoire, cependant, ne nous fournit, à cet égard, que des notions vagues et incomplètes. Selon Diodore de Sicile, les Égyptiens honoraient Mercure, comme l’inventeur de la lyre avec des cordes à boyaux, et comme celui qui, le premier, observa l’harmonie du chant ainsi que les proportions des nombres. Mercure, dit cet auteur, ne mit que trois cordes à sa lyre, à l’imitation des trois saisons de l’année : le son aigu ou la corde la plus courte pour l’été, le grave pour l’hiver, et le son médium pour le printemps. Les Égyptiens avaient l’habitude des concerts, si, par ce mot, on entend une réunion d’instruments d’espèces différentes exécutant eu même temps. Si les écrivains ne nous disent. rien à cet égard, les bas-reliefs, cette histoire sculptée, nous prouvent, par la représentation de mille réunions semblables, que les concerts étaient fréquents et que la musique instrumentale avait droit d’entrée dans la, salle des festins comme dans les réunions plus intimes.
Les Égyptiens employaient, pour leur musique instrumentale, les flûtes de différentes espèces, les trompettes, la harpe, la lyre, le luth, la guitare, le monocorde, le psaltérion, le tambourin, les cymbales, les timbales, le sistre et autres crotales de divers genres. Le battement des mains l’une contre l’autre marquait ordinairement le rhythme.
Le système instrumental des Hébreux était encore beaucoup plus compliqué, si on en croit le Père Kircher, qui affirme qu’ils ont eu connaissance de trente-six instruments différents. L’historien Josèphe va plus loin encore, car il écrit que Salomon, après avoir reçu de Dieu la science infuse, fit construire quarante mille instruments de différentes espèces, sans assigner à ce formidable orchestre d’autre emploi que celui qu’on en faisait dans les fêtes du sanctuaire.
La Grèce, qui adopta un grand nombre des fables mythologiques égyptiennes, regardait également Mercure comme l’inventeur de la lyre, qu’il avait, dit-on découverte dans une de ses promenades journalières sur les bords du Nil. Cet instrument fut perfectionné par Apollon, qui en forma, dit-on, la cythare, qui ne différait de la lyre qu’en ce qu’elle avait un manche sur lequel on posait les doigts pour presser la corde. Le luth, plus tard, réunit en lui ces deux instruments. Chez les Grecs, la musique instrumentale joua un rôle très important dans les solennités religieuses et civiles. Cette musique se composait d’instruments à cordes, d’instruments à vent et à percussion. Les Latins adoptèrent leur système de musique instrumentale ; ils leur empruntèrent également leurs instruments, qu’ils marièrent avec ceux des Étrusques. On voit la musique instrumentale figurer, à Rome, dans la procession annuelle des boucliers sacrés confiés par Numa Pompilius à la garde des Saliens.
Servius Tullius divisa le peuple en classes ou centuries, et deux d’entre elles furent composées d’instrumentistes. Tite-Live écrit que l’an 415 de la fondation de Rome, le Sénat, sous le consulat de Sulpicius Pelicus, envoya chercher en Toscane des joueurs de flûte et de pantomimes, pour célébrer des jeux scéniques qui durèrent quatre jours. Après la défaite d’Antiochus le Grand, roi de Syrie on introduisit à Rome les Psaltœ, c’est-à-dire des femmes qui chantaient et jouaient des instruments à cordes dans les fêtes. Il parait que, avant l’arrivée de ces femmes, les Romains n’avaient fait aucun usage des instruments à cordes, et que ce n’est qu’à cette époque, c’est-à-dire cent quatre-vingts ans avant l’Ère Chrétienne, que leur musique prit un nouvel accroissement. Néron admit dans son palais Terpus, le plus fameux joueur de harpe et de lyre de son temps, et, selon Suétone et Martial, ce prince était si bon musicien, qu’il disputait les prix destinés à la perfection du chant, de la flûte, de la harpe et de la lyre.
Parmi les différents usages auxquels les anciens firent servir la musique instrumentale nous devons signaler l’emploi des instruments au milieu de leurs festins. Cet usage s’introduisit sous le consulat d’Emilius ; on fit venir alors, à cet effet, de Toscane, de Naples, de Sicile, les plus fameux joueurs d’instruments. L’histoire rapporte que Calligula aimait à faire admirer son talent d’excellent musicien, dans les réunions intimes. Voulant passer pour Apollon, il fit dorer sa barbe et donna une espèce de fête ou banquet en l’honneur des divinités. Le festin composé de vingt-quatre services, était entremêlé de musique. il y avait, dit Suétone un changement de concert de voix et de tous les instruments à chaque service. Ce prince institua à Lyon des jeux qui avaient surtout rapport à la musique, auxquels les plus habiles étaient admis à faire preuve de leur savoir. Nous ne devons pas oublier de mentionner que Auguste avait établi dans cette même ville une académie de sciences et d’arts, dont la musique faisait partie. Les statuts de cette académie portaient que le vaincu devait donner le prix au vainqueur. Au dire de Strabon, le fouet, la férule et même l’immersion dans les eaux du Rhône étaient les moindres punitions de ceux qui avaient la témérité d’y apporter de mauvaises pièces, et on obligeait les auteurs, dit-il, de les effacer avec leurs langues. Si pareille exigence se renouvelait de nos jours, l’état de secrétaire perpétuel serait une douce chose ; il deviendrait bientôt une véritable sinécure.
Claudius et Messaline, sa femme, instituèrent pour la musique des prix, qu’ils distribuèrent eux-mêmes, ainsi que les couronnes décernées par les juges. Ce prince fit représenter sur le lac Fuchin un combat naval ; ce qui parut à cette fête de plus, surprenant fut un Triton fait de bois argenté, qui sortit du fond du lac, avec une grande conque à la main, et qui, après avoir sonné des fanfares aussi harmonieusement qu’auraient pu le faire quatre trompettes bien d’accord, s’engloutit ensuite de nouveau dans les flots.
Les Grecs avaient admis, à l’instar des Égyptiens, la musique pendant leurs repas ; ils avaient, les premiers en Europe, donné cette satisfaction à leur sensualité ; mais les Romains les dépassèrent encore sous ce rapport. Les mets paraissaient à leur table accompagnés par les musiciens, et, jusqu’à la fin du repas, ceux-ci ne cessaient de se faire entendre. Ils ne paraissaient, dans ces occasions, que couronnés de lauriers et de myrtes. La troupe en était distribuée de manière à ce qu’il n’y eût jamais d’interruption dans l’ensemble des voix et des instruments.
Dans les premiers siècles du christianisme, la musique instrumentale fut frappée de proscription dans la nouvelle société chrétienne, comme tout ce qui pouvait rappeler les cérémonies religieuses du paganisme. Mais lorsque saint Ambroise monta, en 374, sur le Siège Épiscopal de Milan, ce prélat donna aux cérémonies du nouveau culte la forme et la splendeur qui lui convenaient ; il appela la musique à son aide, organisa la liturgie de son diocèse, composa même des messes pour chaque fête, établit le chant alternatif des psaumes à l’imitation des églises d’Orient, et institua enfin cette psalmodie qui porte encore son nom. Saint Clément d’Alexandrie, qui est, de tous les Pères de l’Eglise, celui qui se montra le moins hostile à la musique instrumentale, s’éleva néanmoins contre elle, et saint Grégoire dit qu’il faut abandonner la musique chromatique, comme étant celle qui convient aux débauchés et aux gens de mauvaise vie. Cependant la musique doit à ce saint prélat la réforme de la musique d’église. On le vit d’abord réduire à sept lettres les quinze lettres du système qu’avait rajeuni Boëce pour indiquer les modulations de la musique et corriger ensuite les chants d’église. On lui doit également la fondation, à Rome, de deux écoles de chant, auxquelles il affecta les revenus nécessaires pour que la musique fut enseignée à des enfants. C’est de cette fondation que datent l’établissement de la chapelle pontificale et le nom devenu classique de maître de chapelle, donné à celui qui en dirige la musique.
Les premiers rois de France quoique barbares, n’étaient cependant pas insensibles aux charmes de la musique ; elle figure, dès les premiers temps de la monarchie, dans les cérémonies. Ainsi Pharamond se fait proclamer et hisser sur le pavois au son de tous les instruments existants dans son armée. Nous voyons arriver ensuite à la cour de Clovis, en 485, Oscoride, musicien instruit, que lui envoie, sur sa demande, Théodoric, ainsi que plusieurs instrumentistes, lesquels forment, dès cette époque, un corps de musique régulièrement organisé, possédant des règlements, chargé d’embellir les solennités religieuses et d’amuser les loisirs du roi.
En 660, un des successeurs de saint Grégoire, le pape Vitallien, introduisit dans l’église romaine le chant qu’on appelle consonnance ou à plusieurs voix. Il voulut que l’orgue, à peine connu alors en Italie, accompagnât les chanteurs. Cet orgue était sans doute fort imparfait ; mais son apparition dans les cérémonies du culte n’en est pas moins un fait très important à signaler.
Dans les premiers siècles de la monarchie française, ce fut toujours l’Italie qui nous initia aux principes de l’art et nous apporta les premiers rudiments de la langue musicale. Sous le règne de Pépin, le pape Paul envoya en France Simon, musicien célèbre, qui ouvrit une école de chant à Rouen. Vint ensuite Charlemagne, qui, appréciant parfaitement notre insuffisance musicale, s’adressa au pape Adrien pour avoir les deux plus célèbres artistes que possédait Rome : Benoît et Théodore ; ce monarque les chargea de diriger deux écoles qu’il fonda, l’une à Metz, et l’autre à Soissons.
Le goût de la musique instrumentale, qui se répandit peu à peu dans la société civile, et devint le plus puissant auxiliaire du chant, tient à des circonstances qui méritent d’être signalées.
Quand les barons féodaux n’étaient point en guerre, l’ennui ne tardait pas à les gagner. Le désir d’occuper d’insipides loisirs leur faisait accueillir avec, empressement tout ce qu’ils croyaient capable de les distraire. Telle fut l’origine des courses des trouvères, des ménestrels et des jongleurs. Ils parcouraient la campagne en troupes nombreuses, s’arrêtant dans les châteaux pour y débiter des chansons, des fabliaux au son des instruments, qui étaient alors la vielle, le rebec, la harpe, la doulcine.
Les ménestrels et les jongleurs se multiplièrent à l’infini. Heureusement pour leur industrie, le plaisir qu’on prenait à les entendre augmenta dans la même proportion. Ils s’accrurent en si grand nombre et commirent souvent tant d’actes répréhensibles, que Philippe-Auguste, qui n’aimait ni les chants ni les instruments, crut devoir les bannir du royaume. Cet acte de rigueur n’influa ni sur l’art ni sur la science de la musique, qui faisait alors partie de l’éducation, et qui ne pouvait être compromise par des ménétriers sans savoir.
Sous le règne de saint Louis on vit, pour la première fois, la corporation des écoles de Paris recevoir et prendre le titre d’Université, ou universalité des sciences enseignées dans ces écoles. Depuis longtemps on divisait la totalité de ces sciences en deux parties, le trivium et le quatrivium ; cette dernière expression, fort anciennement employée, même par Boëce, signifiait la réunion de l’arithmétique, l’astronomie, la géométrie et la MUSIQUE. Vers le milieu du treizième siècle on abandonna les mots trivium et quatrivium et on leur substitua celui de clergie ou des sept arts libéraux. Jean de Hauteville classe ces arts dans l’ordre suivant : l’astronomie, la MUSIQUE, la géométrie, la rhétorique, la logique, la physique et la grammaire. Gauthier de Metz, en 1245, dans son livre : Comment Clergie vint en France, considère la musique comme se composant de l’arithmétique.
Le bannissement des ménestrels ne cessa que sous saint Louis, qui leur permit de rentrer dans Paris. Depuis ce moment, les souverains et, à leur exemple, les premiers feudataires, entretinrent, à domicile, auprès de leur personne, des troupes de ménestrels, chargés de leur faire entendre régulièrement des concerts de musique.
On trouve, en 1274, des ménestrels portés au nombre des officiers de l’hôtel de Philippe le Hardi, et l’on voit figurer, pour la première fois, au nombre des officiers de Philippe le Bel un roi des joueurs de flûtes ; il se nommait Parisot. Ce même prince en 1296, accorda le titre de roi des jongleurs de la ville de Troye à Jean Charmillon. C’est donc à tort que, l’on a prétendu que Louis X était le premier roi qui eût eu des joueurs d’instruments dans la domesticité de sa maison, et que ses prédécesseurs n’avaient eu jusque là d’autre musique que celle des ménestrels ambulants. Louis X commença de régner en 1314, et nous venons de voir qu’en 1274 Philippe le Hardi en entretenait déjà.
La musique instrumentale ne faisait pas seulement des progrès dans la vie civile, nous voyons aussi la religion lui donner son appui : saint Thomas d’Aquin déclare, dans sa Somme, que l’art du musicien n’a rien de mauvais en soi au point de vue religieux, et qu’il est permis à tout chrétien de le payer pour se divertir, si ce musicien se renferme dans les bornes de la décence et respecte les fois de la morale.
La musique instrumentale jouit donc d’une assez grande faveur dès le treizième siècle, et devint l’amusement obligé de quiconque était et assez noble et assez riche pour se le procurer. Les instruments que l’on employait dans ces fêtes musicales étaient la viole, le rebec, le psaltérion, le flagel, la doulcine, la fistule. La harpe était réservée aux châtelains et damoiselles : elle était l’instrument favori de la noblesse féodale. Les orgues lui disputaient bien un peu cette prééminence, comme on le voit dans les peintures des manuscrits, où sont représentées de nobles dames jouant l’un et l’autre de ces instruments.
Ce fut au commencement du quinzième siècle que s’opéra, dans la musique instrumentale, la plus grande révolution, par l’introduction de l’Opéra. En 1440, le cardinal Riario fit représenter, à Rome, la Conversion de saint Paul ; la musique était d’un nommé Francisco Baverini. C’est, nous croyons, une des plus anciennes compositions connues dans ce genre. On récitait bien avant cette époque, sur des théâtres, les faits et gestes des grands capitaines, mais rien encore qui eût rapport à une action suivie.
La musique avait déjà fait de notables progrès en Italie. Sous le règne de la princesse Mathilde, dont la cour était une des plus brillantes de l’Europe, le chant était accompagné d’instruments. Les virtuoses français y recevaient surtout une splendide hospitalité et étaient les bienvenus à ces fêtes, auxquelles prenaient part les dames du plus haut rang.
Ces concerts étaient peu variés, sans doute ; mais les nôtres le sont-ils davantage ? On priait alors une damoiselle de faire entendre un morceau sur la harpe ou l’orgue, comme on engage maintenant une jeune personne à jouer du piano, et nous présumons même que, vu le grand nombre d’instruments dont chacun savait se servir, et dont les timbres étaient si différents, ces réunions devaient être moins monotones que celles d’aujourd’hui, où l’on se trouve condamné à l’éternel piano, à moins que, par exception, on veuille bien y admettre le violon. Dans ce temps-là, on était moins blasé, on trouvait tout bon, ou à peu près ; mais, aujourd’hui, nous ne sommes plus des affamés de musique, nous sommes des dégustateurs ; nous ne nous contentons plus, même dans nos soirées intimes, de talents ordinaires, il nous faut des artistes hors ligne. C’est ce qui fait que les instrumentistes amateurs deviennent fort rares.
Ces auditions multipliées signalèrent dans les formes de l’art un progrès incontestable, qui se fit également apercevoir dans la musique d’église. Longtemps elle s’était bornée au plain-chant ; mais l’invention des canons amena bientôt celle de la fugue ainsi que d’une foule de compositions d’un caractère nouveau ; la révolution fut si prompte, si complète, que le contre-point parut presqu’un art nouveau.
Selon certains écrivains, un des principaux promoteurs de cette révolution fut un Anglais, Dunstable, qui mourut vers l’année 1456, lequel contribua aux progrès de la musique en Angleterre et de l’art en général d’une manière assez marquée pour que quelques auteurs lui aient attribué l’invention de la composition à plusieurs parties. Dunstable eut pour contemporains, en France, Dufay, Bianchois et Fevin, d’Orléans, dont cinq messes furent imprimées par Antonio Antico de Montona, à Rome, sous Léon X ; à ces éminents artistes succédèrent Busnois et Okenheim.
Après la restauration du contre-point, une révolution s’opéra dans l’état de la musique. D’une part, se formèrent un grand nombre de compositeurs habiles, parmi lesquels on distingua Josquin des Prez, maître de chapelle de Louis XII ; Jean Mouton, son élève, maître de chapelle de François 1er , et Eustache du Courroy, le prince des musiciens de son temps, qui dirigea la chapelle, royale sous Henri III et Henri IV Ces maîtres, indépendamment de la musique d’église, produisirent, soit pour les voix, soit pour les instruments, une foule de compositions dites musique de chambre, qui, multipliées par les premiers imprimeurs de musique, fournirent d’abondantes ressources à l’art. D’autre part, les guerres d’Italie, qui remplirent les règnes de Charles VIII, de Louis XII et de François 1er , mirent la France en contact avec un pays où depuis longtemps florissaient les beaux-arts, donnèrent une impulsion nouvelle. Bientôt la mode italienne, devenant une passion, amena l’émigration d’un grand nombre d’instrumentistes qui vinrent s’établir, en France, dans les châteaux des seigneurs et dans le palais des rois. Tels furent ceux qui composèrent la musique royale sous les règnes de Charles VIII, de Louis XII et de François 1er , et notamment sous le règne de ce dernier, le joueur de luth, Albert de Ripe, de Mantoue, célébré par ses contemporains comme l’Orphée du siècle.
Quand Orphéus reviendrait d’Elysée,
Du ciel Phébus, plus qu’Orphéus expert,
Jà ne serait leur musique prisée
Pour cejourd’hui tant que celle d’Albert.
Clément Marot
Nous voyons encore figurer, parmi les musiciens de François 1er Barthélemy de Florence, Pierre Pagon, Christofle de Plaisance, Marchan de Milan, François de Virago, Nicolas de Brescia, François de Crémone, et Sanxon de Plaisance, tous joueurs de hautbois.
A la même époque, l’école flamande produisait de savantes compositions, lesquelles faisaient faire un grand pas à la musique instrumentale. Il nous suffira de citer Jacques Obrecht, qui fut maître de musique du célèbre Erasme ; il avait, dit-on, tant de facilité, que, en une nuit, il composait une belle messe, et l’on doit regarder ce travail comme un tour de force, tant ces compositions étaient alors hérissées de difficultés.
L’école française possédait, à peu près vers le même temps, Antoine Bromel, Arcadet, Verdelet, Gourdimel. En Allemagne, on remarque, à cette époque, Finck, Isaac, Senfel. Ces hommes, théoriciens et compositeurs à la fois, travaillèrent, non sans succès, à donner à la musique instrumentale une base plus scientifique. Joignant l’exemple au précepte, ils enseignèrent l’art de combiner, dans une heureuse proportion, les ressources de la voix et celles des instruments.
Le règne de François 1er peut être regardé comme l’ère de la renaissance de l’art musical en France. Nous voyons, en 1517, ce prince, ami des arts, ramener d’Italie le fameux luthier Gaspard Duiffo-Pruger, qui construisit les instruments pour sa musique, divisée en deux corps : les musiciens de la chambre, formés de chanteurs et de symphonistes pratiquant les instruments d’harmonie, tels que la harpe, le luth, la viole, l’orgue l’épinette, admis dans les appartements et la bande de l’écurie, ainsi nommée parce que les exécutants étaient portés sur les états de paiements de cette partie de sa maison. Cette bande était composée de violons, hautbois, saquebutes ou trombonnes, cornets, musettes, trompettes, fifres et tambours.
Au premier rang des maîtres qui, dans ce siècle, jetèrent la musique instrumentale dans un moule nouveau, il nous faut citer Pierre Aloïs da, Palestrina, né en 1524, et proclamé par ses contemporains le prince de la musique. A cette époque, l’art mélodieux, altéré par une vaine prétention à la science, avait perdu une grande partie de sa noblesse et de son expression. Le pape Marcel II en était tellement choqué, qu’il allait bannir la musique des églises, lorsque Palestrina arrêta cette mesure en obtenant de lui faire entendre une messe qu’il venait de composer d’après ses idées personnelles. Cet ouvrage a été conservé comme un monument curieux de la renaissance de l’art. Palestrina, encouragé par le chef de la chrétienté, ne cessa que dans un âge avancé d’enrichir l’Église de nouveaux chefs-d’œuvre. Ses chants sont si purs, sa manière a tant de noblesse et de largeur, que, malgré les révolutions et les vicissitudes de l’art, ses compositions s’exécutent encore tous les jours et excitent une admiration qui ne tarit jamais.
Nous citerons encore, au nombre des maîtres de cette époque remarquable pour l’art musical, Clément Jannequin et nous signalerons de ce compositeur deux pièces très curieuses, intitulées la Défaite des Suisses à la journée de Marignan, morceau d’une très grande difficulté d’exécution, et les Cris de Paris.
Si la musique faisait des progrès, il n’en était pas de même dans la facture instrumentale ; car en 1567, Charles IX, ne pouvant parvenir à faire faire de bons violons pour sa musique, chargea Antoine Amati de lui construire trente-huit instruments : douze grands violons, douze plus petits, plus six violes et huit basses. Ce même roi accorda, en 1570, au poëte et musicien Baïf, qui avait été élevé à Venise, et à Thibaut de Courville, des lettres patentes qui les autorisaient à établir, dans sa maison du faubourg Saint-Marceau, une académie de poésie et de musique. Chaque semaine, ce monarque, ainsi que son successeur Henri III, honoraient de leur présence les concerts qu’elle donnait.
A partir du seizième siècle, on vit, en Italie, s’organiser de toutes parts des sociétés musicales, s’élever des académies d’instruments et de chant ; le pape Nicolas V fonda celle de Bologne, Florence vit briller l’Académie des Rozzi ; Vérone et Vicence, formant deux sociétés comme celle de Bologne et de Florence, travaillèrent avec ardeur à la régénération de l’harmonie, et particulièrement de la musique instrumentale. Les couvents ne restèrent pas en arrière dans ce grand mouvement musical : on y vit les moines et les nonnes exécuter non-seulement la musique vocale, mais encore la musique instrumentale à grand orchestre. On peut citer le couvent des religieuses de San Vito, à Ferrare.
Mais la renaissance de la musique instrumentale date surtout de la création des divers conservatoires qui furent successivement fondés en Italie. On avait déjà ; vu en France semblable établissement. Ce furent des maîtres musiciens qui donnèrent naissance au premier conservatoire de musique, créé dans l’église des Vieux-Augustins de Paris, sous le nom de Confrérie de madame Sainte-Cécile, et fondée par les amateurs et musiciens zélateurs. Les statuts de cette confrérie furent approuvés par le roi Henri III en 1575. L’article neuvième de ces statuts invitait tous les musiciens à envoyer à la confrérie une de leur composition pour y être jugée, exécutée et recevoir une certaine récompense. Quatre conservatoires furent d’abord établis à Venise ; de jeunes filles en furent les seules élèves, et elles exécutaient elles-mêmes dans les collèges la musique à grand orchestre.
Naples ne tarda as à imiter cet exemple. Mais ce qui est digne de remarque, c’est que, sans que Naples et Venise se fussent entendues entre elles, la première de ces villes fonda quatre conservatoires d’hommes, tandis que la seconde en avait fondé quatre de femmes.
Le goût de la musique ne cessa de se répandre. Au seizième siècle, il n’y avait pas de festin ou de repas de famille qui ne fût suivi d’un concert. Le repas achevé, on apportait, en même temps que les fruits et les vins délicats, des instruments destinés à soutenir la voix des chanteurs. Ces instruments différaient, à beaucoup d’égards, de ceux des siècles précédents ; ils avaient suivi les révolutions de la mode. Le rebec, le psaltérion et la doulcine, des treizième et quatorzième siècles, étaient abandonnés. Le cor, la trompette, la saquebute étaient bannis des salons ; il ne s’agissait plus de célébrer les hauts faits des héros de la chevalerie, mais d’interpréter d’amoureuses chansons. Les instruments, conformes au caractère des pièces de ce genre, étaient la viole, le luth, le théorbe, la harpe. On a conservé des recueils de pièces pour ces divers instruments ; les difficultés n’y sont pas épargnées, et pourraient arrêter plus d’un artiste de nos jours.
Le théorbe, régénéré par un certain Barbetta, devint bientôt l’instrument à la mode, ainsi qu’un décacorde, instrument construit à Paris en 1575 par Claudin qui passait pour le meilleur musicien de l’époque. Ce fut également au commencement de ce siècle que fut inventé le basson par Afranio, chanoine de Pavie, et dont l’œuvre, encore informe, fut perfectionné en 1578 par Scheltzer, de Nuremberg.
Suivant une opinion généralement admise, la construction du violon, tel à peu près qu’il est aujourd’hui constitué, ne remonte qu’au seizième siècle. Sous la main d’habiles luthiers, le violon s’anima d’un souffle puissant, d’une âme énergique, tendre et passionnée ; il prit place alors dans l’orchestre, et il aspira bientôt à en devenir le roi.
Ce fut d’abord en Italie qu’il brilla de tout son éclat. Florence, la somptueuse cité des Médicis, le vit surtout déployer une grande puissance. Un auteur italien du seizième siècle, en faisant la description d’une fête donnée par Côme de Médicis, dans le palais Pitti, n’oublie pas de parler de la partie musicale de cette solennité, dans laquelle figuraient plus de quatre cents exécutants ; il insiste surtout sur le mérite prodigieux de deux jeunes violonistes, Pietro Caldora et Antonio Mozzini, qui se jouaient des plus grandes difficultés avec une sûreté d’archet surprenante.
Archangelo Corelli est dans l’ordre chronologique, ainsi que sous le rapport du talent, un des premiers violonistes qui aient illustré l’Italie. Après avoir terminé ses études musicales, Corelli voyagea successivement en Italie et en Allemagne. A Rome, il conduisit l’orchestre, composé de cent cinquante musiciens, qui accompagnait un opéra que fit jouer dans son palais la reine Christine de Suède. Son chef-d’œuvre est la troisième de ses sonates, qui sont, selon les maîtres, le rudiment des jeunes violonistes. Ses adagios sont parfaits, disent les musiciens, ses fugues divines et ses mélodies charmantes. Il a, le premier, ouvert la carrière à la sonate et en a posé les limites.
Le magnifique instrument de Torelli rivalisa avec celui de l’artiste que nous venons de nommer. On lui doit plusieurs livres de sonates pour le violon. La plus remarquable de ses productions est son huitième œuvre publié par son frère après sa mort. Torelli est l’inventeur du concerto, qui, composé d’abord pour cinq instruments, le quatuor et la partie principale, devait plus tard acquérir de si grands développements ; François Brenda et Stamitz, en y ajoutant les instruments à vent, en firent une espèce de symphonie. Des madrigaux, d’une facture large et savante, ont encore ajouté à la réputation de Torelli.
Tandis que le violon brillait sous les doigts des deux artistes précédents, Frescobaldi tirait de l’orgue des harmonies jusqu’alors inconnues. Frescobaldi, religieux de l’église de Saint-Pierre, à Rome, fut le premier, parmi les Italiens, qui joua dans la manière des fugues.
La France ne tarda pas à éprouver l’influence de ce progrès, quoique les désordres occasionnés dans le royaume par un zèle religieux poussé à l’excès apportassent de grandes perturbations dans la société. On vit à cette époque malheureuse (1572) périr Claude Gourdimel, le grand musicien, jeté dans le Rhône comme protestant, par ordre de Maudelot, gouverneur de Lyon, à l’époque de la Saint-Barthélemy.
La Musique alors en était encore au genre madrigalesque ; elle se composait de contre-point, et les instruments jouaient les mêmes parties que les chanteurs ou les solistes. Ce fut Galilée, le père de l’astronome, qui, le premier, remplaça le contre-point au théâtre par le récitatif dans Ugolin, épisode de la Divine Comédie, qu’il mit en musique et qu’il chanta en s’accompagnant de la viole. L’art du chant, encore trop inconnu, et les instruments, trop imparfaits, ne permettaient pas des effets hardis. On doit à Claudio Monteverde les premiers progrès de l’harmonie.
Monteverde s’essaya d’abord, dit M. Fétis, dans le style alla Palestrina. Mais bientôt poussé par le besoin de dire autre chose que le grand modèle, que ni lui ni ses contemporains ne pouvaient atteindre, il trouva l’accord de septième, formé par l’exécution simultanée de la dominante, de la seconde et de la quarte, de la gamme majeure naturelle. C’est dans le cinquième madrigal de Monteverde, véritable Colomb de notre monde musical actuel, que l’accord dissonnant naturel se montre pour la première fois.
Le madrigal musical a pris son nom du madrigal poétique. Cette composition remonte au seizième siècle ; l’Italie, la Flandre, l’Angleterre cultivèrent avec succès ce genre de musique ; André Willaert, Palestrina lui donnèrent une grande perfection qu’il dut surtout à Luca Marenzo, surnommé Il più dolce cigno, à cause de ses mélodies ; on disait également de lui que les Muses se seraient trouvées honorées d’avoir composé la musique de son madrigal Veggo dolce il mio ben. Le madrigal musical était d’un travail fort savant ; il s’écrivait pour les voix à trois, quatre, cinq, six et même sept parties, rendues obligatoires par les dessins dont ces morceaux étaient parsemés.
Il y avait une seconde espèce de madrigal, lequel admettait plus de liberté par l’introduction d’une basse continue ; c’est dans ce genre qu’ont excellé Lotti, B. Marcello, Clari, Durante, Steffani. Le madrigal du seizième siècle était si grave, que l’on eût eu de la peine à le distinguer des chants d’église, si on n’avait pas en connaissance des règles qui régissaient alors cette composition. Le madrigal régna surtout en Angleterre, où la reine Élisabeth l’admit à sa cour ; il vint s’intercaler au milieu de l’affreux concert qui s’y exécutait pendant les repas de cette princesse, qui n’avait alors pour distraction, selon Henxner, qu’une réunion de douze trompettes deux grosses caisses, qui jointes à des cornets, des fifres et des, tambours ordinaires jouaient tous ensemble pendant une demi-heure.
Ce fut également Monteverde qui donna à la musique dramatique de nouvelles formes en la débarrassant du contre-point. On employait alors, dit M. Castil-Blaze, que l’on rencontre toujours sur la route quand on s’occupe de recherches musicales, un grand nombre d’instruments qui ne sont plus admis dans la symphonie, dont on changeait selon l’expression diverse des morceaux de musique, Chaque personnage avait son orchestre particulier, qui lui était départi, selon le sentiment que sa voix devait exprimer. Ce moyen excellent servait à varier les jeux de la symphonie ; il annonçait le retour du personnage que l’on avait déjà vu et faisait succéder les groupes de trompettes aux sons filés des violons, aux arpèges des luths, à la douce mélodie des flûtes et des musettes. La partition de l’Orféo de Monteverde fait connaître la composition de l’orchestre qui l’exécuta en 1607 : on y voit les parties de deux clavecins, de deux contrebasses de viole, de dix dessus de viole, une harpe double (à deux rangs de cordes), deux petits violons à la française, deux grandes guitares, deux orgues de bois, trois basses de viole, quatre trombonnes, un jeu de régale (petit orgue), deux cornets, une petite flûte, un clairon et trois trompettes à sourdine. Ces instruments jouaient par groupes séparés, attachés à chaque personnage, à chaque chœur d’un différent caractère. Ainsi les contrebasses de viole accompagnaient Orphée ; les dessus de viole, Eurydice ; les trombonnes, Pluton ; le jeu de régale, Apollon ; la petite flûte, les cornets, le clairon, les trompettes à sourdine sonnaient avec le chœur des bergers, etc., etc. ; le chant de Caron était soutenu par deux guitares.
A cette époque, on ne possédait en France que les ballets, dans lesquels les récits chantés et le dialogue parlé succédaient tour à tour à la danse. Ces ballets composés sans goût, n’étaient encore assujettis à aucune règle dramatique. Baltasarini, valet de chambre de Catherine de Médicis, ordonnateur de ses fêtes et de ses festins, apporta, le premier, une certaine régularité dans ce genre de spectacle., La musique instrumentale était alors si mauvaise, qu’on fut obligé de chercher les instrumentistes en pays étrangers, et le roi Henri s’adressa, à cet effet, au maréchal de Brissac, grand amateur de musique, gouverneur du Piémont : « Il avoit dit Brantôme, sa bande de violons, la meilleure qui fust en toute l’Italie, où il estoit envieux de l’envoyer rechercher et la très-bien appointer ; desquels en ayant esté faict grand cas au feu roy Henry et à la reyne, les envoyèrent demander à M. le mareschal pour apprendre les leurs, qui ne valoient rien et ne sentaient rien que petits rebecs d’Écosse aux prix d’eux ; à quoi il ne faîllit de les leur envoyer : dont Jacques Maryo et Baltazarin estoient les chefs de la bande, et Baltazarin, despuis, fut valet de la chambre de la reyne et l’appeloit-on M. de Beaujoyeux. Ce fut lui qui, en 1681, composa le fameux Ballet comique de la Royne pour les noces du duc de Joyeuse. »
Ce ballet était presque un opéra ; les paroles étaient de La Chemaye, aumônier du roi ; la musique fut composée par Beaulieu et par Salmon, musicien de la chambre ; les décorations peintes par Jacques Patin.
Dans l’introduction figuraient une musique d’orgues douces, des hautbois, des cornets et des trombonnes ; le chant des Sirènes, écrit à quatre parties, était accompagné par huit Tritons jouant de la harpe, flûtes, trompes, violes, lyres, luths ; vingt violons, réservés pour le ballet, jouèrent un son fort gai, dit le manuscrit nommé la Clochette ; les airs de ballet étaient écrits à cinq parties, un ou deux violons, alto, basse et basse de viole ; la partie de chant fut confiée à des ténors, barytons et basses ; on y trouvait également un air de chant accompagné par huit Satyres jouant de la flûte droite ; un autre air accompagné par l’orgue et un solo de siring avec le même accompagnement. Le mélange des morceaux pour ces instruments divers avec la danse et des chansons à plusieurs parties, s’y trouvait mis en opposition avec esprit et avec un certain art. On prétend que ce ballet coûta 1,200,000 écus à monter.
Ce fut toujours le théâtre qui fit faire les plus grands progrès à la musique ; il fut alimenté dans le moyen âge par plusieurs sources qu’il importe de distinguer. Outre l’affluent ecclésiastique, disait M. Magnin dans le Journal des Savants, en 1846, qui a été ce qu’on peut appeler la maîtresse veine dramatique pendant les neuvième, dixième, onzième et douzième siècles, le théâtre n’a pas cessé de recevoir, à des degrés divers, le tribut de deux autres artères collatérales, à savoir : la jonglerie seigneuriale, issue des bardes et des scaldes, et la jonglerie foraine et populaire. Mazarin avait si bien compris combien les représentations théâtrales pouvaient avoir d’effet sur l’art musical, qu’il fit tous ses efforts pour les introduire à la cour de France. Ce prince de l’Église fit représenter au palais du Petit-Bourbon la Finta Pazza en 1645, par une troupe italienne. Ce même cardinal attira à Paris, en 1647, la fameuse chanteuse Léonora pour chanter devant la reine.
Ce fut à cette époque que l’abbé Perrin, après avoir composé une pièce intitulée la Pastorale que Cambert mit en musique, la fit exécuter au village d’Issy, dans la maison d’un sieur de La Haye. Cette nouveauté eut une, vogue infinie ; la grande route fut toute la journée couverte de carrosses qui se rendaient à ce village. Mazarin voulut connaître ce nouvel œuvre ; il le fit représenter au château de Vincennes et en fut si satisfait, qu’il fit obtenir, en 1669, à Perrin, des lettres-patentes portant permission d’établir des académies. de musique pour chanter en public. L’abbé, ne pouvant suffire à tous les soins que demandait cette nouvelle entreprise, s’associa Cambert pour la musique, puis le marquis de Sourdiac pour les machines, et, fut établir son académie au Jeu de Paume de la rue Mazarine. En 1671, Pomone fut le premier opéra français représenté en public.
Louis XIV, qui désirait importer en France les richesses de l’harmonie ultramontaine, confia à Lulli la réorganisation de sa musique. Ce musicien était né à Florence en 1633 et avait reçu les premières leçons de musique et de guitare d’un cordelier, ami de sa famille. Il apprit ensuite à jouer du violon et y montra d’heureuses dispositions. Le chevalier de Guise, voyageant en Italie, fut charmé des talents du jeune Lulli, et l’emmena à Paris lorsqu’il n’était encore âgé que de treize ans. Mademoiselle, nommée la Grande Mademoiselle, ayant entendu parler au chevalier de son protégé, le lui demanda et eut la singulière fantaisie de le placer dans ses cuisines au rang des marmitons. Doué du caractère le plus gai, Lulli amusait ses camarades et charmait quelquefois leurs ennuis par les accords de son violon. La princesse l’écouta un jour avec beaucoup de plaisir et lui donna des maîtres de clavecin et de composition nommés Métru et Roberday, tous deux organistes à Paris. Louis XIV voulut entendre un musicien dont tout le monde parlait avec admiration ; il fut si satisfait du jeu de Lulli sur le violon, qu’il s’empressa de l’attacher à son service. Il lui donna l’inspection de sa musique, et particulièrement celle d’une nouvelle bande de musiciens qu’on nomma les petits violons, pour les distinguer des vingt-quatre grands violons, espèces de ménétriers qui savaient à peine lire la musique. Formés par Lulli, les nouveaux musiciens firent, depuis lors, le service de la chapelle et de la chambre du roi, et les anciens violons ne conservèrent d’autre privilège que celui de jouer dans l’antichambre pendant les dîners d’apparat et aux bals. Lulli commença par composer quelques airs pour les ballets qu’on exécutait à la cour et les divertissements des comédies de Molière. Chargé des détails des fêtes de la cour, il écrivait aussi beaucoup de symphonies qu’on y exécutait. Il pelotait en attendant partie ; elle se présenta enfin.
Après avoir donné les Peines et les Plaisirs de l’Amour, musique de Cambert, la désunion se mit entre les associés de la nouvelle académie. Le marquis de Sourdiac, sous prétexte des avancés qu’il avait. faites, s’empara du théâtre et s’adjoignit un nommé Gilbert. On vit, dès la création de l’Opéra, les bailleurs de fonds s’ériger, comme de nos jours, en directeurs et causer souvent la ruine de l’entreprise. Lulli sut profiter de cette division ; par le crédit de madame de Montespan, il obtint que Perrin lui cédât son privilège, et il se le fit confirmer par, de nouvelles lettres-patentes ainsi conçues :
« Louis, par la grâce de Dieu, etc., etc.
« Les sciences et les arts étant les ornements les plus considérables des États, nous n’avons point eu de plus agréables divertissements, depuis que nous avons donné la paix à nos peuples, que de les faire revivre en appelant auprès de nous tous ceux qui se sont acquis la réputation d’y exceller, non-seulement dans l’étendue de notre royaume, mais aussi dans les pays étrangers, et, pour les à obliger davantage de s’y perfectionner, nous les avons honorés des marques de notre estime et de notre bienveillance. Et comme, entre les arts libéraux, la musique y tient un des premiers rangs, nous aurions, dans le dessein de la faire réussir avec tous ces avantages, par nos lettres patentes de 1669, accordé au sieur Perrin une permission d’établir, à notre bonne ville de Paris et autres de notre royaume, des académies de musique pour chanter en public des pièces de théâtre, comme il se pratique en Italie, en Allemagne et en Angleterre. Mais ayant depuis été informé que les peines et les soins que ledit sieur Perrin a pris pour cet établissement n’ont pu seconder pleinement notre intention et élever la musique au point que nous nous l’étions promis, nous avons cru que, pour y mieux réussir, il était à propos d’en donner la conduite à une personne dont l’expérience et la capacité nous fussent connues, et qui eût assez de suffisance pour fournir des élèves, tant pour bien chanter et actionner sur le théâtre, qu’à dresser des bandes de violons, flûtes et autres instruments..
« A ces causes, informé de l’intelligence et grande connaissance que s’est acquises notre cher et bienaimé Jean-Baptiste Lulli au fait de la musique, dont il nous a donné et donne journellement de très agréables preuves depuis qu’il s’est attaché à notre service, qui nous ont convié de l’honorer de la charge de Surintendant et compositeur de la musique de notre Chambre, nous avons audit sieur Lulli permis et accordé, permettons et accordons par ces présentes, signées de notre main, d’établir une Académie royale de musique dans notre bonne ville de Paris, qui sera composée de tel nombre et qualité de personnes qu’il avisera bon être, que nous choisirons et arrêterons sur le rapport qu’il nous en fera, pour faire des représentations devant nous quand il nous plaira, des pièces de musique qui seront composées, tant en vers français qu’autres langues étrangères, pareilles et semblables aux académies d’Italie, pour en jouir sa vie durant, et, après lui, celui de ses enfants qui sera pourvu et reçu en survivance de ladite charge et Surintendant de la musique de notre Chambre, avec pouvoir d’associer avec lui qui bon lui semblera pour l’établissement de ladite Académie ; et pour le dédommager des grands frais qu’il conviendra faire pour lesdites représentations, tant à cause des théâtres, machines, décorations, habits, qu’autres choses nécessaires, nous lui permettons de donner au public toutes les pièces qu’il aura composées, même celles qui auraient été représentées devant nous, sans néanmoins qu’il puisse se servir, pour l’exécution desdites pièces, des musiciens qui sont à nos gages, et comme aussi de prendre telles sommes qu’il jugera à propos et d’établir des gardes et autres gens nécessaires aux portes des lieux où se feront lesdites représentations ; faisant très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et conditions qu’elles soient, même aux Officiers de notre maison, d’y entrer sans payer, comme aussi de faire chanter aucune pièce entière en musique, soit en vers français ou autres langues, sans la permission par écrit dudit. sieur Lulli, à peine de 10,000 livres d’amende, et de confiscation des théâtres, machines, décorations, etc. Le sieur Lulli pourra aussi établir des écoles particulières de musique dans notre bonne ville de Paris, et partout où il le jugera nécessaire, pour le bien et avantage de ladite Académie royale.
Et d’autant que nous l’exigeons, sur le pied de celles des académies d’Italie, où les gentilshommes chantent publiquement en musique sans déroger, voulons et nous plaît que tous gentilhommes et damoiselles puissent chanter auxdites pièces et représentations de notre dite Académie royale, sans que pour ce, il soit aussi dérogé auxdits titres de noblesse et à leurs privilèges, charges, droits et immunités ;
« Révoquons et cassons, etc.
« Donné à Versailles, mars 1672.
Quoiqu’il ne fut pas le premier directeur, on peut regarder Lulli comme le fondateur de notre première scène lyrique. Bientôt tout Paris se pressa dans le nouveau temple élevé à la musique, où des prestiges d’un genre tout nouveau séduisaient les imaginations. Mais à côté de ces prestiges s’en trouvait un autre, qui n’exerça pas moins d’empire sur les spectateurs, c’est l’orchestration riche et puissante organisée par Lulli.
La musique prit une forme nouvelle dans les symphonies de cette époque, ; les premiers violons, seuls alors, faisaient entendre un chant soutenu ; les autres parties se réduisaient à un accompagnement monotone. Lulli, le premier, y ajouta de la variété, il y introduisit de nouveaux instruments, tels que les timballes et les trompettes.
Mais ce qui distingue particulièrement les symphonies de ce maître, ce sont de très belles fugues ; elles sont connues et estimées des artistes modernes ; Nicolo Isouard imita une de ces fugues dans son opéra de Lulli et Quinault.
Si l’on considère Lulli comme compositeur, dit Strafford, dans son Histoire de la musique, on ne peut nier qu’il eût un mérite fort remarquable dans la déclamation chantée, c’est-à-dire dans le récitatif. A l’égard de la mélodie de ses airs et de son instrumentation, il ne doit pas être placé parmi les innovateurs, car il a imité le style des Carissimi et de Cavalli. Mais telle était l’ignorance où l’on était en France, sur ce qui concernait la musique étrangère, qu’on y fut persuadé qu’aucun musicien ne pouvait lutter de génie avec Lulli, et ce préjugé, pardonnable en 1675, se perpétua pendant plus de cinquante ans. Pour avoir chance de réussir auprès du public, il fallait, être son imitateur, et comme l’imitation ne donne jamais qu’une reproduction affaiblie, on eut le même genre de musique, mais chaque jour de plus en plus amoindri, jusqu’à l’arrivée de Rameau, en 1733.
La musique instrumentale fut également en progrès ; on cite parmi les organistes Bournonville, Dumont, Monard, Richard, Pommelin, François Couperin, surnommé le grand, Marchand. Maret et Forqueray firent admirer leurs talents sur la viole, et Senaillé, le premier violoniste de France, fut mis en parallèle avec les virtuoses italiens. Leclair, son contemporain, se montra son émule ; l’orchestre s’était enrichi de la contrebasse que Monteclair, le premier, fit entendre à l’Académie Royale de Musique.
Nous avons, vu le roi Louis XIV parler, dans les lettres-patentes accordées à Lulli, de musiciens qui sont à ses gages ; c’étaient les musiciens de la cour, divisés ainsi :
MUSIQUE DE LA CHAPELLE : 1 compositeur chargé d’écrire les messes et motets, - 4 chefs d’orchestre, dont deux chargés alternativement de l’éducation des enfants de chœur ; - 4 organistes, - 13 hautes-contres, - 18 hautes-tailles, - 21 basses-tailles, - 5 basses chantantes, - 1 noteur (ou copiste), - 4 dessus de violon, - 2 violes, - 2 flûtes d’Allemagne, 2 basses de viole, - 1 contrebasse de viole, - 2 bassons, - 1 basse de cromorne.
MUSIQUE DE LA CHAMBRE : 2 surintendants, - 3 pages chantant les dessus, - 3 hautes-tailles, - 2 basses-tailles, - 2 basses chantantes ; - accompagnement, 1 clavecin, 1 petit luth, 1 viole, 1 théorbe.
Partie instrumentale : 4 petits violons, - 4 basses de violes, dont trois jouées par des demoiselles, 1 luthier.
La grande bande des petits violons, composée de 24 instrumentistes.
La bande des petits violons, organisée par Lulli, nommée violons du cabinet, au nombre de 23.
MUSIQUE DE L’ÉCURIE POUR FÊTES ET TOURNOIS : 12 dessus de hautbois, - 2 contrebasses de hautbois, 2 tailles idem, - 2 basses idem, 2 dessus de cornet, - 2 tailles de cromorne, - 2 quintes idem, 2 basses idem, - 2 trompettes marines, - 12 trompettes ordinaires, 1 timbale.
Cette organisation resta à peu près la même sous la régence ; mais, sous le règne de Louis XV, la petite bande créée par Lully, à cause de l’insuffisance du talent de ceux de la grande, et jouant aussi aux bals de la cour, au lever ainsi qu’au grand couvert, disparut, et l’on ne conserva que les charges des 24 violons de la grande bande. Mais leur symphonie discordante détermina les premiers gentilshommes de la chambre à ne plus permettre, à l’avenir, que ces charges fussent acquises par des ménétriers, et à mesure que les places devenaient vacantes, on les donna à des musiciens du roi, ce qui les rendit indépendantes de leur communauté ; enfin, toutes ces charges furent supprimées en 1761, et depuis ce furent les musiciens de la chambre qui exécutèrent les symphonies.
Nous avons évité de parler de la corporation des musiciens, dite des Ménestriers ; nous nous sommes tus sur l’histoire intéressante de cette confrérie de Saint-Julien et sur celle de ses. nombreux procès, parce que nous destinons un chapitre spécial au récit explicite des faits qui constatent et la grandeur et la décadence de ce corps privilégié.
S’il y avait à cette époque quelques maîtres distingués, pour divers instruments, l’ensemble des musiciens était bien faible, puisqu’on lit dans les Fastes de l’Opéra, que l’inhabileté des membres de son orchestre était telle, qu’ils estropièrent la Médée, de Charpentier, représentée en 1705. Cet opéra n’eut alors, par la faute des musiciens, aucun succès. L’orchestre de l’Opéra se composait de quarante-sept musiciens, depuis le batteur de mesure, qui touchait 1,000 livres par an, jusqu’au timbalier, qui ne touchait que 150 livres. La totalité des fonds alloués pour cet orchestre était de 20,150 francs. Le compositeur s’était permis des modulations, des traits d’accompagnement qui s’élevaient au-dessus du style simple de Lulli, l’orchestre ne put s’en tirer. L’incapacité des symphonistes, dit M. Castil-Blaze, auquel nous empruntons ce récit, fut mise à découvert. Les élèves de Cambert et de Lulli, devenus vieux, s’étaient retirés, et leurs places étaient occupées par des gens sans talent. On voyait le batteur de mesure obligé d’avertir les violonistes quand ils avaient à changer la position de la main. Il en fut longtemps de même, puisque quand le Régent voulut entendre, en 1716, les sonates de Corelli, on ne trouva, à Paris, personne qui pût les exécuter, et ce prince fut obligé de les faire chanter par trois voix ; on dit même, qu’après les avoir étudiées pendant quelques années, il se trouva enfin trois musiciens capables de les dire ; et de ce nombre était Baptiste.
Ce fut seulement vers la fin du dix-septième siècle qu’une espèce de duo de chambre, très-savant et très-travaillé, commença à être en faveur. Les premiers duos furent ceux de Bonancini, publiés à Bologne en 1691. Ces morceaux étaient composés d’un mouvement lent, dialogué d’abord, ensuite à deux voix ; puis venait une seconde partie très-courte, souvent d’un mouvement un peu plus vif ; après quoi l’on recommençait la première partie tout entière.
Sous la régence, la musique religieuse et théâtrale resta stationnaire. Quoique élève de Bernier, quoique bon musicien et compositeur, puisqu’il avait écrit la partition de Panthée, le Régent ne fit pas faire de progrès à la musique ; il était réservé au règne de Louis XV de faire une révolution dans cet art, dont Rameau fut le chef. Né à Dijon, en 1683, après avoir voyagé quelque temps en Italie, il revint en France, et arriva à Paris après avoir été organiste à Clermont en Auvergne ; bon exécutant, il se fit remarquer par quelques morceaux composés par lui pour le clavecin ; il publia ensuite son fameux traité d’harmonie. Comme tous les musiciens de mérite qui sont peu connus, Rameau ne put obtenir un poëme des scribes de l’époque, et ce ne fut qu’à l’âge de cinquante ans qu’il fit représenter son premier ouvrage, Hippolyte et Aricie (1733) ; le succès ayant couronné son œuvre, les libretti lui arrivèrent alors en foule, et, dans l’espace de dix-sept années, il fit exécuter vingt-deux opéras.
Les partisans de Lulli se déchaînèrent contre Rameau qui venait de rompre avec l’ancien genre et entrait audacieusement dans une voie nouvelle. Ils trouvèrent son harmonie dure, baroque, ses mélodies tourmentées, son récitatif trop chantant et ses airs pas assez. Mais ceux qui jugeaient sans préjugés et qui aimaient les progrès de l’art rendirent justice à Rameau et avouèrent qu’il y avait plus de vigueur, plus d’effet dans sa musique que dans celle de Lulli ; que ses accompagnements avaient plus d’intérêt, que son harmonie était plus variée ; enfin, que les airs de danse étaient plus diversités. Lulli, néanmoins, conserva beaucoup de partisans, et Rameau eut également les siens. Les habitués de l’Opéra se divisèrent en deux camps, qui tiraillèrent pendant longtemps. Les contemporains de Rameau furent Mondonville, Berton, d’Auvergne, Trial.
L’arrivée, à Paris, en 1752, d’une troupe de chanteurs italiens qui donna des représentations à l’Académie Royale de Musique, et qui débuta par la Serva Padrona de Pergolèse, ne fit que rendre la dispute entre les deux camps encore plus vive. La partie intelligente montra la plus vive admiration pour cette musique élégante, spirituelle, dans laquelle la vérité de la diction, la forme gracieuse de la mélodie et la convenance de l’instrumentation s’unissaient pour former un tout qui séduisait l’oreille et l’esprit De leur côté, les enthousiastes de la musique française furent fort scandalisés de l’atteinte portée aux objets de leur admiration ; une guerre s’alluma entre les deux partis, que l’on désigna sous les noms de Coin de la Reine et Coin du Roi, parce que chacun se rangeait, selon son opinion, du côté -de la loge du roi ou du côté de celle de la reine. Rousseau, qui venait de faire représenter avec succès son Devin de Village, et le baron Grimm, étaient à la tête du Coin de la Reine. Cette guerre de plume dura plus de deux ans.
Duni, sorti de la même école que Pergolèse, vint en France en 1757 et composa l’un des premiers opéras comiques français ; il a pour titre : le Peintre amoureux de son modèle. Il donna successivement huit ouvrages. Philidor acheva ce que Duni avait commencé, car à la gracieuseté de sa mélodie il ajouta une certaine force d’harmonie et d’instrumentation jusqu’alors inconnue ; si la mélodie de Philidor manquait quelquefois de charme, elle était toutefois dramatique. Monsigny contribua également à faire oublier le style lourd et soporifique de la musique française. Musicien de nature, peu instruit dans l’art d’écrire, mais doué d’une sensibilité exquise et de la faculté de trouver des mélodies expressives et naturelles, il avait pris aussi le tour aisé de la musique italienne, et sa manière légère, ainsi que ses ouvrages, préparèrent les Français à une grande révolution musicale.
Le mouvement vers le perfectionnement était déjà imprimé quand Grétry visita Paris, en 1743 : il acheva l’ouvrage de ses prédécesseurs, et jeta, dans cinquante opéras de tout genre, une multitude de mélodies harmonieuses, de traits d’un excellent comique ou d’expressions touchantes. Dans l’état où était l’art au moment où ce compositeur commença sa carrière, on pouvait déjà écrire avec plus de correction, avoir une harmonie plus forte, une instrumentation plus variée, mais non adapter mieux la musique au genre de chaque ouvrage, ni mieux soutenir l’intérêt. De tous les compositeurs d’opéras comiques, Grétry est celui dont la musique obtint les succès les plus brillants, et dont les ouvrages sont restés le plus longtemps en faveur.
Cependant si l’opéra comique faisait des progrès, l’ancienne musique française semblait s’être réfugiée à l’Académie Royale de Musique comme dans un fort inexpugnable. Mais Gluck, compositeur allemand, fut appelé par les directeurs de l’Opéra, qui voyaient chaque jour leurs habitués les abandonner. On ne trouvait alors à ce théâtre qu’un système de chant suranné, une exécution instrumentale fort mauvaise une musique lourde et fatigante. Homme de génie et doué d’une volonté de conviction, Gluck sut persuader aux artistes de l’Opéra qu’ils devaient renoncer à leurs anciennes habitudes, et il leur fit chanter, en 1774, à peu près comme il le désirait, son Iphigénie en Aulide. Le succès fut immense, et, malgré les cris d’un petit nombre de vieux enthousiastes de la musique de Lulli et de Rameau, la révolution du goût fut achevée aussitôt que commencée. La vérité de diction dans le récitatif, la force d’harmonie, les effets d’instrumentation, qui brillaient dans cet ouvrage, étaient des choses absolument neuves.
Mozart se rendit à Paris en 1778 ; c’était son troisième voyage en France ; appelé pour composer la musique d’un opéra de Noverre, il devait être ensuite nommé organiste de la chapelle de Versailles ; tout cela n’eut pas lieu. En attendant la réalisation des promesses qui lui étaient faites, il écrivit sa première symphonie, que l’on exécuta au Concert spirituel. Voici à ce sujet une lettre curieuse de, l’auteur à son père
J’ai fait une symphonie pour l’ouverture du Concert spirituel ; elle a été exécutée et a reçu une approbation unanime. Le Courrier de l’Europe en a, je crois, parlé ; donc elle a réussi. J’avais très-peur aux répétitions, car jamais je n’ai rien entendu d’aussi mauvais. Vous ne pouvez vous figurer de quelle manière ma pauvre symphonie y fut exécutée deux fois de suite ; mais tant de morceaux sont en répétition, que le temps manque. Je me couchai donc, la veille de l’exécution, de mauvaise humeur et rempli de crainte ; le lendemain, je résolus de ne pas aller au concert ; cependant le beau temps qu’il fit changea ma résolution. J’y allai donc, résolu, si l’exécution n’était pas meilleure que la répétition, de sauter dans l’orchestre, d’arracher le violon des mains de M. La Houssaye, premier violon, et de diriger moi-même. Je priai Dieu pour que tout allât pour le mieux, et la symphonie commença. Raff était à côté de moi. Au milieu du premier allegro était un passage que je savais devoir plaire : le public fut transporté et les applaudissements furent unanimes. Comme j’avais prévu cet effet, j’avais ramené ce passage à la fin par un da capo. L’andante plut aussi beaucoup, mais surtout le dernier allegro. Comme on m’avait dit qu’ici les allegro commencent avec tous les instruments à l’unisson, je commençai le mien par huit mesures piano pour deux violons, et de suite forte. Le piano fit faire chut, ainsi que je l’avais prévu ; mais, dès les premières mesures du forte les mains firent leur devoir. De joie, j’allai, après ma symphonie, au Palais-Royal, où je pris une bonne glace ; je dis le chapelet que j’avais fait vœu de dire......
Pendant que Gluck obtenait des succès avec Orphée, A1ceste, quelques amateurs lui reprochaient de manquer de grâce dans sa mélodie ; l’arrivée de Piccini, en 1777, leur parut favorable pour faire triompher leur critique. Piccini, l’un des compositeurs italiens les plus renommés de cette époque, venait en France après avoir fait représenter plus de cent opéras. On lui confia le poëme de Roland, ouvrage qui fut exécuté peu de temps après l’Armide de Gluck. La guerre de plume commença derechef entre les partisans de ces deux écoles. La Harpe, Marmontel, Suard, l’abbé Arnaud et Guinguené prirent part à la guerre des Piccinistes et des Gluckistes ; il fut publié, de part et d’autre, une multitude de brochures. Néanmoins, les ouvrages de Gluck finirent par l’emporter dans l’opinion générale, et la plus grande part de gloire lui fut dévolue.
Voulant a cette époque, encourager les grandes compositions musicales, le roi Louis XVI fonda, en 1784, un prix pour le meilleur opéra ; vingt-deux partitions furent envoyées, mais nous ignorons si le prix fut distribué et le nom de celui ni l’obtint. Ce fut dans cette même année que fut créée une école royale de musique pour douze garçons et douze jeunes filles.
La musique d’église était encore faible de style, parce que les études sérieuses de contre-point et d’harmonie étaient faites dans un mauvais système. Giroust, l’abbé d’Haudimont et quelques autres passaient pour être fort habiles en e genre, mais aujourd’hui leurs compositions sont tombées dans l’oubli. Gossec, que nous retrouverons plus tard, seul mérite d’être distingué. Plus instruit dans l’art d’écrire que les autres musiciens français, il a laissé quelques morceaux de musique sacrée, et particulièrement une messe des morts qui mérite des éloges.
La musique instrumentale prit bientôt un nouveau développement, par l’institution des concerts publics. Le premier que nous rencontrons est le Concert Spirituel, créé en 1725, et dont la direction fut confiée, par Louis XV, à Danican Philidor. Les séances des Enfants d’Apollon commencèrent en 1741 ; puis vint ensuite, en 1770, le Concert des Amateurs, composé de quarante violons, treize violoncelles, huit contrebasses, flûtes, hautbois, clarinettes, etc. Les concerts des Enfants de l’Harmonie s’établirent en 1782 ; le club des Artistes se forma en 1785.
Gossec, qui avait organisé le Concert des Amateurs, en 1770, avec l’aide de M. de La Haye fermier général, ayant été contrarié dans sa direction par ses bailleurs de fonds, se retira et prit le sceptre du Concert spirituel. On vit alors se créer un autre établissement qui laissa loin derrière lui ses devanciers ; ce fut le Concert de la Loge-Olympique, rue du Coq-Héron, dont l’orchestre, dirigé par Navargille aîné, était le plus remarquable que l’on eût encore entendu. Les directeurs de ce concert firent offrir à Haydn. d’écrire, pour leur réunion, plusieurs symphonies, offrant 600 francs pour chacune d’elles. Haydn trouva la somme si exorbitante qu’il ne crut à la réalité de l’offre que lorsqu’un banquier allemand lui assura avoir les fonds à sa disposition. Ce ne fut pas encore assez pour rassurer le grand compositeur, il s’enquit auprès d’un ecclésiastique, s’il pouvait, en toute sûreté de conscience, accepter une somme aussi considérable, eu égard au peu d’importance du travail ; rassuré de tout côté, il se mit à écrire et adressa à la Loge-Olympique diverses partitions, qui toutes eurent un grand succès. Ces manuscrits, qui appartenaient de droit à la Loge, furent vendus, pour être gravés, à divers éditeurs, et les directeurs adressèrent à Haydn, outre les 600 francs, le prix des manuscrits ainsi cédés, procédé auquel le compositeur fut très-sensible. Ces ouvrages sont connus sous le titre de Symphonies du répertoire de la Loge Olympique.
Devenus plus habiles ensuite dans l’exécution instrumentale, les musiciens français comptèrent parmi eux de bons organistes, tels que Daguin et Calvière.
Le clavecin fut cultivé avec beaucoup de succès, en France, dès le commencement du dix-septième siècle. Les clavecinistes les plus célèbres jusqu’à la fin du règne de Louis XVI furent François Couperin, Hardelle, d’Anglebert, Baret, Marpung, Dussek, Mozart, Pleyel, Steibelt, Clémenti.
Les violonistes de l’école française, parmi lesquels on remarquait Guillemain, Gaviniés et La Houssaye, tenaient une place honorable. Les instruments à vent étaient ceux sur lesquels les musiciens français s’étaient le moins distingués.
Sous Corelli et ses contemporains, la musique instrumentale, plus savante que mélodique, fut souvent aride ; Geminiani commença à l’enrichir du côté de l’expression ; mais ce fut sous Tartini, contemporain des Léo, des Gomelli, qu’elle s’éleva au plus haut degré d’expression, tant sous le rapport de la composition que sous celui de l’exécution. Peu après cette époque, le concerto, en particulier, reçut un accroissement considérable entre les mains de l’élégant Jarnovick, du gracieux Mestrino ; mais l’un et l’autre furent surpassés par Viotti.
La musique concertante, c’est-à-dire la musique instrumentale à plusieurs parties dans laquelle les instruments sont tous également obligés, soit que chacun d’eux ait un dessin qui lui soit propre, soit parce que chacun d’eux reprend tour à tour le chant, les autres devenant successivement accompagnateurs, commença à se développer. Boccherini fut le premier qui, vers 1768, donna au trio un caractère fixe ; après lui, vinrent Fiorillo, Cramer, Giardini, Pugnani, enfin Viotti.
C’est Boccherini qui, le premier et à la même époque, fixa le quatuor ; il fut suivi de Giardini, de Cambini, de Pugnani, et, dans une école différente, de Pleyel, Haydn, Mozart, Beethoven. Ce fut Boccherini qui, toujours vers le même temps, fixa encore le quintetti, dans lequel il n’a eu pour rival que Mozart.
La symphonie, cultivée, depuis le milieu du siècle, par Gossec, Tœski, Wanhall et Ém. Back, fut perfectionnée par Haydn et Beethoven.
Telle était la situation de la musique dramatique à l’aurore de la révolution française de 1789.
CHAPITRE III
Nous n’avons pas encore parlé de la musique militaire, parce que nous lui réservions une section particulière. Cette division de la musique a une trop grande importance commerciale, au point de vue de la facture des instruments à vent, pour être oubliée.
La musique a été regardée, dans tous les temps, comme un puissant moyen d’action sur les sentiments belliqueux ; s’il faut en croire même les traditions de l’antiquité, cet art si révéré fut plus d’une fois l’auxiliaire de la victoire.
Les Grecs avaient coutume de placer à la tête de leurs troupes des joueurs de flûte et de trompette et même des citharèdes afin d’exciter le courage des soldats ou de les rallier au moment de la retraite. Cet usage fut suivi chez les Romains, auxquels l’empruntèrent, par la suite, les différents peuples soumis à leur domination.
La mention la plus ancienne qui soit faite de la musique dans les annales de Rome remonte presque à son origine. Lors du triomphe de Romulus, après la victoire qu’il venait de remporter sur les habitants de Cicina, l’armée entière accompagna le char du vainqueur en célébrant par des chants les hauts faits de son chef. Vint ensuite Numa, qui institua les Saliens, gardiens des douze boucliers sacrés et chanteurs d’hymnes adressés au dieu de la guerre. Plus tard, on vit Servius Tullius diviser le peuple en centuries et composer deux d’entre elles de joueurs de trompettes, de cornets et de tous les instruments propres à sonner la charge et à conduire les troupes aux combats
En effet, quoi de plus propre que la musique à seconder l’élan, à échauffer l’enthousiasme du guerrier. Non seulement elle électrise, enflamme et fait affronter les périls, mais elle délasse des fatigues de la guerre, charme les loisirs après le combat et aide à supporter patiemment, ainsi qu’avec courage, les longues marches et les travaux pénibles.
On sait combien est grande, sous ce rapport, l’influence du rhythme. Le maréchal de Saxe voulait que l’on fît travailler les soldats en cadence, au son du tambour et des instruments. C’est ainsi que les Égyptiens parvenaient à transporter d’un endroit à un autre leurs immenses monolythes : on voit, dans les représentations murales de ces opérations, un homme hissé sur le monolythe, battant la mesure avec les mains. Ce fut également par le pouvoir du rhythme que les Lacédémoniens, sous Lysander, détruisirent, en six heures de temps, le Pyrée, au son de la flûte, avec un détachement de trois mille hommes.
Plusieurs chefs ont voulu, dans un but d’économie, proscrire l’usage de placer des musiciens en tête des troupes, mais l’expérience leur a bientôt démontré que les musiques militaires étaient assez utiles pour justifier les frais de leur entretien. Ceux des écrivains militaires qui se sont montrés peu partisans de cet usage ont avoué eux-mêmes que la musique était au moins nécessaire comme chronomètre des marches à pas cadencés, marches que les tambours ne peuvent soutenir indéfiniment.
Depuis longtemps, en Europe, les musiques militaires ont pris une grande extension. C’est en Italie et en Allemagne qu’elles reçurent d’abord un accroissement remarquable. Pierre, le Grand s’occupant de l’organisation de ses armées de terre et de mer, l’une à l’imitation de l’Allemagne, et l’autre à l’imitation de l’Angleterre et de la Hollande, fit venir en Russie des trompettes et des timbales, des hautbois et des bassons. A chaque régiment il affecta un corps de musique, dirigé par un chef qui, en dehors de ses fonctions, était tenu de choisir, parmi les enfants de troupe, un certain nombre de sujets auxquels il devait enseigner un des instruments dont se composait la musique militaire. Au moyen de cette disposition, tous les régiments furent, en peu d’années, pourvus de musiciens recrutés dans l’armée elle-même.
Par une singularité qu’on a peine à s’expliquer, on faisait encore usage en France, au seizième siècle d’instruments à cordes pour les musiques militaires. On lit dans Brantôme qu’en 1560, à Saint-Ya, où Bonnivet était assiégé, il fit venir derrière les remparts sa bande de violons qui montaient toujours à une demi-douzaine (car il n’en estoit jamais despourveu), et les fist toujours sonner et jouer tant que l’alarme dura ; sous quel sonnet des tambours et des trompettes tout le monde tressaillit de joie. »
Au siège de Lérida, en 1647, le régiment de Champagne, précédé des vingt-quatre violons du prince de Condé, ouvrit la tranchée, en plein jour, au son des instruments. Ce vieil usage des instruments à cordes se renouvela chez les modernes tant qu’ils n’eurent pas adopté un système d’instruments mieux approprié à l’usage des troupes.
Les musiques des régiments français ne tardèrent pas à s’accroître successivement d’emprunts faits à des milices étrangères ; les Suisses fournirent l’arigot et le fifre ; les Italiens, le tambour et le basson. On doit la trompette aux Maures de la Péninsule, la cymbale et la grosse caisse aux Orientaux, la cornemuse aux Anglais, la clarinette et le hautbois à l’Allemagne. Toutefois, si nous empruntâmes aux Allemands quelques-uns de leurs instruments, il paraît que nous ne leur primes pas en même temps leur manière d’en jouer, car J.-J. Rousseau nous apprend que, dans la guerre de 1756, les paysans autrichiens et bavarois, tous musiciens-nés, ne pouvant croire que des troupes réglées eussent des instruments si faux et si détestables, prirent tous les vieux corps pour de nouvelles levées qu’ils commencèrent à mépriser. L’on ne saurait dire, ajoute-t-il, à combien de braves gens des tons faux ont coûté la vie.
Ce grand philosophe-musicien reprochait aux chefs de musique de son époque de n’avoir pas établi de distinction entre les airs de marche et les airs de parade, et de jouer des symphonies qui, n’ayant pas de rapport aux batteries de tambour, troublaient plutôt la cadence qu’ils ne la soutenaient. On peut dire que, de tous les écrivains, Rousseau est le premier qui ait approfondi ce que la musique militaire était et devait être sous le rapport de l’art. Que le goût, dit-il, en soit guerrier, sonore, quelquefois gai, quelquefois grave ; qu’elle soit bien cadencée, d’une mélodie simple ; qu’elle récrée le soldat, l’anime, se grave dans sa mémoire, l’excite à chanter trompe ses fatigues, ses souffrances, ses dangers.
Les Gaulois, qui avaient vécu avec les Romains, adoptèrent leurs instruments de guerre, comme la tuba, la cymbala, la tympana, etc., et ils se perpétuèrent jusqu’à nos jours en changeant souvent de forme, mais conservant toujours la même nature.
La chevalerie française avait des clairons qui, pour appeler aux armes on donner un signal, sonnaient la cavalguette (cavalcata). Le cor cité dans les vieux romans avait le même emploi. L’oliphant ou trompe des chevaliers servait à hucher leurs clients et à les appeler à la rescousse, comme le faisait Roland à Ronceveaux.
A cette époque, les instruments des fantassins étaient également des espèces de trompes et trompettes, et l’on vit même souvent les ménestrels ou les ménétriers suivre les armées à la guerre et se mettre à la tête des troupes. Froissart en fait souvent mention dans ses Chroniques. On lit dans le roman du Petit Saintré : « Et partirent tous premiers les tabours, et, après les ménétriers, venoient plusieurs seigneurs. »
Nous passerons sous silence la musique militaire vocale qui précéda la musique instrumentale ; elle nous conduirait beaucoup plus loin que le but que nous nous sommes proposé.
Les trompettes et les clairons n’étaient pas les seuls instruments employés ; on trouvait encore quelquefois dans les armées une cloche montée sur une espèce de châssis et transportée par un chariot. Fauchet, dans son traité de l’origine de la milice et des armes, parle d’une cloche que les Florentins portaient durant le combat et qu’ils martelaient pour encourager leurs gens.
On prétend que le tambour vint d’Espagne, où il fut importé, dans le huitième siècle, par les Maures, qui l’avaient emprunté aux Indiens. Les anciens auteurs français l’appellent tabur, tabor, tabour, tabourin. Les Anglais se sont servis du tambour et des timbales avant nous. Froissart cite ces instruments à l’occasion de l’entrée d’Édouard III dans Calais, en 1347 : « Et entrèrent dedans la ville à foison de trompettes, de tabours, de nacaires (nom primitif des timbales) et de buccines. » Le Père Benoit dit que les timbales étaient connues en Hongrie avant l’an 1457, et, dans la description qu’il trace, d’une Magnifique ambassade que Ladislas, roi de Hongrie, envoya en France pour demander en mariage madame Madeleine, fille de Charles VII, cet historien cite, à l’appui de son assertion, une ancienne chronique touchant la visite rendue à Nancy, par l’archevêque de Cologne, au chef de cette ambassade, dans laquelle se trouvent ces mots : On n’avoit ni mi oncques veu des tabourins comme de gros chaudrons, qu’ils faisoient porter sur des chevaux. »
Dans les entrées triomphales des princes, des souverains, des seigneurs et des chevaliers, dans leurs marches solennelles et même dans leurs expéditions guerrières, on voyait presque toujours intervenir des ménétriers, jouant de toutes sortes d’instruments, mais principalement du rebec.
Le fifre fait introduit dans la musique française au temps de François 1er , après la bataille de Marignan. D’autres auteurs prétendent que cet instrument était déjà en usage à l’époque de Louis XI.
Thoinot Arbeau, dans son Orchésographie, imprimée en 1589, enseigne la manière de battre du tambour et de jouer du fifre et arigot. On y lit :
« Les instruments servant à la marche guerrière sont les buccines et trompettes, litues et clérons, cors et cornets, tibies, fifres, arigots, tambours et aultres semblables, mesmement lesdicts tambours.
Le tambour des Perses (duquel usent aulcungs Allemands, le portant à l’arçon de la selle) est composé d’une demy sphère de cuyvre bouchée d’un fort parchemin d’environ deux pieds et demy de diamètre et font bruit comme d’un tonnerre quand ladicte peaul est touchée avec bastons.
« Le tambour duquel usent les François (assez cogneu par un chacun) est de bois cave, long d’environ deux pieds et demy, estoupé d’un cousté et d’aultre de peaulx de parchemin, arrestées avec deux cercles d’environ deux pieds et demy de diamètre bandées avec cordeaux affin qu’elles soient plus roides, et font un grand bruit quand lesdictes peaulx sont frappées avec deux bastons que celui qui les bat tient en ses mains.
« Le bruit de tous lesdicts instruments sert de signe et advertissement aux soldats pour déloger, se retirer, marcher, et, à la rencontre de l’ennemy, leur donne cœur, hardiesse et courage d’assaillir et se deffendre virilement et vigoureusement.
« Or, pourraient les gens de guerre marcher confusément et sans ordre, cause qu’ils seroient en péril d’estre renversés et deffaicts ; pourquoy nosdicts François ont advisé de faire marcher les rènes et jougs des escouades avec certaines mesures.
«... Le François fait servir le tambour pour tenir la mesure, suyvant laquelle les soldats doibvent marcher.
« Nous appelons le fifre une petite flûte traverse à six trouz, de laquelle usent les Allemands et Suysses, et d’aultant qu’elle est percée bien estroictement de la grosseur d’un boulet de pistolet, elle rend un son aigu. Aulcungs usent, en lieu de fifre, du flajol et flutot, nommé arigot, lequel, selon sa petitesse, a plus ou moins de trouz ; les mieux faicts ont quatre trouz devant et deux derrière, et est leur son fort éclattant. Les joueurs desdicts tambour et fifre sont appelez du nom de leurs instruments.»
Plus loin, Thoinot Arbeau parle des hautbois et fait observer que ces instruments se mariaient fort bien au tambour et au tambourin pour faire danser. Cet instrument ne s’introduisit dans la musique militaire que sous le règne de Louis XIV. Ce furent les Allemands qui nous donnèrent l’exemple de cet emploi ; on vit également paraître à peu près à la même époque, les timbales dont fut dotée chaque compagnie de la maison du roi, les mousquetaires exceptés. Les hussards et les gens d’armes eurent également des timbales. Ces instruments furent placés au même rang que les enseignes de guerre ; la perte de ces timbales était, pour une compagnie, un événement aussi malheureux que la perte de son guidon. Aussi le timbalier devait être un homme de cœur, capable de défendre son instrument au péril de sa vie. Le timbalier, comme l’enseigne, avait sa garde, qui se composait de quatre cavaliers portant la carabine haute. En temps de paix et en garnison, les timbales étaient soigneusement gardées chez le commandant, avec les étendards, et à l’armée, on les consignait de même à la garde du camp, pendant la nuit, et aux sentinelles de piquet, pendant le jour.
Sous Louis XIV, les quatre compagnies des gardes du corps avaient chacune sept trompettes et un timbalier. Il y avait par compagnie un trompette qui restait auprès du roi pour son service particulier ; on le nommait trompette des plaisirs. Il y avait aussi un cinquième timbalier qui restait également près de la personne du roi. Le service des trompettes continua à subsister jusque vers la fin du règne de Louis XVI.
Le tambour était à l’infanterie ce que le Trompette était à la cavalerie. Les dragons, qui, d’après leur institution, devaient faire le service à pied comme à cheval, avaient des tambours et même des hautbois. La compagnie des Cent-Suisses et la garde ordinaire du roi avaient trois tambours et un fifre. Chaque régiment avait un tambour-major.
On vit, en 1689, les fusiliers des montagnes, créés dans le Roussillon pour les opposer aux miquelets espagnols, se servir d’une conque pour marcher au combat. Ils avaient, dit M. Guignard dans l’École de Mars, au lieu d’un tambour, un corneur dans chaque compagnie, lequel se servait d’une grosse coquille de limaçon de mer, de sorte que, lorsque ces compagnies, qui étaient au nombre de cent, marchaient ensemble, cela formait un bruit champêtre étonnant et cependant martial.
Sous le règne de Louis XIV, la musique militaire acquit une véritable importance, et le monarque lui-même semble s’y être intéressé. Un recueil manuscrit, conservé à la bibliothèque de Versailles, contenant les batteries et les airs d’un grand nombre de marches à l’usage de l’armée française, recueil formé, en 1705 par les soins de Philidor l’aîné, ordinaire de la musique du roi et garde de sa bibliothèque musicale, prouve que cet objet avait provoqué la sollicitude du souverain, et qu’il tenait même à ce que les plus habiles musiciens attachés à son service s’en occupassent activement : aussi voit-on figurer, parmi les compositeurs qui ont signé les productions de ce recueil, les artistes les plus célèbres.
En 1670, Louis XIV rendit une ordonnance réglant les différentes batteries de tambour de l’infanterie, afin que l’on sût, lorsqu’un régiment commençait à battre, si l’armée ou tout le corps devait marcher à ce signal. Quoique le hautbois fût frappé de prescription par une ordonnance de 1613, qui supprimait son emploi, il ne cessa d’exister, et l’on voit dans le recueil manuscrit, que nous avons cité plus haut, que toutes les batteries sont accompagnées, soit par le fifre, soit par le hautbois. Les morceaux faits par Lully, par ordre du roi, pour le carrousel de la Grande-Écurie, qui eut lieu en 1686, et qui font partie du manuscrit, sont écrits pour trompettes, timbales et hautbois.
Suivant J.-J. Rousseau, les Français n’ayant, en 1750, que fort peu d’instruments de musique militaire, hors les fifres et les tambours, ne possédaient aussi qu’un fort petit nombre de marches ; encore étaient-elles très mal faites pour la plupart. « Il n’y avait, dit-il, que les troupes d’infanterie et de la cavalerie légère qui eussent des marches ; les timbales de la cavalerie n’avaient point de marches réglées, et les trompettes n’avaient qu’un ton presque uniforme et des fanfares.
L’ordonnance de 1754 consacrait également, en style noté, les batteries de caisse et leur partie musicale pour fifres et hautbois. Il parait que, dans ce temps-là, les instruments et les instrumentistes étaient fort inhabiles et jouaient excessivement faux. Depuis quelque temps, dit Laborde dans son Histoire de la musique, on a substitué, dans les musiques de régiment, la petite flûte au fifre, parce que ce dernier est bien plus faux que la petite flûte, n’ayant pas de clef comme elle. La trompette et le hautbois n’étaient pas meilleurs que les fifres. » « C’est une chose à remarquer, dit encore Rousseau, que, dans le royaume de France, il n’y a pas un seul trompette qui sonne juste, et la nation la plus guerrière de l’Europe a les instruments militaires les plus discordants. » Le même auteur fait en revanche l’éloge des musiques allemandes et atteste que, de toutes les troupes de l’Europe, celles de l’Allemagne pouvaient passer pour avoir les meilleurs instruments. Les Prussiens cependant, ne se trouvaient pas tout à fait au niveau des autres peuples de ces contrées. Au temps où écrivait Guignard, la musique d’un de leurs régiments, composés de deux bataillons, n’avait en tout que six hautbois et quatre ou six fifres, qui étaient attachés à l’état-major. Comme on imitait alors, dans les règlements de la milice française, tout ce qui se faisait en Prusse, on songeait plutôt à réprimer qu’à encourager les innovations.
Cependant plusieurs instruments nouveaux furent successivement adoptés, malgré les prescriptions officielles. On vit, dès 1741, les hulans du maréchal de Saxe, un régiment de Croates et les gardes-francaises avoir une musique avec hautbois, bassons et cimbales. Quelques-uns des régiments français ajoutèrent au fifre et aux tambours la clarinette et le cor de chasse. D’après Laborde, le serpent aurait également figuré dans le cortège instrumental des marches militaires.
Au commencement du dix-huitième siècle, la musique militaire allemande s’écrivait pour deux hautbois, deux clarinettes, deux cors et deux bassons ; plus tard, on adjoignit quelquefois une flûte ou deux trompettes, un contrebasson ou serpent. Ce fut toujours en Allemagne que l’on fut chercher les instruments et les instrumentistes pour les musiques militaires. En 1772, le roi de Portugal fit venir d’Allemagne, pour son service particulier, vingt trompettes et deux timbaliers, sous la conduite d’un chef. Les Russes furent également redevables aux Allemands des améliorations qui s’introduisirent dans leur musique de régiment.
Vers le milieu du dix-huitième siècle, on vit naître, en Russie, un genre de musique tout particulier. Cette musique, uniquement composée de cors, fut inventée, dit-on, par le maréchal Kirilowitsch, et perfectionnée par un musicien nommé Maresch, né en Bohême, et qui était alors directeur de la musique de la cour. Ce système instrumental consistait primitivement en une série de tubes droits de différentes grandeurs, qui ne donnaient chacun qu’une seule note, et qui, dans leur ensemble, formaient une étendue de trois octaves. Par conséquent, chaque exécutant devait compter des poses aussi longtemps que la note affectée à son instrument tardait à se représenter dans le courant du morceau. Le nombre de tubes qui était de trente-sept pour une étendue de trois octaves, et qui fut ensuite de quarante-neuf pour celle de quatre octaves, atteignit enfin le chiffre de soixante musiciens, donnant l’étendue de cinq octaves. L’empereur et l’impératrice entendirent cette musique, pour la première fois, au château d’Imaïlow, près Moscow, à l’occasion d’une grande chasse donnée par le maréchal. C’était l’homme réduit à l’état de machine. Représentez-vous chacun des tuyaux d’orgues animés par la bouche d’un homme, au lieu de recevoir le vent par le sommier. La mode se déclara en faveur de cette musique ; chaque grand seigneur russe voulut avoir la sienne. Un grand nombre de régiments en furent également pourvus.
En 1785, Catherine s’attacha le compositeur italien Sarti et le chargea d’organiser sa musique religieuse, composée alors d’un grand nombre de chanteurs et de cent cors russes ; mais cet orchestre ne parut pas, au compositeur, encore assez formidable, et le jour où l’on chanta un Te Deum à l’occasion de la prise d’Ochackow, il écrivit une partie pour des pièces de canon de différents calibres, placées dans la cour du château, et leur fit exécuter la basse de quelques morceaux.
Dès l’année 1764, les instruments de cuivre et ceux à anches et à clefs avaient commencé à exister légalement dans les gardes-françaises, qui comptaient seize musiciens par régiment, indépendamment des tambours et des fifres. De 1785 à 1788, l’infanterie de ligne s’empara de ces instruments. Depuis lors, les ordonnances prescrivirent aux musiques de jouer à la présentation du drapeau, de figurer aux messes militaires, aux parades, aux convois des dignitaires, aux défilements et aux entrées d’honneur.
Telle était la musique militaire lorsque arriva 1789, qui détruisit et créa tant de choses. Elle était bien faible encore ; mais nous la verrons bientôt prendre une vie nouvelle, et nous la suivrons dans tous les efforts qu’elle fera pour se débarrasser des liens dans lesquels elle s’est trouvée si longtemps enserrée.
Nous engageons les lecteurs qui désireraient de plus longs détails sur les origines de la musique militaire à consulter le savant Mémoire que M. Katsner a écrit sur ce sujet et qui fait partie de son beau Manuel de Musique militaire.
CHAPITRE IV
Fille de la musique, la facture instrumentale en a suivi toutes les vicissitudes ; elle a eu part à ses tâtonnements, à ses haltes comme à ses progrès, et son histoire se trouve comprise dans la sienne. La musique a suivi également, comme nous venons de le voir’ les diverses fluctuations du régime social.
Aventureuse dans les siècles où hommes et peuples vivent, pour ainsi dire au milieu des hasards, elle a mené une vie errante et fut frapper à la porte des manoirs : une chanson fut le paiement de cette hospitalité. Elle suivit ensuite les chevaliers qui l’entraînaient aux combats, aux tournois, aux passes d’armes, aux plaids d’amour ; et lorsque la féodalité chercha, derrière ses fossés et ses remparts, un abri contre les violentes rapacités de ses suzerains 1 elle s’enferma avec elle, et, tandis que des- gens bardés de fer veillaient aux créneaux, elle charmait la solitude d’une monotone et mélancolique existence.
La musique n’était encore, pour ainsi dire, qu’un métier ; elle était cultivée par des hommes spéciaux qui avaient un rang, une qualité, un nom, un salaire.
A mesure que les mille têtes de la féodalité se courbent et que celles de la royauté se dressent, on voit la puissance monarchique s’environner de plus de splendeur en même temps qu’elle acquiert plus d’autorité ; elle donne des fêtes, et la musique prend alors un rôle plus élevé : des écoles se fondent pour étudier cet art ; l’Église fait résonner les instruments au milieu des pompes et des cérémonies du culte. Dès cet instant, le triomphe de la musique fut certain ; mais ses jouissances n’étaient pas à la portée du grand nombre ; la musique n’avait pas cessé d’être une profession, et, dans les classes aisées, elle n’avait, pour ainsi dire, aucun adepte. Elle devint un peu plus populaire lorsqu’elle fut appliquée au théâtre ; mais elle ne tomba réellement dans le domaine des jouissances et des études publiques qu’au moment de la révolution ; la musique prit alors le vrai caractère de la popularité. Telle fut la rapidité de sa propagation, qu’aujourd’hui elle est entrée dans la vie domestique de presque toutes les classes de la société, tandis que, il y a soixante ans, elle n’était pas même dans les mœurs de toutes les classes riches.
C’est qu’aujourd’hui la liberté du travail, d’où est issue la concurrence et l’économie sans cesse progressive des moyens de production, permet au plus grand nombre de se procurer des instruments qui, par leur prix, étaient jadis le partage exclusif de l’opulence.
Dans les premiers siècles de la monarchie, il est vrai, la faculté de travailler n’était point limitée; le droit de maîtrise était inconnu ; il n’y avait point de corporation réglée.
L’établissement des maîtrises remonte aux premiers temps de la féodalité, où le besoin de résister aux exigences du pouvoir local créa les associations. Nous entendons encore, parfois, beaucoup de gens se plaindre qu’il n’en soit plus ainsi, et nous avons vu même des Facteurs redemander les anciennes maîtrises. Sans doute ces industriels n’ont jamais connu ce qu’ils regrettent ; nous croyons devoir leur en tracer l’histoire.
Au moyen âge, les faiseurs d’instruments appartenaient à plusieurs corporations, selon la matière et les outils qu’ils employaient dans la fabrication de leurs produits. Ainsi le faiseur de flûtes était de la corporation des tourneurs de bâtons de, chaises ; les luthiers se rangeaient parmi les tabletiers ; les faiseurs d’instruments de cuivre comptaient au nombre des forcetiers Ils se joignirent à ces diverses communautés pour trouver, dans la réunion de leurs forces, une garantie., contre l’oppression. Pour rendre cette garantie plus puissante, ils lui donnèrent un caractère religieux en faisant de leur communauté une confrérie ayant ses règlements, sa bannière et son patron, et ainsi se placèrent sous la protection de l’Église, qui fut merveilleusement favorable au développement de la musique, en protégeant et en encourageant les musiciens ainsi agglomérés.
En 1297, le métier de fabricant d’instruments de cuivre, tels que cors et trompettes, s’organisa, et on lit dans le Recueil des Métiers, d’Estienne Boileau, que, au mois d’août de cette année, Henri l’Escot, Guillaume d’Amiens et Roger l’anglais, tous trois faiseurs de trompes, se présentèrent devant le garde de là prévôté et lui exposèrent que, dans toute la ville de Paris, eux seuls avaient des ateliers où se fabriquaient ces sortes d’instruments ; ils demandèrent que l’exercice de leur métier fût réglé par les statuts des forcetiers et qu’ils eussent des gardes ou jurés tirés en partie de leur sein et en partie du corps des forcetiers ; requête qui fut approuvée par le prévôt de Paris.
Saint Louis, voulant encourager les arts et l’industrie, confirma les statuts des confréries, et y ajouta plusieurs articles. Les maîtres les plus distingués ayant une inspection sur les plus jeunes et les moins habiles, le roi voulut que ceux-ci fussent tenus de travailler pendant quelques années sous les yeux des maîtres et fissent preuve de capacité avant d’être admis. Ces sortes de corporations n’avaient encore rien d’exclusif ; ce n’était autre chose que des écoles ouvertes à tous ceux qui se présentaient. En 1382, le roi Charles VI, fatigué des réclamations sans nombre des diverses corporations et de l’immense quantité de procès auxquels ces réclamations donnaient lieu, abolit toutes les jurandes et maîtrises ; mais le besoin d’argent les fit rétablir en 1411. La pénurie du trésor fut la cause principale de la longue existence de bien des abus. Il fut ensuite créé un office de grand-chambrier de France, auquel on donna la haute inspection des arts et manufactures du royaume.
Henri II déclara, par les lettres-patentes datées de 1554, que les administrateurs des hôpitaux pourraient délivrer des lettres de maîtrise, sans chef-d’œuvre ni finance, à tout compagnon ayant enseigné un art ou un métier, pendant six ans, aux enfants de l’hôpital. Les corporations voulurent opposer de la résistance et même contrarier le travail des orphelins, ce qui fut le motif d’une seconde lettre-patente datée de 1578, permettant à ceux qui enseignaient les orphelins d’acheter tous les matériaux nécessaires, comme s’ils étaient maîtres assermentés, et de s’adjoindre un compagnon pour les aider et les remplacer au. besoin.
La pénurie toujours croissante du trésor public ne tarda pas à mettre à profit ces institutions, dont le but était si louable ; les communautés des arts et métiers ne furent bientôt plus considérées que comme un moyen d’impôt ou d’emprunt, par la création d’une multitude d’offices aussi onéreux aux corporations que peu profitables à l’État. En 1581, il avait été ordonné que tous les marchands, artisans et gens de métier seraient établis en corps de maîtrise et jurande, sans que personne pût s’en dispenser. On ne vit d’abord dans cet édit qu’un règlement utile ; mais on ne tarda pas à en connaître le but, car un autre édit de 1583 déclara que la permission de travailler était un droit royal et domanial ; en conséquence, on prescrivait la manière dont on pourrait travailler, le temps d’apprentissage, la forme et la qualité des chefs-d’œuvre l’administration intérieure des différents corps, qui furent classés et réglementés avec attribution de privilèges. On détermina également la forme des réceptions et les sommes à payer par les aspirants. Pour dédommager les corporations de cette nouvelle taxe, on leur accorda la permission de limiter leur nombre, d’exercer des monopoles. Le gouvernement sut également tirer avantage de cet abus par la vente qu’il fit de lettres de maîtrise, sans que les titulaires fussent tenus à faire ni preuves ni apprentissage. C’est ainsi que l’on était parvenu à dégoûter les facteurs du travail et les étrangers de nos produits. Cette décadence de l’art de la facture fut si grande, que Charles IX se vit obligé de faire construire les violons de sa musique en pays étrangers. Quand les luthiers français virent arriver les vingt-quatre violons que le roi avait fait faire par les Amati, quoiqu’ils eussent déjà, à cette époque, des ouvriers habiles, tels que les Bocquay, les Pierret, les Despons, ils reconnurent leur infériorité, se rassemblèrent, se constituèrent en corps et se donnèrent des statuts qui furent approuvés par lettres-patentes de Henri IV, au mois de juillet 1599
« Henri, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, etc., etc.
« Par notre édit de rétablissement et règlement général fait sur tous les arts, trafics, métiers et maîtrises, jurés et non jurés de ce royaume, du mois d’avril 1597, nous aurions, entre autres choses, par le quatrième article d’icelui-ci, ordonné que tous les marchands et artisans des villes, bourgs et bourgades de cedit royaume, non jurés ni encore établis en jurandes èsdites villes et faubourgs, nous paieraient la finance à laquelle ils seraient pour ce taxés en notre conseil, eu égard à la qualité dudit métier et pour être leurdit métier juré ; ce à quoi nos bien-amés et féaux les maîtres faiseurs d’instruments de musique de notredite ville de Paris, demandant de jouir dudit bénéfice et privilège, nous auraient payé, financé, au commis de la recette générale desdits deniers, a somme à laquelle ils auraient été taxés en notre conseil, comme de ce appert des quittances dudit commis y attachées, avec ledit édit, sous le contre-scel de notre chancellerie, et nous auraient très-humblement supplié et requis leur en octroyer nos lettres pour ce nécessaires ; savoir faisons que nous, voulant leur subvenir en cet endroit et faire dorénavant leur métier en bon ordre et police et obvier aux abus qui se sont commis par le passé en icelui ; avons ledit art et métier de maître faiseur d’instruments de musique, fait, créé, érigé et établi ; faisons, créons, érigeons et établissons jurés ; voulons et nous plaît que lesdits maîtres faiseurs d’instruments de musique de notre ville de Paris jouissent des privilèges, statuts et ordonnances qui suivent :
« 1. Que nul ne sera admis et reçu à tenir boutique d’instruments de musique en notre ville de Paris, qu’il ne soit reçu par deux maîtres jurés étant en charge, lesquels jurés tiendront papiers et registres de tous ceux qui seront reçus audit métier de faiseurs d’instruments de musique, et après avoir fait chef-d’œuvre et expérience, et qu’il soit apparu de leurs capacités, bonne vie et mœurs, et du temps de leur apprentissage soit fait en notre bonne ville de Paris, seront reçus desdits jurés, et, pour ce faire, feront le serment requis et accoutumé par-devant notre procureur, au Châtelet, et enregistré au greffe d’icelui pour y avoir action quand besoin sera, après toutefois leur avoir payé finance.
« 2. Les jurés seront deux ans entiers en charge ; finis et expirés, il en sera nommé et élu d’autres en leur place par la pluralité des voix de la communauté dudit métier.
« 3. Que défenses très-expresses seront faites en toutes personnes, de quelque métier, qualité et con-condition qu’elles soient, de louer boutique ni magasin desdits instruments de musique vendre ni acheter rien pour revendre et débiter en gros ou petits, de quelque sorte que ce soit, en notre ville de Paris ni ès-faubourgs d’icelle, s’ils ne sont reçus maîtres dudit métier et ayant été apprentis en ladite ville ; ainsi les pourront vendre aux maîtres et jurés du métier et ne pourront faire autrement, sous peine de confiscation desdits instruments qui seront trouvés en magasin ou exposés en vente par autres personnes que lesdits maîtres et jurés,
« 4. Qu’il ne sera fait, reçu aucun apprenti dudit métier, qu’il n’ait été obligé, six ans entiers, avec les maîtres dudit métier, et, huit, jours après que ledit brevet d’apprentissage sera passé, le maître dudit apprenti sera tenu d’apporter ledit brevet par-devers lesdits jurés pour être enregistré, afin d’éviter aux abus qui s’y pourraient commettre, n’entendant toutefois comprendre les fils de maître dudit métier à faire apprentissage ; lesquels seront reçus maîtres dudit métier par lesdits jurés, en étant par eux trouvés capables, sans toutefois faire aucun chef-d’œuvre.
« 5. Ne pourront aucuns desdits jurés et maîtres dudit métier tenir plus d’un apprenti à la fois, lequel ayant fait son apprentissage le temps et espace de quatre ans et ne lui restant plus que deux ans pour achever lesdites six années ; lesdits jurés ou maîtres dudit métier pourront, en ce cas, prendre un autre apprenti, et non autrement.
« 6. Où se trouveront aucuns desdits jurés ou maîtres avoir ouvert deux ou plus grand nombre de boutiques, seront icelles fermées incontinent et sans délai, nonobstant tout ce qu’ils pourraient dire ou alléguer pour leur défense.
« 7. Qu’où il adviendrait que quelqu’un des maîtres dudit métier vînt à décéder, leurs femmes veuves pourront tenir boutique dudit métier tout ainsi qu’ils faisaient au vivant de leurs maris, et leur sera aussi loisible de tenir ouvrier ayant été apprenti dudit métier en notre ville, et, si elles se remarient, elles seront entièrement privées de ladite franchise.
« 8. Que nul ne pourra travailler dudit métier en chambre, en notre ville de Paris, ni faubourgs d’icelle, qu’il n’ait fait apprentissage en notredite-ville de Paris et qu’il n’ait été reçu maître, ainsi qu’il est spécifié à l’art. 1er .
« 9. Que défenses sont faites à tous lesdits jurés, maîtres et compagnons dédit métier, de porter ni faire porter par quelque personne que ce soit, vendre on revendre aucuns instruments de musique par les rues de ladite ville, sous peine de confiscation d’iceux et d’amende arbitraire.
« 10. Pour le regard des marchands étrangers ou autres de ce royaume, qui apporteront des marchandises, soit instruments de musique, papiers ou autres choses servant audit métier, ne pourra icelle marchandise être achetée en gros par aucun juré on maître dudit métier, sans en avertir la communauté d’icelui ; pour ce faire, être icelle marchandise lotie et portée entre eux, et où, en cas qu’aucun dudit corps eût acheté lesdites marchandises desdits forains, sans en avertir ladite communauté, ladite marchandise sera confisquée et les détaillants condamnés en telle amende que de raison.
« 11. Pour obvier aux abus qui se pourraient commettre audit métier, les jurés d’icelui ne recevront ni admettront en. ladite maîtrise aucun qu’il n’ait fait apprentissage et ne soit expérimenté et reconnu par les maîtres capables d’icelui exercer, comme il est dit ci-dessus, encore qu’il fût pourvu de lettres de maîtrise du roi, princes et princesses, créées ou à créer par ci-après.
« 12. Pourront les jurés maîtres dudit métier faire toutes sortes d’étuits pour lesdits instruments et iceux instruments enrichir de toutes sortes de filets et marqueterie et autres choses à ce nécessaires, comme dépendant de leur métier, comme ils ont fait de tout temps, sans qu ils en puissent être empêchés par quelque personne que ce soit.
« 13. Que les compagnons dudit métier, qui désireront être maîtres d’icelui, seront reçus lorsque bon leur semblera, après toutefois avoir été apprentis de ladite ville de Paris le temps ordonné ci-dessus, en payant les droits du roi et des jurés et en faisant serment devant le procureur du roi.
« 14. Seront tenus tous les maîtres dudit métier de faiseurs d’instruments de musique de notredite ville de Paris avertir les jurés d’icelui des malversations qui se pourront commettre audit métier, à peine de l’amende arbitraire applicable où il sera ordonné.
« Pour iceux statuts et ordonnances garder et tenir, etc., etc. 1599. – 10e de notre règne. »
Là ne s’arrêtèrent pas les exigences du fisc ; il fallait de l’argent au trésor ; on ne recula devant aucun moyen pour s’en procurer : on créa des offices de jurés avec survivance, aliénables moyennant une certaine somme. La corporation des luthiers faiseurs d’instruments, en rachetant ses charges, demanda à ce que tous les faiseurs d’instruments de musique fussent soumis à la juridiction de ses jurés et obligés de prendre des lettres de maîtrises Les facteurs d’orgues, les faiseurs de flûtes et de hautbois ne voulurent pas reconnaître les droits de la corporation ; de là, plainte au roi, en son conseil, dont un arrêt ainsi conçu, intervint, le 16 novembre 1692
Sur la requête présentée au Roi, en son Conseil, par Romain Cheron et Honoré Rastoin, contenant que Sa Majesté, par les édits des mois de mars et décembre 1691, ayant créé, en titre d’office, des maîtres et gardes jurés et syndics dans les communautés d’art et métier du royaume, les suppliants auraient donné leur soumission de lever les deux offices de jurés de leur communauté à raison de 1,000 livres chacune, à condition que tous les facteurs d’orgues et facteurs d’instruments seraient réunis à ladite communauté des suppliants, laquelle soumission aurait été agréée par Sa Majesté ; ensuite de quoi et du paiement qu’ils auraient fait de la finance desdits offices, il leur en aurait. été expédié des provisions ; néanmoins, les facteurs d’orgues, les faiseurs de flûtes, hautbois et autres instruments de musique prétendent être en droit de continuer à faire leurs fonctions sans prendre la qualité de maîtres et n’être point sujets à la jurande desdits suppliants ; requéraient, à ces causes, qu’il plût à Sa Majesté de confirmer sur ce leur pouvoir.
« Vu lesdits édits, ladite soumission donnée par les suppliants, du 3 mars 1691, ensemble les provisions qui leur ont été expédiées le 8 juillet 1692 ; Ouï le rapport du sieur Phelippeau de Pontchartrain, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances, le Roi, en son conseil, a ordonné et ordonne que tous les facteurs d’orgues, faiseurs de hautbois, flûtes et tout autre instrument de musique de la ville de Paris, demeureront réunis en un seul corps de maîtrises et jurandes et seront sujets aux visites de ceux qui ont levé les offices ou de leurs successeurs, etc., etc. »
On vit naître, à cette époque, avec le monopole industriel introduit dans toute la France, une immense collection de statuts, de règlements, d’ordonnances, d’arrêts, qui, tout en paraissant vouloir protéger l’industrie, ne produisirent que des impôts, des persécutions, des procès et une multitude de syndics, de commissaires, de gardes, autant de sangsues qu’il fallait nourrir et payer. La facture instrumentale dut à Sully la modération du droit royal ; mais ce ministre conserva aux lettres de maîtrises toute leur rigidité. Depuis l’édit de 1673, qui ajouta au nombre des communautés existantes d’autres communautés jusqu’alors inconnues, jusqu’en 1720, l’industrie fut encore grevée d’une foule de charges, de droits, dont l’excès ne fut modéré que par l’impossibilité de leur donner un prétexte plausible.
La guerre qui précéda la paix de Riswich. et celle de la succession virent la création des offices se multiplier encore.
Ces offices furent vendus aux corporations, lesquelles, étant fort pauvres, furent autorisées à contracter des emprunts pour en faire les fonds.
Il fallait, outre le droit de maîtrise, payer en plus les droits de confirmation, le droit de joyeux avènement, etc. Avait-on besoin d’argent ? L’État créait des maîtrises pour chaque communauté. En 1637, il en ajouta quatre dans les communautés des joueurs et faiseurs d’instruments. A la naissance du dauphin, en 1645, le nombre des maîtrises fut encore augmenté de deux. A toutes ces exactions financières venaient se joindre les nombreux procès intentés par les autres corporations, pour cause d’empiètement sur leurs droits, toujours très-mal définis dans les lettres-patentes de création. Ainsi, en 1730, les jurés des boisseliers-souffletiers de Paris firent saisir chez un sieur Collard, facteur d’orgues, trois soufflets, déclarant que eux seuls étant souffletiers assermentés avaient le droit d’en construire ; citation devant le prévôt de Paris, qui, un an après, le 20 juillet 1731, donna gain de cause à la communauté des faiseurs d’instruments, en lui maintenant le droit où elle était de faire seule des soufflets propres aux instruments de leur profession, avec défense aux jurés boisseliers de les y inquiéter.
Les tabletiers, bientôt après, font saisir par leurs jurés, chez le nommé Lefèvre, maître savetier, neuf flûtes traversières, neuf fifres et quatre flageolets ; les luthiers demandèrent la main-levée de la saisie, et, de plus, à être maintenus dans le droit de tourner seuls, à l’exclusion des tabletiers, lesdits instruments de musique. La corporation des faiseurs d’instruments eût été condamnée, si elle n’eût représenté l’acte d’abandon de ce droit fait en leur faveur, et consenti par les tabletiers lors de la création de leur métier.
L’administration de la communauté était très-dispendieuse ; elle obligeait à beaucoup de frais, à une multitude de formes oiseuses ; les grades étaient très-subdivisés, et on n’était admis qu’avec de grandes cérémonies, en sorte que, pour avoir le droit de travailler, il fallait subir toutes les épreuves d’une espèce de franc-maçonnerie.
On ne pouvait parvenir à la charge de juré qu’après avoir été admis au grade d’ancien ; l’ancien devait avoir été, pendant un certain nombre d’années, maître moderne. Il y avait les grandes et petites jurandes, le syndicat, les gardes simples, les grandes gardes ; toutes ces distinctions étaient tarifées. La règle n’était sévère que, pour ceux qui n’achetaient pas le droit. Chacun de ces grades assurait un nouveau privilège on donnait quelque extension à ceux qu’on avait déjà ; aussi en coûtait-il souvent beaucoup plus pour parvenir aux charges que pour être reçu dans la communauté. Il fallait cependant que toutes ces dépenses trouvassent leur indemnité ; aussi les gardes, les syndics, les jurés avaient-ils des honoraires qui se percevaient sur tous les membres de la corporation.
L’apprentissage était soumis à des formalités et à des rétributions réglées. Indépendamment des droits que les maîtres exigeaient de la part de l’apprenti, il fallait que le brevet fût passé devant notaire, et qu’il fût enregistré au bureau de la communauté. Cet enregistrement était taxé ; l’apprenti payait encore les droits de cire, de chapelle, de bienvenue, du garde-juré et du clerc de la communauté. Il était soumis, pendant tout le temps de son apprentissage, à une imposition annuelle.
Les fils de maîtres étaient exempts d’apprentissage ; ils étaient compagnons de droit quand ils avaient travaillé chez leur père jusqu’à dix-sept ans ; mais tous les étrangers y étaient soumis, et on entendait par étrangers tous ceux qui n’étaient pas nés dans la communauté, ainsi le fils d’un luthier de Rouen était étranger au corps des luthiers de Paris : après avoir payé dans une ville son droit de maîtrise, si l’on voulait exercer dans une autre, il fallait recommencer son apprentissage. Une exclusion aussi singulière fixa l’attention du gouvernement ; en 1755, un arrêt du conseil voulut supprimer cette prérogative et établir une sorte de fraternité entre toutes les jurandes de la même profession ; mais on excepta de la mesure générale les villes principales, comme Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Rouen, Marseille. Ainsi le compagnon luthier de Lyon resta étranger à la communauté de Paris ou de Rouen. Dans les premiers temps, les personnes nées hors de France ne pouvaient jamais être reçues dans une corporation. « Nul ne pourra être admis, disait l’édit royal, à la maîtrise, qu’il ne soit originaire Français et né en outre notre sujet », Un Amati, un Stradivarius, malgré tout leur talent, n’auraient pu être reçus maîtres luthiers en France, même en faisant les finances exigées par les règlements de la communauté, et, de plus, le travail en chambre, dans le royaume, leur était interdit. Mais, par un édit de 1767, l’entrée fut accordée aux étrangers
Ne croyez pas que, dans la communauté, l’égalité des droits fût respectée ; il y avait de grandes distinctions même entre les aspirants à la maîtrise. La faveur n’était pas égale pour tous, les fils de maîtres. Les fils de jurés, les fils d’anciens maîtres, les fils de maîtres modernes payaient plus ou moins, selon le grade de leurs pères. Il y avait encore une différence pour les apprentis gendres de maîtres, pour ceux qui épousaient une veuve de maître, pour l’apprenti compagnon ayant fait son temps ou dispensé de faire son chef d’ouvrier ou son chef-d’œuvre. Les frais de maîtrise étaient très-multipliés ; il fallait payer l’enregistrement de la lettre de maîtrise au greffe, le droit royal, le droit de réception, le droit d’ouverture de boutique, les honoraires du doyen, des jurés, des anciens et des modernes appelés à la réception, l’huissier, le clerc, et enfin, s’il fallait être à son aise pour pouvoir devenir apprenti, il fallait être très-riche pour arriver à la maîtrise.
Nous avons retrouvé dans les Archives Impériales un carton renfermant des règlements de comptes de la corporation des faiseurs d’instruments. Nous croyons devoir reproduire les noms de ces luthiers maîtres-jurés-comptables. :
Pierre Louvet (1742), - Jean Ouvrard (1743), - Jean Galland (1744), - Robert Richard (1744), - Nicolas Lambert (1745), - Henri Lescop (1746), - Henri Hemsch (1747), - Louis Guersan (1748), - Nicolas Somer -(1749), - Jean-Baptiste l’Empereur (1750), - Jacques Bourdet (1751), - Claude Boivin (1752), - Louis Bessard (1753), - Pierre Ruelle - (1754), - Benoît Fleury (1755), - Alex. Cliquot (1756), - François Ferry (1757), - Robert Richard (1758), Jean Louvet (1759), - Jean-Baptiste Deshayes-Salomon (1760). - Guillaume Hemsch (1761), - François Gaviniés.(1762), - Benoît Fletté (1763), - François Lejeune (1764), Henri Cliquot (1765), - Joseph Gaffinot (1766), - Pierre Larue (1767), - Antoine Saint-Paul (1768), - Georges Cousineau (1769), - Thomas Lot (1770), - Joseph Moërs (1771), - Prudent Thierriot (1772), - Jean Henoc (1773), - Henri Nadermann - (1774), - Pascal Taskin (1775).
Ces luthiers-facteurs pouvaient sans doute briller par leur manière habile de construire les instruments, mais ils montraient peu de régularité dans la tenue des comptes de leur corporation, car il n’existe, dans ces trente-trois années d’exercice, un seul compte n’offrant de reliquat envers le Trésor, et chaque année vit paraître un jugement condamnant le juré-comptable à restitution.
Nous mentionnerons également une pièce assez curieuse, que nous avons rencontré dans ces cartons, qui constate le nombre de facteurs d’instruments à vent. C’est une requête présentée, en 1752, par le gendre du luthier Leclerc, demandant la main-levée d’une opposition formée à sa maîtrise par cinq maîtres luthiers, Charles Bizet, Thomas Lot, Paul Villars, Denis Vincent, Jacques Lusse, les seuls maîtres luthiers constructeurs d’instruments à vent existant et exerçant dans Paris. François Ferry, le réclamant, demandait sa maîtrise, sans être obligé, comme gendre de maître, de rapporter des lettres d’apprentissage, et il produisait des certificats constatant qu’il avait travaillé chez feu Leclerc et chez deux autres maîtres ; il offrait de faire chef-d’œuvre et proposait même un défi d’ exécution aux cinq maîtres opposants. Cette requête fut admise et le postulant reçu, malgré l’opposition.
Voilà la situation faite à la facture instrumentale jusqu’à l’édit de 1776, qui supprima les corporations. Les luths, les hautbois, les flûtes traversières, les violons, les clavecins, les orgues ne pouvaient être fabriqués que par les membres de la corporation, qui veillaient à la conservation de leurs privilèges avec d’autant plus de zèle, que leurs bénéfices paraissaient avoir été toujours très-restreints. A cette époque, ils ne pouvaient se servir que d’étain, de cuivre et de bois ; s’ils employaient l’or ou l’argent, ils étaient en querelle avec l’orfèvre ; s’ils voulaient orner leurs instruments de bois de différentes couleurs, les tabletiers leur cherchaient chicane, et les éventaillistes et les peintres agissaient de même si le facteur voulait dessiner, peindre ou vernir son ouvrage.
La détresse pécuniaire n’était pas rare parmi les membres de cette corporation, ainsi que le témoignent leurs registres. Ils payaient difficilement les tributs que les rois imposaient à toutes les corporations lors de leur avènement à la couronne ; ils déclarèrent même à Louis XV que leur pénurie les mettait dans l’impossibilité absolue de satisfaire à la demande qu’il leur avait faite en cette circonstance. Cependant la médiocrité de leurs ressources ne les empêcha jamais de se secourir mutuellement. Si, par maladie ou vieillesse, quelque facteur ne pouvait plus gagner son pain quotidien, chaque membre se cotisait d’un sol par semaine, et le plus jeune portait à l’infirme ou au malade le produit de la cotisation générale.
La communauté de faiseurs d’instruments ne manquait pas parfois, d’énergie pour soutenir ses droits, même contre les plus puissants seigneurs. Le duc de Luxembourg, gouverneur de la Normandie, voulut, à Rouen, créer deux maîtres nouveaux. La corporation en accepta un par déférence et refusa de reconnaître le second, malgré les instances, les menaces et le pouvoir du gouverneur, qui dut céder devant la résistance opiniâtre, mais légitime, de la société.
La situation des communautés resta la même jusqu’à l’année 1776, où Turgot, appréciant les entraves que cet état de choses apportait non-seulement au commerce, mais au progrès de l’industrie, qui, sans concurrence, reste stationnaire, résolut de supprimer les corporations, et il fit dire au roi, dans le préambule de l’édit du mois de mars qui établit cette suppression :
« Nous devons à tous nos sujets de leur assurer la jouissance pleine et entière de tous leurs droits ; nous devons surtout cette protection à cette classe d’hommes qui, n’ayant de propriété que leur travail et leur industrie ont d’autant plus le besoin et le droit d’employer dans toute l’étendue la seule ressource qu’ils aient de subsister..................... Dieu, en donnant à l’homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes.
« Nous ne serons pas arrêté dans cet acte de justice par la crainte qu’une foule d’artisans n’usent de la liberté rendue pour exercer le métier qu’ils ignorent et que le public ne soit inondé d’ouvrages mal fabriqués ; la liberté n’a pas produit ces fâcheux effets dans les lieux où elle a été établie depuis longtemps : les ouvriers des faubourgs et « autres lieux non privilégiés ne travaillent pas moins bien que ceux de l’intérieur de Paris. Tout le monde, d’ailleurs, sait combien la police des jurandes, quant à ce qui concerne la perfection des ouvrages, est illusoire, et que tous les membres des communautés étant portés, par l’esprit de corps, à se soutenir les uns et les autres, un particulier qui se plaint d’un mauvais produit, devant le bureau de la corporation, se voit presque toujours condamné et se lasse de poursuivre, de tribunaux en tribunaux, une justice plus dispendieuse que l’objet de la plainte......... »
Ce préambule est suivi de l’édit qui supprime les maîtrises et qui accorde liberté à toute personne d’exercer l’industrie qu’il lui plaît, mais avec obligation, à tout ouvrier construisant ou vendant, de se faire inscrire à la police. Cet édit instituait des syndics et des adjoints et attribuait la connaissance des malfaçons au lieutenant général de police.
Mais les vieux abus trouvent toujours des défenseurs, surtout quand leur abolition froisse un grand nombre d’intérêts ; aussi l’exécution de cet édit souleva-t-il une si terrible opposition, que, dès le mois d’août de la même année, parut un nouvel édit portant reconstitution des corporations des arts et métiers. Pour obvier à certains empêchements qui existaient sous le régime précédent, où une industrie était tourmentée par une autre industrie, on en réunit plusieurs en une même corporation. Les luthiers se trouvèrent compris dans la trente-septième classe d’artisans, avec les tabletiers et les éventaillistes ; ils pouvaient employer la peinture et le vernis en concurrence avec le peintre. Le droit de maîtrise était taxé à 400 livres ; il fallait payer en plus un droit de confirmation, montant au cinquième du droit de maîtrise (80 livres), et un droit de réunion, s’élevant au tiers du droit de maîtrise (133 livres).
Deux luthiers étaient attachés à la maison du roi ; ces places, données à vie, furent toujours à la nomination du prévôt de l’hôtel. Ces luthiers privilégiés pouvaient exercer leur industrie sans payer aucun droit, à l’exception de celui de réunion.
Les instruments fabriqués dans les faubourgs ne pouvaient guère s’introduire dans Paris, sans être saisis par la communauté des luthiers. Beaucoup d’ouvriers ne pouvant payer les droits de maîtrise, trop élevés pour eux, le roi, pour leur venir en aide, abaissa, pour le faubourg Saint-Antoine, le droit perçu à son profit de la moitié de celui stipulé par l’édit du mois d’août, mais sous la condition formelle que si ces maîtres venaient à s’établir dans Paris, il leur faudrait payer l’autre moitié du droit. Ce même édit leur permettait d'exercer leur industrie sans lettre de maîtrise, en se faisant inscrire sur les registres de la police et en payant, chaque année, le dixième du prix fixé pour droit de réception, confirmation et réunion (62 livres).
Ces ouvriers se trouvaient ainsi agrégés à la communauté, et s'ils voulaient, après dix ans d'agrégation, passer maîtres, ils devaient être reçus sans frais, en reproduisant les quittances annuelles de paiement et en payant alors seulement la part dès droits afférente à la communauté, c'est-à-dire le quart du droit (100 livres).
Avec les corporations, les progrès de la facture devaient être nuls, car cette industrie gémissait alors sous les entraves du monopole et d'une foule de lois, de franchises et de hiérarchies.
D'abord, les maîtres, qui seuls pouvaient fabriquer pour leur compte ; ensuite, les compagnons, qui ne parvenaient à la maîtrise qu'à force d'argent et après un long temps d'exercice ; puis enfin, les apprentis, qui payaient aussi pour arriver au compagnonnage, et n'y étaient reçus qu'en justifiant de leurs capacités par de nombreuses années de travail gratuit. Les femmes étaient exclues de la communauté. Outre ces entraves, qui rendaient la maîtrise presque inaccessible aux pauvres, le nombre des apprentis était borné, et l'entrée de la communauté était une grâce qu'il fallait acheter bien souvent, et réservée ordinairement aux fils de maîtres et de compagnons.
Les prescriptions des statuts étaient très-sévères : si un maître se permettait d'avoir plus d'un apprenti, il subissait une amende de 100 livres ; s'il prêtait son concours ou son nom à un étranger non juré, on le condamnait à une semblable amende et, en outre, à la déchéance de la maîtrise. Il y avait peine de prison, amende de 300 livres et confiscation des instruments envers ceux qui, sans qualité ni droit de maîtrise, en construisaient. Ce n'étaient pas là les seuls inconvénients du monopole : libre du débit, la communauté n'améliorait pas ses produits, et, maîtresse des prix, elle réglait elle-même le taux du salaire et le profit, des capitaux. Il en résultait un dommage immense pour le consommateur. Les maîtres-jurés chargés de veiller aux privilèges de la société, toujours préoccupés de leurs droits, semblaient plutôt avoir mission d'arrêter le travail que de l'encourager; à cet effet, les portes de chaque atelier leur étaient ouvertes à toute heure, et, pour rendre la surveillance plus facile, elles ne devaient être fermées qu'au loquet. On ne vit jamais la corporation récompenser un ouvrier habile, signaler son mérite, proclamer ses inventions, et elle se serait même bien gardée de les provoquer. Loin d'avoir favorisé le progrès de l'industrie, les jurandes ont sans cesse entravé sa marche et ralenti son activité. Il était difficile que cela fût autrement, puisque l'effet naturel de tout privilège est de borner l'émulation de celui qui en jouit et de décourager ceux qui ne peuvent pas en partager les avantages.
Les derniers signes d'existence que donna la corporation des luthiers sont de 1785, quand les maîtres-jurés voulurent faire fermer les ateliers des frères Érard, parce que, étant étrangers à la ville de Paris, alléguaient les maîtres-jurés, ces facteurs n’avaient pas le droit d’exercer leur industrie sans se faire recevoir maîtres dans la corporation des luthiers de Paris. Le roi, informé des empêchements mis à la fabrication des pianos que les frères Érard importaient à Paris, leur fit accorder un brevet qui les attachait à la cour, ce qui les dispensait de toute maîtrise et leur donnait le droit de fabriquer et de vendre.
Les corporations ne subsistèrent que de nom sous Necker, car ce ministre ferma les oreilles à leurs réclamations et laissa régner une espèce de liberté industrielle. La corporation des luthiers s’anéantit totalement lorsque, en 1789, fut décrétée l’abolition des privilégies et des maîtrises.
CHAPITRE V
Nous venons de dire quelle fut la situation politique de la facture instrumentale jusqu’en 1789 ; il nous faut maintenant jeter un coup d’œil rétrospectif sur les instrumentistes, car, nous l’avons déjà écrit, la fabrication des instruments a dû parcourir toutes les phases de leur histoire, éprouver toutes leurs vicissitudes. Pour construire des instruments, il fallut d’abord que le besoin s’en fit sentir.... Voulez-vous faire des instruments ? ayez des musiciens pour en jouer. Voulez-vous de la musique ? ayez des musiciens. Pour avoir des instrumentistes, il faut des instruments.
Chez presque tous les peuples et à plusieurs époques de l’histoire, la musique, avant d’être savante et régulière, fut traditionnelle et inspirée ; elle eut à servir les premières croyances ; elle fut d’abord l’interprète des sentiments religieux, puis elle servit ensuite aux amusements des hommes et à leurs plaisirs intellectuels. Toutes les histoires, celle des anciens peuples de l’Asie, comme celles de la Grèce, de Rome et des nations de l’Occident, nous présentent le même fait. Quant aux nations de la Gaule, on sait que la musique cultivée par les bardes avait un caractère sacré ; chargé de conserver la mémoire des belles actions, de dire la gloire des guerriers, le barde chantait dans les forêts sacrées comme les homérides chantaient sur les rivages de la Grèce.
Les chants ont offert en tous temps et en tous lieux des amusements et des consolations à l’humanité. Chez tous les peuples, à peu d’exceptions près, il exista une classe d’individus dont le devoir fut de conserver et de propager par leurs chants les événements mémorables. Les Saxons avaient leurs scaldes, et, aujourd’hui même, les habitants de la Nouvelle-Zélande ont également leurs chanteurs-historiens. Qui dit barde dit donc musicien. Du temps d’Hésiode, ils étaient, dit cet écrivain, aussi nombreux que les potiers. Les bardes faisaient partie du collège des druides ; ils ne différaient de ces derniers qu’en ce qu’ils étaient prêtres et instructeurs. D’après Ammien Marcellin, Cicéron, César, Diodore, la principale occupation du barde était de célébrer le mérite des Dieux, de chanter leurs louanges en s’accompagnant avec la harpe dans les cérémonies religieuses, dans les festins publics et réunions particulières. Les bardes musiciens composaient un des ordres les plus respectés dans les anciens pays gaulois ; ils formaient deux classes, dont une supérieure à l’autre. A la première, qui formait un des quatre ordres gradés, appartenaient les joueurs de harpe, le poëte et le chanteur ; la seconde classe se composait d’exécutants non gradés : c’étaient le flûtiste, le jugleur ou le mime, et le joueur de crouth, espèce de rebec. Les bardes étaient poëtes et musiciens.
Mais 1’union intime de la musique et de la poésie ne dura pas longtemps dans sa pureté primitive ; les musiciens devinrent très-nombreux, et, parmi eux, ceux qui n’avaient point le génie poétique se contentèrent d’accompagner le poëte au son de la harpe. Ce fut dans cette, classe que les princes choisirent ceux qu’ils menaient, en grand nombre, dans leurs pérégrinations. Athénée nommait ces chanteurs parasites.
Quand la Gaule fut soumise aux Romains, leur domination y pesa avec tant de force, que, dès les premières années de notre ère, on vit florir dans ce pays, jusqu’alors presque sauvage, les mœurs et le luxe de ces maîtres du monde. Cette révolution, néanmoins, ne descendit pas jusqu’au peuple des campagnes ; mais les villes reçurent des Romains des écoles où leur langue et leur croyance religieuse étaient publiquement enseignées. Le bardisme alors se trouva effacé comme puissance intellectuelle et religieuse ; s’il est encore quelquefois fait mention des bardes, c’est dépouillés de toutes fonctions sacerdotales et politiques, car ils appartiennent alors aux chefs qui ont le plus de richesses ou de valeur ; ils ne gardent de leurs privilèges que celui de chanter les héros morts on vainqueurs dans les combats.
Le barde devint une sorte d’officier de la maison du prince ; il n’était plus le ministre du Dieu de paix, il n’était plus l’historien sacré de la patrie, il était musicien-parasite. Ainsi déshérité, on vit le bardisme fuir la domination romaine et se réfugier loin de Lutèce, dans l’Armorique et la Germanie.
Au vieux barde gaulois succéda, dans Lutèce, le collège des instrumentistes. Les Romains avaient divisé toute la société en collèges ; ce mot signifiait, chez eux, corps, compagnie ; il y avait les collèges des augures, des artisans, des charpentiers, des potiers, des fondeurs, des serruriers, des ingénieurs, des boulangers, des joueurs d’instruments, etc. On assure que ce fut Numa qui imagina cette classification, appliquée par Rome victorieuse à toutes les nations asservies.
Le collège des instrumentistes était distingué de toutes les autres sociétés. Il faisait un corps dans l’État, avait une bourse communale, un agent pour traiter ses affaires ; il envoyait des députations aux autorités ; il faisait des règlements et des statuts qui n’avaient besoin, pour être rendus exécutoires, que d’être visés par le magistrat, comme ne contenant rien de contraire aux lois.
Le collège des instrumentistes fournissait de musiciens les temples, les demeures particulières, les places publiques ; nul n’avait le droit de se faire entendre publiquement, s’il n’était membre du collèges.
La musique n’était plus abandonnée à elle-même, à ses propres chances de ruine ou de succès. Le joueur d’instruments était alors soumis à une règle, à une tradition ; il avait des statuts qui, s’ils ne favorisaient pas les progrès de l’art, l’empêchaient du moins de dépérir. Le musicien de cette époque jouait pendant les repas, afin de calmer, dit Galien, les fureurs de l’ivresse, et, selon Homère et Plutarque, pour dissiper et tempérer la force du vin ; l’amour, alors, était le sujet favori de ses chants ; dans les réunions particulières sans festins, il chantait les aventures des divinités et les rêves de la mythologie. Dans les temples, le musicien disait les exploits des Dieux, et les joueurs de flûte étaient spécialement chargés de jouer pendant les sacrifices. Les musiciens jouissaient, dans les temples, de certains privilèges dont ils étaient fort jaloux.
En l’an 441, à Rome, sous la censure de Caïus Plantius et d’Appius Claudius, les joueurs de flûte, mécontents de ce que les derniers censeurs leur eussent enlevé le droit de prendre part aux banquets dans le temple de Jupiter, droit consacré par un antique usage, se retirèrent tous à Tibur, en sorte qu’il ne resta à Rome aucun instrumentiste. Vous figurez-vous un pareil événement ayant lieu à Paris, l’Académie Impériale de Musique, l’Opéra-Comique, les Italiens, le Théâtre-Lyrique sans orchestre ; pas le plus mince violon pour accompagner le vaudeville ; Mabile, le Château des Fleurs, la Closerie des Lilas, le Vaux-Hall, le Prado obligés de fermer leurs portes, faute de cornets à piston ; la rue, veuve de son orgue de Barbarie : un pareil événement, nous en sommes certain, causerait une si grande désolation qu’on ne saurait trop prendre de précautions pour éviter une catastrophe qui, à Rome, émut jusqu’au Sénat. On ne pouvait plus faire de sacrifices ; le taureau aux cornes dorés, le mouton entouré de guirlandes restaient sanglants entre les mains des sacrificateurs qui, le couteau tendu, attendaient les joueurs de flûte et regardaient, inquiets, les augures, qui interrogeaient avec anxiété le vol des oiseaux. Les sénateurs, mais inutilement, députèrent plusieurs d’entre eux pour inviter les instrumentistes à rentrer dans Rome ; alors un de ces pères conscrits, l’histoire n’a pas conservé le nom de cet homme inspiré, eut l’idée de s’adresser aux habitants de Tibur, pour les engager à user de tous les moyens possibles pour réintégrer en ville ces musiciens échappés. Les Tiburtains, un jour de fête, sous prétexte que la musique ajoutera à la joie de leurs festins, invitèrent, chacun séparément, un des instrumentistes le vin leur fut prodigué à un tel point, qu’ils s’endormirent profondément ; quand ils furent ainsi plongés dans le sommeil abrutissant de la boisson, on les plaça sur des chariots qui les transportèrent à Rome. Ils ne s’aperçurent de leur translation que le lendemain lorsque le jour les surprit, sortant de leur ivresse, sur les chariots abandonnés au milieu du Forum. Le peuple aussitôt s’amassa et obtint d’eux qu’ils resteraient dans Rome, où leur droit de prendre part aux banquets dans le temple, toutes les fois qu’ils joueraient dans les sacrifices, leur fut de nouveau confirmé, et on leur accorda, en outre, la permission de se promener chaque année, durant trois jours, en se livrant à la joie. Ne croyez pas que c’est un conte que nous vous faisons, c’est de l’histoire, c’est Tite-Live qui rapporte le fait. Cet événement, qui avait été mené à bien par les soins de Caius Plantius, fut regardé comme si remarquable, qu’il fut consigné sur des médailles de la famille Plautia. « Depuis cette époque, dit Valérius Maximus, le collège des joueurs de flûte ne manqua pas les occasions de se montrer au peuple sur les places, dans les fêtes publiques et particulières ; cachés sous un masque et en habit de diverses couleurs, les musiciens donnaient à la multitude des scènes et jouaient de leurs instruments. Voilà, sans doute, l’origine des concerts publics.
Comme toutes les institutions humaines, le collège des instrumentistes eut son commencement, son apogée et sa décadence. Née à Rome et transportée à Lutèce, à la suite de l’invasion romaine, cette institution subit toutes les phases du pouvoir des vainqueurs. Rome fut obligée, par la suite, d’abandonner sa conquête : l’on vit alors une foule de peuplades barbares fondre sur la Gaule et la ravager pendant dix années ; en 588, Paris devint la proie des Francs.
Pendant ce temps de troubles, la musique fut-elle cultivée ? Les monuments, les chroniques sont muets ; il faut attendre le onzième siècle pour rencontrer quelque chose de positif sur cet art ; jusque-là, l’histoire des musiciens ne présente que des individus isolés, n’ayant entre eux d’autres liens que la communauté d’une profession alors fort précaire.
Si la Gaule secoua le joug de la domination des Romains, elle en conserva cependant encore pendant longtemps le langage, les mœurs et le luxe. Cette espèce de révolution sociale, opérée par Rome, n’avait atteint que les grandes villes ; le peuple des campagnes, n’acceptant ces dons dangereux de leur civilisation qu’avec hésitation et lenteur, avait accordé au barde un asile dans sa cabane ; ce fut de cette retraite qu’il sortit quand les hordes sauvages se répandirent sur la Gaule ; avec lui on vit reparaître la musique celtique, non plus avec toutes ses aspérités, mais polie et corrigée par la civilisation romaine
Mais où trouver des traces de la musique des bardes ? Les anciens Gaulois ne nous sont guère connus que par les historiens romains. Posidonius d’Apamée, qui vivait quarante ans avant l’ère nouvelle, nous fait connaître ce qu’étaient les bardes après la domination romaine, même parmi les populations gauloises qui n’avaient que temporairement subi le joug : « Les chefs gaulois, dit-il, conduisent avec eux des compagnons de table qu’ils nomment parasites et qui chantent leurs louanges. Ces hommes récitent encore, à ceux qui veulent les entendre, la vie des guerriers illustres : on les nomme bardes ; souvent les éloges qu’ils prodiguent sont peu mérités ; mais ils n’en recevaient pas moins de grandes récompenses en or et en argent, tant ces éloges flattent ceux à qui ils sont adressés. »
La musique devait être déjà savante, dans les Gaules, au quatrième siècle, car nous savons que les livres du célèbre musicien grec-romain Aristide Quintilien, qui définit la musique l’art du beau dans les corps et dans les mouvements, y étaient très-répandus. Voici le tableau des principales divisions de la musique établies par ce maître et enseignées dans les écoles
MUSIQUE
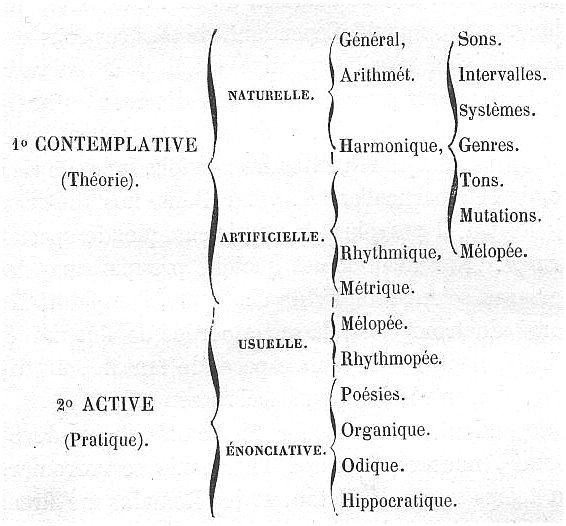
Il fallait être déjà grand musicien pour établir un art sur de semblables divisions.
Les Grecs connaissaient l’harmonie simple, si l’on en croit quelques auteurs, et ils employaient même une espèce d’harmonie figurée, au moyen de laquelle ils composaient dans les trois modes à la fois.
Athénée dit que les musiciens Sacados et Clonas furent célèbres dans ces sortes de compositions difficiles, et le même auteur cite Stratonique comme ayant inventé certains accords et donné la manière de les noter.
En recevant des Grecs la mélodie, les Romains leur empruntèrent également l’harmonie. « Ne voyez-vous pas, dit Sénèque, de combien de voix différentes un chœur est composé ? Cependant, de tous ces sons divers, il n’en résulte qu’un seul ; il y a des voix hautes, d’autres graves, d’autres médiocres ; les hommes et les femmes s’unissent, les flûtes mêlent leurs sons, tout cela se fait entendre à la fois, sans que rien domine en particulier...... Dans nos théâtres, ajoute-t-il, il y a plus de musiciens que de spectateurs..... Néanmoins, quoique presque tous les passages soient remplis de chanteurs, l’amphithéâtre garni de trompettes, la scène bordée de flûteurs et d’instrumentistes de toute espèce, de tant de sons divers, il n’en résulte qu’un accord général. »
Cependant, comme toutes les bonnes choses de ce monde, nous voyons aussi l’harmonie se corrompre au temps même de Platon, et les Romains ne firent qu’outrer encore les abus dont se plaignait déjà si vivement le philosophe grec. Bientôt cette harmonie disparut, avec le corps même de la musique, au milieu du cataclysme épouvantable qui renversa l’empire romain. Il est probable que cette science de l’harmonie fut introduite dans les Gaules par les relations qui durent s’établir entre les vainqueurs et les vaincus. Nous pensons cependant, que cette harmonie, chez les Gaulois, fut simple et peu fleurie, et qu’ils accordèrent la préférence à la mélodie qui naît sans effort, sinon toujours spontanément, de l’émotion livrée à elle-même. C’est chez les peuples modernes, dont la vie est devenue plus artificielle, plus réfléchie, que devait renaître l’harmonie avec toutes ses combinaisons savantes, avec ses effets profonds ; mais tout s’éteignit avec l’envahissement des barbares. S’il fût resté quelques vestiges de cette harmonie, ils eussent été anéantis par le fanatisme des premiers chrétiens, qui voyaient le paganisme dans tous les objets d’art ou dans toutes les combinaisons de la science. Peut-être quelques écrits sur la marche de l’harmonie grecque ou romaine seraient-ils parvenus jusqu’à nous, si Grégoire 1er n’eût employé tous ses efforts à empêcher que rien de ce qui avait été épargné par le glaive des barbares échappât à la flamme des bûchers.
On a vu semblables destructions prêtes à avoir lieu lors de la réforme de Luther. La musique fut proscrite, comme une invention infernale, par Calvin, le plus farouche réformateur de cette époque ; il fut la cause que l’on défendit à Genève les jeux, les spectacles, et que, pendant une centaine d’années, on ne -vit pas un instrument dans cette ville.
Jusqu’au moment où les peuples du Nord renversèrent la domination romaine, on aurait pu saisir, çà et là, quelques traces du bardisme gaulois et signaler les différentes fortunes que cette institution avait éprouvées ; mais aussitôt que les barbares eurent mêlé aux coutumes romaines et gauloises celles qui leur étaient propres, la confusion devint très grande. Ces peuples du Nord, ayant aussi des chanteurs nommés scaldes, qui célébraient les exploits de leurs guerriers, les bardes, ou, pour mieux dire, leurs successeurs dégénérés, se confondirent avec eux. On vit même les Gallo-Romains, adoptant l’usage de leurs vainqueurs s’attacher aussi à un maître et chanter ses louanges ; tel fut à peu près l’état de la musique dans les Gaules jusqu’à la bataille de Tolbiac, en 796, à la suite de laquelle Théodoric écrivait à Clovis : « Nous vous avons envoyé un joueur d’instruments habile dans son art, qui, joignant l’expression du visage, l’agilité des doigts à l’harmonie de la voix et du chant, pourra distraire votre grandeur. » (CASSIODORE liv. II, épit. IV.) On Voit, par, cette lettre, que l’artiste, à cette, époque, devait être à la fois mime, chanteur et instrumentiste.
Au cinquième siècle, alors même que l’art semblait, s’anéantir avec l’invasion du Nord, la société religieuse se forma avec le progrès des idées chrétiennes, elle prit le pas sur la société civile ; les monastères se fondèrent et servirent de refuge à la musique.
Les Bretons, les Normands, qui avaient donné asile aux bardes fuyant l’épée de César, nous les rendirent, plus tard, déguisés sous un autre nom.
Les jongleurs que l’on vit paraître n’étaient véritablement que des bardes auxquels on avait enlevé leur caractère, religieux, et qui ne furent plus que les biographes, les annalistes et les chanteurs mercenaires de celui qui les paya. Le jongleur joignit à l’usage de chanter les traditions historiques, la bravoure des scaldes du Nord. C’est ainsi que le premier monument littéraire, relatif aux jongleurs, nous représente ces hommes ressemblant bien plus aux scaldes du Nord qu’à ces paladins-poëtes qui égayèrent ensuite les cours féodales. Ce fut un jongleur normand, nommé Taillefer, qui se trouvait à la bataille d’Hastings au premier rang de l’armée de Guillaume.
Gaimar, poëte anglo-normand, écrit :
« Un Français se hâtant chevauche devant les autres ; on l’appelait Taillefer. C’était un jongleur hardi ; il avait des armes, un bon cheval ; il était vassal, noble et audacieux. Il se mit devant les autres et fit merveille devant les Anglais ; il prit sa lance par le bout, comme si ce fût un bâtonnet ; l’ayant jeté en l’air, il la reçut par le fer ; trois fois ainsi il jeta sa lance ; puis, à la quatrième, s’étant avancé, il la lança contre les Anglais ; l’un d’eux tomba frappé au milieu du corps. Alors Taillefer tira son épée, puis la jeta en l’air et la reçut droite par la poînte... Il s’élança contre l’ennemi, après avoir ainsi joué avec son épée ; son cheval, la bouche ouverte, se précipita contre les Anglais, qui craignaient d’être dévorés par lui. Le jongleur, s’avançant aussitôt, frappe un Anglais de son épée et lui coupe le poing ; il en frappe un second ; mais il fut mal récompensé, car les Anglais l’assaillirent de tous côtés et lui lancèrent javelots et dards ; ils le tuèrent, ainsi que son cheval. » (GEOFFROY GAIMAR, Chroniques anglo-normandes, publiées par F. MICHEL.)
Voilà bien le scalde chantant la gloire et le courage des guerriers morts et donnant, en tombant au premier rang, l’exemple de ce courage qu’il exhalte par ses chants. On pourrait encore citer bien des noms de jongleurs guerriers attachés à la personne des princes ; on voit Berdic remplacer Taillefer auprès de Guillaume le Conquérant, et Turod donner la plus ancienne version du poëme de Roncevaux, elle fut publiée, en 1837, par F. Michel, et se termine par ce vers :
Ci finit le chant que Turod chantait.
Ce point de contact entre les scaldes et les premiers jongleurs du Nord est, de plus, un premier point de dissemblance entre ceux-ci et les troubadours et leurs jongleurs.
Les troubadours ont pu écrire quelques chansons de geste ; mais ni eux ni les jongleurs qui les accompagnaient ne chantaient avant le combat, comme Bardic et Taillefer. C’est là un usage qui appartient aux anciennes populations du nord de la France, et qui les sépare de celles du Midi.
On confond communément, sous le titre de trouvères, deux classes bien distinctes : le trouvère était conteur et ménestrel, c’est-à-dire qu’il composait des vers et les chantait, et le jongleur, à ce double talent, joignait celui de s’accompagner d’un instrument de musique ; il faisait, en outre, des tours d’adresse, il amusait les yeux, en même temps qu’il flattait l’oreille ; rarement le même homme possédait ces industries, et c’est au désir de pouvoir les exercer ensemble qu’il faut, sans doute attribuer l’origine des associations que ces hommes faisaient entre eux associations que les mœurs dissolues, l’esprit railleur, indépendant et hardi de ceux qui les composaient rendirent dangereuses et qui furent, à différentes époques poursuivies par les lois ecclésiastiques et civiles. Ces associations paraissent avoir existé dès les premiers temps de la monarchie, car Sidoine Appolinaire en parle dans la description qu’il fait de la table de Théodoric II, et il loue beaucoup ce monarque de ce qu’il se donne rarement ce plaisir.
Les jongleurs ne furent ni tranquilles ni paisibles possesseurs du droit de chanter, et les conciles des premiers siècles portèrent des lois contre eux. Charlemagne, dans l’article 44 du premier Capitulaire d’Aix-la-Chapelle, de l’année 789, parle des jongleurs comme de gens notés d’infamie, et il leur refuse le droit d’accuser. Par l’article 15 du troisième Capitulaire, il défend aux évêques et abbesses de recevoir chez eux les jongleurs. Ces ordonnances, ces défenses, renouvelées plus tard furent, à ce qu’il parait, fort mal observées, car Agobard, archevêque de Lyon, mort en 840, se plaint de ce que les jongleurs étaient admis dans les repas : « Les évêques, et les abbés, dit-il, en avaient à leur service ; des prêtres et des moines faisaient même quelquefois ce métier. » Jusqu’à l’édit de Philippe-Auguste, qui bannit les jongleurs de son royaume, les lois civiles et religieuses furent impuissantes, et, même, après cet édit de proscription, ces bardes furent toujours bien accueillis ; il n’y eut pas de bonne cour plénière sans eux ; pas une cérémonie chevaleresque, par un grand repas dans lesquels ne figurassent ces amis de la joie, ces gais colporteurs de chansons.
Ce n’était pas le seul genre de poésie que ces hommes chantaient aux bourgeois des villes et aux manants assemblés, : après la légende, venait souvent le conte malin, satirique, presque toujours grivois ; on réservait, pour les châteaux, l’histoire plus élevée, plus noble des paladins, de leurs actions vraies ou fausses. Ces chanteurs-musiciens étaient traités avec munificence : une chaîne d’or, une coupe précieuse, un cheval de prix, une robe en brocart d’or ou de soie garnie de fourrure étaient presque toujours leur récompense.
Un petit poëme du treizième siècle nous fait connaître tous les talents Physiques, toutes les connaissances et tous les instruments qu’un trouvère-jongleur devait posséder. Cette petite pièce est intitulée : les Deux Bordéors ou Trovéors vibans. C’est une querelle entre deux de ces hommes ; chacun s’efforce de prouver sa supériorité. Le premier commence ainsi :
« Diva, laisse donc là ta jonglerie ; va t’asseoir dans ce coin, car nous n’avons pas besoin de toi, et il faut que celui qui ne sait rien dire d’agréable sache du moins garder le silence. Tu ne sais pas vaillant deux fétus !... Voyez comme il est vêtu avec le gage d’une année ! voyez quels souliers de Cordoue ! Admirez les belles chaussures de Bruges !...voyez comme il est enveloppé dans de méchants habits !.... Tu n’es pas ménestrel, ni ouvrier de bonne œuvre ; tu ressembles à un vilain bouvier aussi contrefait qu’un bœuf, ou bien à un meneur d’aveugle. Moi, au contraire, je sais aussi bien conter en français : qu’en latin, la nuit comme le jour, devant les comtes et les ducs, et je sais faire plus encore : quand je suis à une cour et à une fête, je sais bien des chansons de geste ; il n’y a pas un chanteur tel que moi... ». Le jongleur fait une longue énumération de toutes les chansons et de tous les poëmes qu’il connaît. A ces détails il en ajoute une foule d’autres facétieux, burlesques, destinés à exciter le rire : « Je suis, dit-il, bon saigneur de chats et tondeur de bœufs. Je sais bien cercler un œuf et je sais faire frein à vaches, gants à chiens, coiffes à chèvres, hauberts à lièvres, et si bons qu’ils n’ont plus peur des chiens. »
Son adversaire ne fait pas attendre sa réponse :
« Tu nous as bien dit tout ce que tu as voulu, reprend-il ; mais je ferai apercevoir que j’en sais bien, plus que toi et que je suis meilleur ménestrel. Je te dirai ce que je sais faire : je suis joueur de flûte, de vielle, de cornemuse, de violon, de harpe, de chiphonie, de psaltérion, et je connais maintes chansons... Je peux bien faire un enchantement, et j’en sais plus long qu’on ne pense., Quand je veux m’y appliquer, je lis, je chante comme un clerc ; je parle des chevaleries, des hommes brayes, et je sais bien dire quelles sont les armoiries. » Il nomme également à son adversaire toutes les chansons qu’il peut chanter, et termine ainsi en disant à l’assemblée : «
A toz ge vos requier et prie
Que le metez fors de céanz,
Qui bien pert que c’est un noiens,
« Je vous requiers et vous prie tous que le mettez dehors car il est certain que c’est un homme inutile. » On le voit, au talent de chanter, les jongleurs joignaient le rôle de bouffon ; on leur permettait et on leur pardonnait leurs satires mordantes et leurs réponses hardies.
Les trouvères, ainsi que les ménestrels, étaient presque tous jongleurs, joueurs d’instruments ou chanteurs. ; tel était Adénès, ménestrel du duc de Brabant ; mais bientôt la rivalité s’établit entre les trouvères, les ménestrels et les jongleurs, presque tous attachés à des seigneurs puissants. Les premiers se plaignaient d’abord de l’ignorance et de la mauvaise foi des jongleurs indépendants. Il paraît que, dès ce temps-là, la contrefaçon existait déjà, car ils ajoutaient ensuite, contre les jongleurs, qu’ils s’emparaient des anciens récits sans bien les connaître, et y ajoutaient des circonstances mensongères : « Ces jongleurs, qui ne savent pas rimer, dit Adénès dans son poëme OGER LE DANOIS, ont altéré le poëme en plusieurs endroits ; ils ne savent pas bien mettre en ordre les récits d’amour, d’armes ou d’honneur, ni en bien distribuer les matières, car celui qui veut mettre l’histoire en rime doit accorder la mesure avec le sens. » Ce reproche pouvait être également adressé aux trouvères, aux conteurs ou ménestrels, qui. tous employaient ce même moyen pour donner à leurs chants un air de nouveauté ; mais les poëtes ne purent résister aux musiciens, et on vit les trouvères s’effacer peu à peu et les ménestrels se confondre avec les jongleurs et les ménestreux.
Vers la fin du treizième, siècle, les jongleurs et les ménestrels furent soumis à un règlement de police, qui fut promulgué sous Saint Louis. Ces statuts, empreints de toute la modération du pieux roi, réglaient, avec une sage sévérité, la conduite que ces hommes devaient tenir à Paris ; du reste, quelques privilèges leur étaient accordés ; ils étaient même exempts du droit de péage en passant sur les ponts : « Et aussitôt les jongleurs sont quite par un ver de chançon. » A la fin également de ce même siècle, on vit les jongleurs donner leur nom à une rue de Paris, la rue aux Jugleurs, qui, plus tard, fut appelée rue des Ménestriers, quand ce dernier nom prévalut et remplaça le premier pour désigner un musicien.
A cette époque, la musique particulière des rois existait déjà ; les ménestriers occupaient à la cour des positions honorables et lucratives.
Dans une constitution de l’année 1337, pour la création d’un corps de musique dans son palais, rapportée par M. Mabillon, Jacques II roi de Maïorque, dit : « Il peut y avoir licitement, ainsi que l’apprend l’antiquité, des mimes ou des jongleurs, dans les maisons des princes, vu que leur office fait naître la joie, que les princes doivent rechercher par-dessus tout, et maintient honnêtement autour d’eux ceux qui les entourent ; ils échappent par ce moyen à tout accès de tristesse et de colère et se montrent plus gracieux envers leurs sujets. »
Il est important maintenant de constater quels étaient les instruments dont se servaient les jongleurs ou les ménétriers, car nous verrons encore pendant quelque temps les deux noms employés indifféremment, puis le second remplacer entièrement le premier. Dans les comptes du ménage du comte de Poitiers, Philippe le Long, on trouve portés : Raoulin de Saint-Vérin ménestrel du cor sarrasinois ; Andrieux et Bernart, trompeurs ; Parisot, ménestrel de naquaires ou timbales ; Bernard, ménestrel de trompettes. Sous le roi Louis X, on trouve, au nombre des musiciens, composant, en 1315, son corps de musique, Guillotus, menestre1 de psaltérion. Les musiciens des rois ou des princes avaient droit aux distributions de vêtements faites, au nom du prince, aux gens de sa maison ; et ils avaient également bouche à la cour, c’est-à-dire qu’ils recevaient les vivres, aux principales fêtes : ménestreux mangants à cour, dit un règlement de l’hôtel, donné, en 1377, par Philippe le Long. Nous trouvons enfin une définition du titre de ménestreux dans un compte de l’hôtel de Jean, duc de Normandie, en 1349 ; ce sont ceux qui jouent des naquaires ou timbales, du demy canon ou petite flûte, du cornet, de la guiterne ou guitare latine, de la flûte behaigne ou bohémienne, de la trompette, de la guiterne moresche ou guitare mauresque, et de la vielle on violon à trois cordes.
Nous avons vu un nom nouveau se poser à côté de celui de jongleurs ; c’est celui de ménestreux, mênestreux, ménestreur, ménestrel, ménétrier ; du latin menestrellus, menistrellus, ministellus, diminutif de minister, c’est-à-dire petit officier, officier inférieur ; titre d’honneur accordé, d’abord, exclusivement aux musiciens attachés, soit aux rois, soit aux princes, et que prirent ensuite tous les gens exerçant la profession de joueurs d’instruments. (BERNHARD, Histoire des Ménestriers de Paris.) Le nombre des musiciens augmentant chaque jour, et les instrumentistes d’origine étrangère venant chercher fortune dans la capitale, tous résolurent d’un commun accord de régulariser l’exercice de leur profession.
Le 14 septembre 1321, trente-sept jongleurs et jongleresses, à la tête desquels était Pariset (ménestrel le Roy), musicien du roi, présentèrent au prévôt de Paris un projet de règlement qui fut approuvé en ces termes par Gilles Haquin, garde de la prévôté. : « A l’accord du commun des ménestreux et ménestrelles, jongleurs et jongleresses, demeurant en la ville de Paris, dont les noms sont ci-dessus escripts, pour la reformacion du mestier et le proufit commun. » Il fut établi plusieurs articles, que les intéressés ont déclaré, par serment, devoir être profitables aux métiers. Nous pensons qu’il est inutile de transcrire ce règlement qui se trouve rapporté dans plusieurs recueils.
Nous croyons cependant qu’il n’est pas superflu de faire connaître les premiers membres de cette association : Pariset, musicien du roi ; Gervaisot, garde du gué ; Renaut, marchand de châtaignes ; Jehan, garde du Louvre ; Jehan de Beaumont ; Jehan Guérin, Thibaut le Page, Jehannot de Chaumont, Jehan de Beauvais, Thibaut de Chaumont, Jehanot l’anglais, Huet le Lorrain, Jehan Balcaraine, Guillot le Bourguignon, Perrot le Baigneur, Jehan des Champs, Alexandre de Beauvais, Jaucon, fils de Le Moine ; Jehan Coquelet, Jehan Petit, Michel de Douay, Raoul de Béverlé, Thomassin Roussiau, Geiffroy, garde du gué ; Vynot le Bourguignon, Guillaume de Laudas, Raoulin Lanchart, Olivier, le Bourguignon, Isabelle la Rousse, Marcelle la Chartaine, Liegard, la femme à Bienveignant ; Marguerite, la femme à Le Moine ; Jehane la Fripière, Alisson, la femme à Guillot-Guérin ; Adeline, la femme de Jehanot l’Anglais ; Isabiau la Lorraine. (ÉTIENNE BOILEAU, Établissement des métiers de Paris.)
On voit par ces signatures que le métier de ménétrier ne devait pas être très productif et que, pour vivre, plusieurs d’entre les signataires avaient un autre état. Ainsi Gervaisot, Jehan, Geiffroy étaient gardes du gué ou du Louvre ; Renaut était marchand de châtaignes ; Perrot, baigneur, et Jehane, fripière, etc.
Le chef de la société s’appelait prévost de Saint-Julien, et les jurés, prud’hommes ; ils étaient élus chaque année par la réunion de tous les intéressés. Jusqu’en 1691, ces jurés furent au nombre de trois. Les ménétriers voulurent alors plus qu’une société sans caisse et sans asile : deux d’entre eux fondèrent un hospice sous l’invocation de saint Julien et de saint Geniès. On vit figurer, dans le procès-verbal de nomination des administrateurs dudit hospice, Jehan le Vidaulx (joueur de vielle), Guillaume de la Guiterne (joueur de guitare), Henriet de Mordidier, et Guillaume Ami, joueurs de flûte.
Par la fondation de cet hospice et par leur réunion en communauté, les musiciens acquirent une véritable importance comme communauté-propriétaire et se trouvèrent ainsi liés entre eux par un lien permanent et durable, celui de la conservation et de la bonne administration de la chose commune. L’organisation qu’adoptèrent les joueurs d’instruments, en 1321, donna tout son développement à l’institution du roi des ménétriers. Nous avons vu que, dans le principe, le chef se nommait prévôt de Saint-Julien et que la charge était élective ; plus tard, les ménétriers cherchèrent un appui à la cour pour leur société naissante, et comme leur intermédiaire naturel était le musicien du roi, qui avait alors le nom de roi, ils finirent par le reconnaître pour chef et le chargèrent de tous leurs intérêts. D’une charge domestique, la communauté fit un office préposé à la police générale du jeu des instruments ayant pour fonctions principales, comme on le verra plus tard, le jugement d’aptitude à la maîtrise.
Le titre de roi n’était pas nouveau parmi les instrumentistes ; en 1296, Philippe le Bel avait accordé le titre de roi des jongleurs, dans la ville de Troyes, à un Jean Charmillon ; sous le même prince, il y avait eu également des rois des flûteurs ; ils étaient officiers de la maison du roi et placés à la tête du corps de musique de la cour.
La première charte qui nous fait connaître un roi des ménestrels, institution qui joue un si grand rôle dans l’histoire de cette corporation, est de l’année 1338 ; elle commence ainsi : Je, Robert Caveron, roi des ménestrels. La royauté n’était pas une charge élective ; mais, étant un office de la maison du roi et conféré par lui, cette royauté fut toujours confiée à un musicien de la cour. On ne connaît guère la liste exacte de ceux qui furent revêtus de cette dignité ; mais les lettres-patentes accordées, en 1747, au dernier chef de la corporation, mentionnent un grand nombre de nominations, et un mémoire, publié en 1773 par cette communauté, prouve qu’il existe encore dans les archives quinze lettres présentes à ce sujet.
La corporation des ménestriers célébrait, le jour de l’Épiphanie, une fête qui avait beaucoup d’analogie avec les processions des collèges d’instrumentistes usités anciennement à Rome, et même, en 1367, on vit le roi Charles V payer d’une assez forte somme d’argent une couronne destinée à être donnée en cadeau au roi des ménestrels, le jour de la Tiphanie.
A cette époque, le poëte de cour avait fait déjà place au chanteur des rues ; on les nommait ménestrels de bouche. Alors, comme dans les siècles précédents, le ménétrier joignait ordinairement la musique vocale à la musique instrumentale ; non content de faire danser aux fêtes et aux noces, il chantait encore pour multiplier ses profits. Les documents du quatorzième siècle parlent fréquemment des ménestrels de bouche. Sans doute, au moment où s’organisa la corporation, cette branche d’industrie n’était plus ce qu’elle avait été avant l’époque précédente ; véritables rapsodes, les ménestriers apparaissaient comme les dépositaires de toutes les légendes et de toutes les traditions nationales.
Avec les chansons de geste s’introduisit, sans doute, la grande chanson politique et historique, et si, en 1372, il leur fut défendu de donner des sérénades pendant la nuit, le 14 septembre 1395, il fut publié à son de trompe, toujours de par le roi et M. le prévôt, « défense, sous peine d’amende arbitraire et de prison au pain et à l’eau, à tous ménestriers de bouches, de chants et de ditz, et ne facent, dysent, ne chantent, en place ni ailleurs, aucuns ditz, rymes ni chansons qui facent mention du pape, du roy et des seigneurs de France en regard de ce qui touche le fait de l’union de l’Église, ou les voyages que ils ont faits ou feront pour cause de ce. »
Les ménétriers présentèrent une requête au roi Charles VI, en 1417, demandant l’approbation de leurs statuts, ce qui leur fut accordé. Le roi exposa, dans les préambules des lettres de confirmation de ces statuts, la raison qu’avait fait valoir auprès de lui le roi des ménestriers : « Nous avons reçu l’humble supplication du roy des ménestriers et des autres ménestriers joueurs d’instrumens tant haulx que bas (c’est-à-dire joueurs des dessus et des basses des divers instruments) en la ville et diocèse de Paris et des autres de notre royaume, contenant règlement pour leur science de ménestrandises, faire et entretenir selon certaines ordonnances par eulx autrefois faistes, et qui, en temps passé estoient accoutumé de faire, et par l’advis et délibération d’eulx et de la plus grant et saine partie d’entre eulx eussent, et ayant fait certaines instruccions et ordonnances dont la connaissance des amendes qui y celles enfraindroit en aucune manière, en tant qu’il touche y celle science, appartiendrait moitié à l’opital Saint-Julien et audit roy des ménestriers, et que pour tous ménestriels, tant pour de haulx instrumens comme de bas, soient étrangers ou de notre royaume, sont et seront tenus de aler par devers ledit roy des Ménestriers ou ses députés pour faire serment d’accomplir et parfaire toutes les choses cy après déclarées, à peine de 20 sols d’amende, moitié à nous à appliquer, et l’autre audit opital de Saint-Julien et au roy des ménestriers, pour chacun article qu’ils seront trouvés faisant le contraire, sauf le congé dudit roy ou de ses députés. » Pendant le quinzième, le seizième et une partie du dix-septième siècle, ce règlement fut la loi des ménétriers il fut successivement confirmé par Charles VII, ; le 2 mai 1454 ; par Louis XI, au mois de septembre 1480 ; par Charles VIII, en 1485 ; par Louis XII, en 1499 ; par François 1er , en 1514, et de nouveau, par le même roi, en 1545, par Henri III, en 1576.
D’après l’ancien règlement, les ménétriers étrangers à la ville de Paris ne se trouvaient soumis à la juridiction du prévôt de Saint-Julien qu’en venant exercer dans cette ville ; mais les choses ne tardèrent pas à changer ; l’idée de prééminence attachée au titre de roi et aux offices de la cour créa une véritable suprématie : ce roi ne trouva pas d’abord son royaume assez étendu et chercha, par tous les moyens, à en étendre les bornes ; on le voit combattre sans relâche pour monopoliser, à son profit, la police des musiciens de tout le royaume.
Le premier roi portait, d’après la charte, le titre de roi des ménétriers ; mais bientôt il ajouta à ce titre simple les mots du royaume de France ; il fit confirmer ce titre, ainsi amplifié, par les lettres-patentes approbatives du règlement de 1407, et le règlement de 1658, en proclamant un état de choses établi depuis longtemps, confirma ainsi le droit qu’avait le roi des ménétriers de se nommer des lieutenants dam toutes les villes du royaume.
Les musiciens de la province s’organisèrent également en corporations ; nous avons déjà vu ceux de Rouen se réunir, ceux d’Amiens s’organisèrent en 1461, ceux d’Orléans en 1500, ceux d’Abbeville en 1614, ceux de Bordeaux en 1621, ceux de Blois en 1568.
A dater du milieu du quinzième siècle, une révolution s’opéra dans la musique, et les progrès de l’art influèrent sur la corporation des joueurs d’instruments. On a déjà vu, à la fin du treizième siècle, des ménestrels figurer dans la maison des rois et y jouir des privilèges d’officiers domestiques et commensaux du palais. Bornés d’abord à un petit nombre d’exécutants, on les augmenta avec François 1er. Sous le règne de ce monarque, la musique fut partagée en deux corps distincts : celui des musiciens de la chambre, formé de chanteurs et de symphonistes jouant la harpe, le luth, la viole, l’orgue, l’épinette, et admis dans l’intérieur des appartements, et la bande dite de l’écurie, composée de violons, hautbois, saquebuttes, cornets, musettes, trompettes, fifres et tambours, et ainsi nommée parce que les membres faisaient partie des officiers de l’écurie. A ces deux corps il en fut ajouté postérieurement un autre, composé d’abord de vingt-quatre violons, puis ensuite de vingt-cinq violons, connu sous la dénomination de la grande bande des vingt-quatre violons de la chambre du roi, dont les fonctions étaient de jouer dans l’antichambre pendant le dîner du roi et de faire danser aux bals de la cour. Tous ces instrumentistes étaient tenus de se faire agréger à la corporation des ménétriers.
Quoique l’instruction et le savoir fussent généralement peu répandus dans la corporation, cependant il s’y rencontrait parfois des gens de grand talent, qui parcouraient les provinces et y faisaient métier, ce qui leur procurait de riches gratifications et de beaux présents.
La corporation gagnait chaque jour en importance : dans le règlement pour les droits royaux de maîtrise, rendu, au mois de décembre 1581 et 1597, par les rois Henri III et Henri IV, on trouve une liste des métiers exercés dans le royaume. Ces métiers sont divisés en cinq classes : 1° ceux qui sont appelés les meilleurs ; 2° ceux qui sont entre les meilleurs et les médiocres ; 3° les médiocres ; 4° ceux qui sont entre les médiocres et les petits ; 5° les petits. Les joueurs d’instruments sont rangés dans la troisième classe.
A l’instar de ce qui se passait en Italie, les ménétriers, comme nous l’avons déjà dit, se réunissaient, la nuit, pour exécuter des sérénades. C’était surtout dans la nuit de la fête de Saint-Julien que ces réunions avaient le plus d’éclat. Les membres de la corporation et, entre autres, les vingt-quatre violons de la chambre, parcouraient alors la ville en exécutant des airs joyeux composés pour la circonstance. Voici ce qu’on lit dans un recueil de ballets fait en 1600 par Michel Henry, un des vingt-quatre violons :
« 1587. Sept airs sonnez, la nuit de la Saint-Julien, par nous Chevalier, Lore, Henry Lainé, Lamotte, Kichaires et autres, et furent sonnez sur luths, épinettes, mandores, violons, flûtes à neuf trous, tambour de biscaye, l’arigaux, le tout bien d’accord et allant et sonnant parmi la ville. Moi, Michel Henry, je fis la pluspart des dessus, les parties, n’estoient que cinq, par feu M. Planson, et du depuis M. Chevalier a fait la quinte.
« 1603. Les airs qui ont esté sonnez la nuit de la « Saint-Julien, estant mes compagnons : M. Lore, Chevalier, Mechaine et autres, dont j’ai fait les premiers dessus, et M. Fransigne, les parties à six par deux dessus, haute-contre, taille, quinte et basse ; mesure de bourrée, ensuite pleine mesure. »
Les promenades s’étant par trop multipliées, le parlement fut obligé d’intervenir, et, en 1595, défenses furent faites à toutes personnes de s’assembler et aller en troupes par les rues, y porter luths, mandoles et autres instruments de musique, et, sur quelque prétexte que ce soit, aller de nuit, à peine de la hart. »
Les musiciens de la grande bande étaient reçus maîtres, sur la simple présentation de leur brevet de nomination dans la bande, et ne payaient qu’un droit fort minime, mais à la condition de ne faire aucun exercice de leur art, moyennant salaire, en dehors de la cour, et notamment de donner des leçons de danse. En 1577, quatre violons de cette grande bande contrevinrent à cette prescription et furent condamnés au Châtelet. Le substitut du procureur du roi leur fit défense, en 1619, d’enseigner à danser ; les intéressés en appelèrent ; mais le grand conseil confirma la défense du procureur royal. Il y eut encore des récalcitrants qui s’obstinèrent à ne pas reconnaître la suzeraineté du roi des ménétriers ; mais il fut rendu plusieurs arrêts, tous en faveur de la corporation. En 1628, une sentence du lieutenant civil fit défense à tous musiciens de jouer des instruments sans avoir, au préalable, fait apprentissage pendant six années et expérience devant le roi, notamment du violon, mais seulement du rebec, c’est-à-dire du violon à trois cordes, le tout sous peine de prison, de 24 livres d’amende et de la saisie des instruments.
Cette sentence n’ayant pas suffi pour rétablir, le bon ordre, et comme on continuait à jouer du violon dans les cabarets et les guinguettes, le roi des ménétriers s’adressa de nouveau à l’autorité et porta une plainte nouvelle au Châtelet, et, en 1638, fut rendu un arrêt du parlement portant défense, sous les peines précédemment prononcées, à tous ménétriers non reçus maîtres, d’entreprendre à l’avenir sur l’exercice des joueurs d’instruments de musique et de jouer D’AUTRES VIOLONS que le rebec.
Cependant la corporation ne se contenta plus des anciennes taxes, et elle ne les trouvait plus en harmonie avec le développement qu’avaient pris l’industrie instrumentale et la richesse publique. Dumanoir (Guillaume), violon de la chambre du roi Louis XIV, dressa de nouveaux statuts qui furent approuvés, en 1659, par lettres-patentes du roi.
Le roi avait établi, en 1661, par lettres-patentes, une académie de danse et déclarait que l’art de la danse serait désormais exempt de toute maîtrise. Dumanoir, chef de la corporation des ménétriers, Comprit qu’il y allait de l’existence de la société, et, en 1662, il s’opposa à l’enregistrement de ces lettres-patentes. De là un long procès où chaque partie intéressée produisit des factum, dans lesquels Molière s’inspira pour faire la scène du maître à danser et du maître de musique dans le Bourgeois Gentilhomme.
Voici le titre des deux principaux Mémoires auxquels nous renvoyons les lecteurs.
Établissement de l’Académie royale de danse en la ville de Paris, avec un discours académique, pour prouver que la danse, dans sa plus noble partie, n’a pas besoin de musique et qu’elle est tout absolument indépendante du violon. (Paris, Pierre Le Petit, 1663, in-4°.)
Factum pour Guillaume Dumanoir, joueur de violon du cabinet de Sa Majesté, l’un des vingt-cinq de la grande bande, et muni aussi de l’office du roi des joueurs d’instruments et des maîtres à danser de France, et suivi du mariage de la musique avec la danse, contenant la réponse au livre des treize prétendus académiciens touchant ces deux arts. (Guillaume de Luyne, 1664, in-18.)
Un arrêt du parlement statuant sur l’opposition formée contre l’enregistrement, qui avait déjà eu lieu, mit simplement les parties hors de cour et de procès.
Le fils de Dumanoir, succédant à son père, voulut signaler son règne par un coup d’éclat. Il attaqua l’Académie Royale de Musique, que le roi venait de créer, et prétendit que les musiciens de son orchestre devaient prendre des lettres de maîtrise dans la communauté. Lully présenta requête au conseil contre ces prétentions, et un arrêt de 1673 décida que les musiciens attachés à l’Académie étaient autorisés à jouer partout où ils seraient appelés, à prendre le salaire qui leur serait payé, et fit défense à la communauté, sous peine d’amende, de les troubler dans leurs privilèges.
Cet échec fut le prélude de bien d’autres désastres, dont la royauté de Dumanoir II fut témoin. Ce monarque malheureux abdiqua enfin volontairement sa couronne en 1638, ne conservant que son titre honorifique de roi des ménétriers. La corporation, sans chef, se dirigea elle-même ; mais il y eut tant de dissensions qu’elle finit par tomber dans un discrédit complet. Louis XIV, en 1691, sous le prétexte d’abolir les brigues et cabales qui avaient lieu dans l’élection des jurés et de réformer la police des corps et métiers, mais en réalité afin de faire entrer de l’argent dans le trésor par la vente de nouvelles charges, supprima toutes les élections des jurés et convertit ces offices en titre d’offices héréditaires et vénaux. En conséquence, il y eut quatre offices de jurés acquis dans la communauté des joueurs d’instruments, moyennant une somme de 18,000 francs par quatre maîtres, les nommés Thomas Duchesne, Vincent Péyant et Jean Aubert, tous trois violons de la chambre, et Jean Godefroy, maître de danse. Jusqu’à la mort de Dumanoir, la communauté fut administrée par elle-même ; mais, en 1697, un arrêt du conseil supprima la charge de roi des ménétriers, comme inutile depuis l’établissement des nouveaux jurés. Ainsi s’anéantit cette charge et celle du vingt-cinquième violon de la grande bande, qui était spécialement attaché à l’office du roi des ménétriers.
Profondément attaquée chaque jour dans sa constitution, la corporation marcha toujours d’échecs en échecs. A la suite de leurs titres de jurés de la communauté des maîtres à danser et joueurs d’instruments, on avait ajouté : et des hautbois, parce que, précédemment, ces instruments avaient été exempts de se faire adjoindre à la communauté, par une sentence de 1689 ; la déclaration du roi, de 1692, soumit également ces instrumentistes aux conditions de maîtrise. Mais les jurés, non contents d’avoir forcé les hautboïstes à se ranger sous la bannière de Saint-Julien, voulurent y enrôler les clavecinistes ainsi que les organistes ; la question fut portée devant les tribunaux. Le Châtelet fut favorable à la communauté, mais sur l’appel au Parlement, les jurés furent condamnés.
En 1701, la communauté de Saint-Julien offrit de racheter, moyennant 20,000 francs, les offices des nouveaux jurés et trésorier ; elle obtint, en 1707, de nouvelles lettres-patentes par lesquelles le roi, approuvant la cession faite à la communauté des quatre offices de jurés et de celui de trésorier, l’autorise à les faire exercer par qui et ainsi qu’elle aviserait. Par les mêmes lettres, le roi accorda 260, livres de gages annuels pour l’office de trésorier, et confirma les maîtres de la communauté dans les fonctions et exercice de leur art, tant pour le fait de la danse que pour enseigner à jouer de tous les instruments de musique, de quelque espèce que ce puisse être, sans aucune exception, et notamment dans le droit d’enseigner à jouer du clavecin, du dessus et de la basse de viole, du théorbe, du luth, de la guitare, de la flûte allemande et traversière, nonobstant jugement, et arrêt contraire. Faisant défense à toute personne, à l’exception des treize de l’Académie de danse, d’enseigner à danser et à jouer des instruments, sous peine de 400 livres d’amende.
Il fallait, pour être maître, faire preuve de capacité non-seulement comme instrumentiste, mais encore comme danseur. Les vingt-quatre violons de la chambre, les joueurs d’instruments de la chapelle et des plaisirs et les maîtres de danse de la cour étaient exempts de faire expérience. Ces lettres ne reçurent pas leur entière exécution. Les professeurs de clavecin, les organistes, ayant vu leur indépendance de nouveau compromise, s’opposèrent à l’enregistrement de l’acte, et l’attaquèrent comme obtenu subrepticement ; ils triomphèrent. La communauté fut obligée de rapporter ses lettres ; elles furent biffées, lacérées, le sceau en fut arraché, et on le remit aux harmonistes comme trophée de leur victoire. La chancellerie leur expédia de nouvelles lettres ; mais on supprima tout ce qui avait rapport au jeu exclusif des instruments, et notamment la mention de divers instruments. En même temps, à côté du mot art elle ajouta partout celui de métier. La communauté, dépouillée ainsi de ses plus beaux privilèges, ne fit point enregistrer ces nouvelles lettres. Alors les clavecinistes, réunis aux organistes, craignant quelque sourde manœuvre contre leur liberté d’enseignement, prièrent le roi de leur accorder les titres nécessaires à l’exercice de leur art, et, par lettres-patentes du 25 juin 1707, le monarque déclara que la communauté ne pourrait, à l’avenir, prendre d’autre qualité que, celle de maîtres à danser, joueurs d’instruments, tant haut et bas et hautbois, et lui fit défense de troubler les clavecinistes et les organistes dans la liberté de leur art.
La communauté perdit ainsi petit à petit les plus beaux fleurons de sa couronne ; elle fut malheureuse dans tous ses procès : ainsi elle attaqua l’Académie Royale de Musique et prétendit interdire aux musiciens de l’Opéra le droit de jouer en dehors de la salle, soit aux bals, sérénades, soit aux noces et fêtes publiques. Un arrêt du conseil de, 1728 donna gain de cause aux artistes de l’Académie et permit aux symphonistes employés sur l’état de l’Académie, de jouer, librement et moyennant salaire, aux fêtes publiques et particulières. Plus tard encore, cette même communauté chercha à faire rapporter cet arrêt comme obtenu subrepticement ; mais elle n’eut pas un meilleur succès : le roi ordonna derechef, en 1732, l’exécution de ses arrêts antérieurs et maintint l’Académie dans son privilège.
La communauté en était à ce point, lorsque le fameux Jean-Pierre Guignon, l’émule des plus fameux violons du siècle, devint son chef. A un grand talent Guignon joignait une âme noble et généreuse. Il aimait les jeunes artistes et donnait gratuitement ses conseils à ceux qui annonçaient de l’avenir. Occupant à la cour la place de premier violon de la chapelle et de maître de musique du dauphin, père de Louis XVI, il eut assez de crédit pour se faire nommer roi de la corporation, malgré les arrêts contraires, et le roi lui en octroya les provisions en 1741. La première chose qu’entreprit ce nouveau roi fut la restauration du corps à la tête duquel il se trouvait placé, et il promulgua, à cet effet, un nouveau règlement. Une assemblée générale des maîtres joueurs. d’instruments et de danse de la ville de Paris et autres villes du royaume eut lieu dans la salle ordinaire de Saint-Julien, en 1747 ; on y rédigea des statuts en vingt-huit articles, Ils avaient pour objet de rétablir l’ancienne suprématie de la corporation et de son chef sur les associations des provinces ; de revendiquer, pour le corps, la maîtrise générale de tous les instruments d’approprier les conditions de la maîtrise musicale aux nouvelles exigences du temps ; enfin, de rétablir une bonne administration dans ce corps
La question d’apprentissage et de la maîtrise, soit de danse, soit des instruments, était ainsi résolue : Sentant qu’imposer la nécessité d’un apprentissage et le fixer à un certain nombre d’années était une chose qui n’était plus du siècle et dégradante pour les arts libéraux, Guignon décida que tous ceux qui seraient jugés capables d’être utiles au public par leur talent pourraient être admis à la maîtrise. A cet effet, tout aspirant, de Paris, à l’exception des vingt-quatre violons qui étaient maintenus dans le privilège d’être admis sans épreuves et en payant l’ancienne taxe de 50 livres, était tenu de faire expérience. La taxe de réception à la maîtrise de Paris était de 300 livres pour tout aspirant, non fils ou gendre de maître, dont 240 pour la communauté et 60 pour le roi ; pour un fils ou gendre de maître, 165 livres, dont 145 à la communauté et 20 au roi. La province était partagée en villes majeures et en villes non majeures. Dans les villes majeures, Aix, Alençon, Amiens, Arras, Besançon, Bordeaux, Bourges, Châlons-sur-Marne, Châlons-sur-Saône, Clermont, Dijon, Dunkerque, Grenoble, Laon, La Rochelle, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Metz, Montauban, Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes, Orléans, Pau, Perpignan, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen Sedan, Soissons, Strasbourg, Toulouse, Tours, Troyes et Valenciennes, le droit de maîtrise était, pour les aspirants, non fils on gendres de maîtres, outre les frais de réception, 50 livres, dont 20 revenaient à la communauté des ménétriers de Paris, 15 au roi des violons, et 15 à son lieutenant ou représentant. Dans les villes non majeures, les droits de maîtrise étaient de 25 livres, dont 5 à la communauté de Paris, 10 au roi, et 10 à son lieutenant.
En maintenant l’ancienne obligation de se faire admettre aux diverses espèces de maîtrises pour pouvoir exercer la profession d’instrumentiste, le nouveau chef toléra cependant l’existence de certains instrumentistes populaires qu’il eût été oppressif de priver de leur industrie. Mais pour que ces instrumentistes ne, pussent enlever les profits des maîtres capables, Guignon, conformément aux usages, les réduisit au rôle purement populaire, et, à cet effet, il borna à l’usage exclusif du rebec ou violon à trois cordes les instrumentistes jouant du violon, et à l’usage de leurs instruments populaires ceux qui jouaient d’autres instruments agrestes.
Les maîtres pauvres ne furent point oubliés « Afin, dit le nouveau chef, d’attirer la bénédiction du ciel sur la communauté et remplir les pieuses intentions des anciens ménestriers fondateurs de la chapelle et hôpital de Saint-Julien, il sera préalablement réservé, sur le prix de chaque réception à la maîtrise, une somme qui sera distribuée aux maîtres pauvres hors d’état d’exercer, soit par vieillesse, soit par infirmités, ainsi qu’aux pauvres veuves de maîtres... »
Tel fut le règlement de Guignon, qui projetait de réorganiser son corps sur une échelle grandiose et d’une manière complète ; il rétablissait sa suprématie universelle ; rendait tributaires de ses lois les instrumentistes de toutes espèces ; relevait enfin l’honneur de la maîtrise menacé. Ce règlement, approuvé par le roi en 1747, fut loin d’obtenir force de loi. En inscrivant derechef, sur les rôles de la corporation, les organistes et les professeurs de clavecins, Guignon n’avait pas prévu la résistance que lui opposeraient tous les artistes sans distinction et notamment les compositeurs et professeurs d’instruments d’harmonie. A la première nouvelle du nouveau règlement, les organistes de la chapelle du roi, faisant profession d’enseigner le clavecin, au nombre de vingt et un, mirent, au greffe, opposition à son enregistrement, Guignon, en 1749 fit assigner les opposants au Parlement ; il sentait bien que sa prétention n’était guère soutenable ; aussi déclarait-il, avant le prononcé de l’arrêt, se désister à l’égard des organistes, compositeurs-professeurs de clavecin, sous-condition que ceux-ci ne s’immisceraient point dans l’enseignement d’autres instruments que l’orgue et le clavecin. Mais les organistes, compositeurs et professeurs, n’étaient pas gens à se contenter de si peu. Soutenus par l’opinion publique, ils voulurent l’affranchissement complet de l’art musical, et ils obtinrent gain de cause le 30 mai 1750. Cet arrêt étouffa, dans son germe, la réforme tentée par Guignon, et son règlement fut, de fait, anéanti ; la communauté subsista bien encore pendant vingt-six années, mais ce ne fut pour elle qu’une suite de déceptions.
Depuis le règne de Louis XV, à mesure que les charges des vingt-quatre violons de la grande bande étaient venues à vaquer, elles avaient cessé d’être attribuées à des ménétriers ; on les donna à des musiciens libres ; enfin, les charges elles-mêmes furent définitivement abolies par l’édit du mois d’août 1761. Le roi, supprimant les deux anciens corps de musique de la chambre et de la chapelle, les remplaça, ainsi que cela avait été antérieurement au règne de François 1er, par un corps unique, composé de musiciens libres, ne jouissant d’aucun privilège particulier.
La suppression des vingt-quatre violons fut suivie d’une nouvelle confirmation des privilèges accordés à l’Académie Royale de Musique, ce qui enleva à la corporation tout espoir, de pouvoir la soumettre à son règlement. Mais l’échec le plus grave, et qui fut comme le tombeau creusé à la corporation, fut celui qu’elle éprouva en 1773.
La communauté, conformément à ses derniers statuts, avait créé en province des charges de lieutenants du roi des violons. Ainsi Lelièvre était lieutenant à Saint-Quentin, Chauveau à Blois, Jouan à Vitry-le-Français, Pensieu à Soissons, Barbotin à Poitiers. Ce dernier, ancien laquais d’un avocat, dan s l’antichambre duquel il avait appris à racler du violon, avait acquis de la communauté, par acte passé en 1762, pour le prix de 25,293 livres, une lieutenance générale qui comprenait près des deux tiers de la France. Ce Barbotin revendit un grand nombre de lieutenances particulières à une foule d’intrigants qui pressurèrent les ménétriers et qui mirent, malgré l’édit de 1750, tous les instruments, même les orgues et clavecins, à contribution ; de là, plainte en vexation par une foule de symphonistes. Ces réclamations, présentées et soutenues par les gentilshommes de la chambre, furent écoutées, et, en 1773, survint un arrêt annulant toutes les ventes et concessions faites par la communauté des charges de lieutenants généraux et particuliers.
L’arrêt de 1773 coupa court à la réforme projetée par Guignon, réforme déjà bien compromise par l’arrêt de 1750. Ce chef sentit qu’il lui était impossible de lutter davantage, et, après trente-deux années d’un règne fort agité, il abdiqua l’office de roi et maître des ménétriers, et en demanda la suppression définitive, suppression qui fut suivie, presque immédiatement, de celle de la corporation elle-même.
Voici les noms des divers rois de la communauté des ménétriers mentionnés dans l’histoire :
1338, Robert Cavairon ; - 1349, Coppin de Breguin ; - 1392, Jean Poitevin ; 1420, Jehan boisard, dit Verdelet ; - 1422, Jehan Facien ; - 1555, Castelan (André) ; - 1570, Roussel ; - 1575, Claude Bouchardon ; - 1590, Claude Nion ; - 1600, Lafont Nion ; 1620, Rishomme (François) ; - 1624, Constantin (Louis) ; -1657, Dumanoir 1er (Guillaume) ; - 1668, Dumanoir II (Michel-Guillaume) ; - 1741, Guignon.
Les hommes voués au culte de la musique se partagèrent, par la suite, en deux. catégories : la science et le savoir distinguèrent ceux de la première, que l’on nomma musiciens ; dans la seconde, furent relégués les joueurs d’instruments. Les premiers représentaient l’art, les autres, le métier. Les musiciens marchèrent librement, selon les impulsions de leurs talents et de leur génie ; mais les autres sentirent le besoin de se réunir, de se rassembler autour d’un centre commun. Ils établirent donc une espèce de bureau de placement, tenu par un courtier ou agent intermédiaire entre les ménétriers et ceux qui ont besoin d’eux ; ce bureau était, dans les derniers temps, établi rue du Petit-Carreau, vis-à-vis la rue Thévenot. Les dimanches et les jours de fête étant les bons jours, il y avait foule, et l’exiguïté du local força la corporation à stationner dans la rue : c’était là que se faisaient les nombreux actes d’enrôlement. A la mort du titulaire, les ménétriers, d’un commun accord, supprimèrent le bureau, mais ils continuèrent à se réunir au même lieu et aux mêmes heures. C’est, aujourd’hui, à la porte du marchand de vin, qui fait angle avec la petite rue Saint-Sauveur, qu’on peut racoler les instrumentistes. Un verre de vin de part et d’autre sert à gage de la fidélité, du contrat et remplace la signature. Vous rencontrez au rendez-vous depuis le joueur du galoubet jusqu’au contre-bassiste. Ce fut là aussi le refuge de bien des talents malheureux : des professeurs, des artistes éminents, qui trônent aujourd’hui dans nos orchestres, ont figuré sur ce bazar. Le musicien se pavane sur l’estrade de la salle de Herz ; le joueur d’instruments trône à l’orchestre de la Chaumière de l’Ile-d’Amour, de la Boule-Noire, etc., etc. Il y a encore une troisième catégorie d’instrumentistes, que l’on nomme musiciens de cour ; elle se compose de tous les musiciens ambulants, jouant, chantant dans les rues, les promenades, les foires, les cours, les cafés, lesquels ne peuvent exercer leur industrie qu’avec une permission de la police.
Ainsi donc la musique, aujourd’hui, se trouve représentée par cinq classes de musiciens : 1°, celle des compositeurs ; 2° celle des artistes solistes, comme Vieuxtemps, Dorus, Prudent, etc., etc., exécutant un concerto dans une salle publique ou un salon aristocratique ; 3° celle des instrumentistes composant les orchestres des différents théâtres et des sociétés de concerts ; 4°, celle comprenant les musiciens formant la phalange des Pillodo, des Bousquet, des Dufresne, jouant des quadrilles, des polkas, des mazurkas du Jardin-Mabille à la Closerie des Lilas ; du Château-Rouge à la Chaumière ; la cinquième, enfin, réunit les orgues de Barbarie, les clarinettes, violons, harpes, vielles, musettes qui, chaque jour, raclent dans les rues à qui mieux mieux
Ne croyez pas que les individus qui portent le nom de musiciens soient pour la plupart malheureux, ; dans le relevé de la population des garnis existants, en 1848 dans les douze arrondissements de Paris, nous trouvons peu de gens appartenant à la musique, soit comme exécutants, soit comme ouvriers.
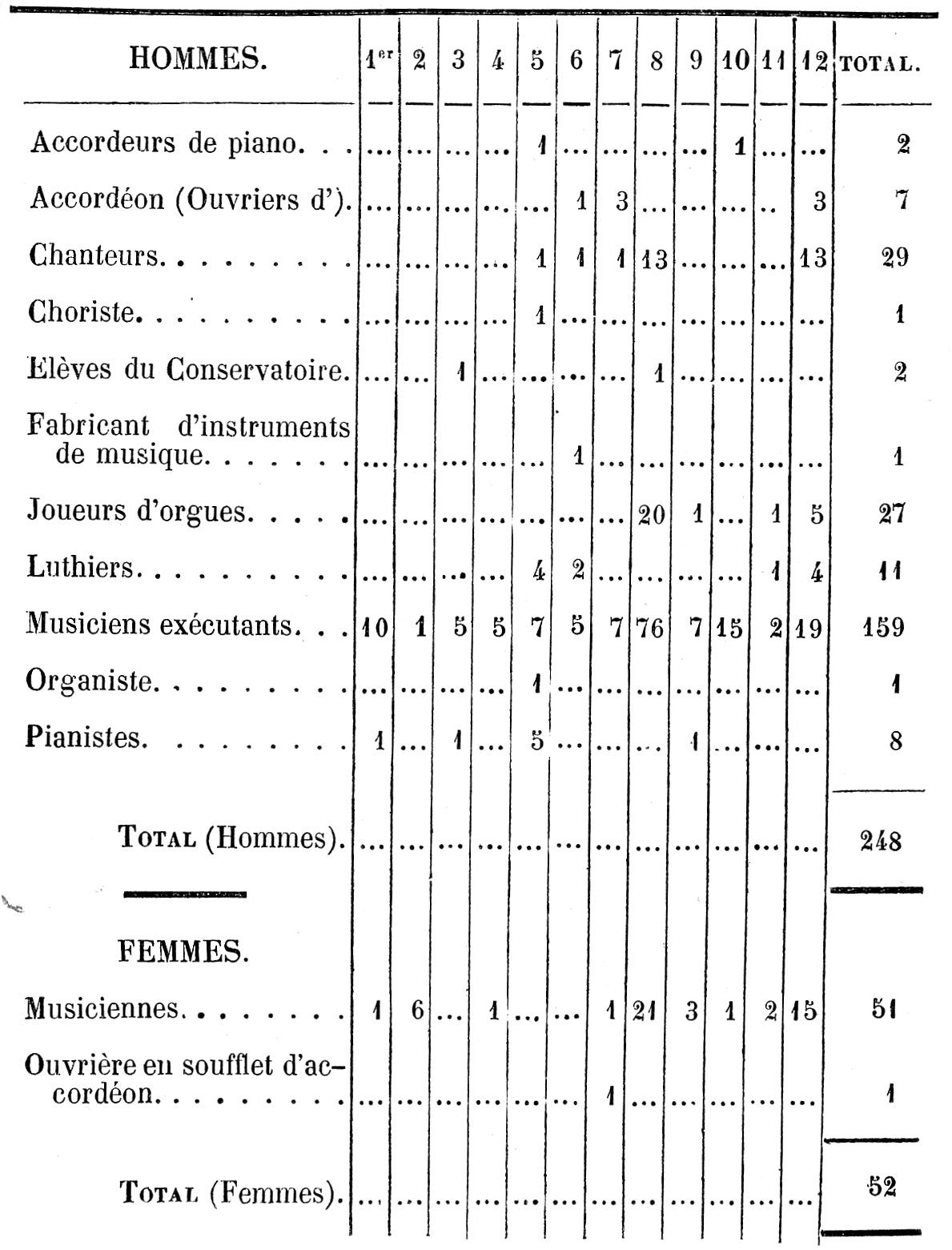
Un homme de bien, dont le nom est dans toutes les bouches et dont l’éloge est dans tous les cœurs, M. le baron Taylor, voulut faire pour les musiciens ce qu’il avait déjà entrepris pour les peintres, les gens de lettres et les artistes dramatiques : il réunit en une société tous les membres épars de cette nombreuse et intéressante famille. – « Aidez-vous, leur dit-il, le ciel vous aidera. », C’est ainsi que se forma, en 1843, l’Association des Artistes-Musiciens, sous la direction d’un comité central, à la tête duquel se trouve son fondateur. Chaque associé est tenu de verser 6 francs par an, ou 50 centimes par mois, pour sa cotisation, et, avec ce modique versement, il a droit, selon son numéro d’inscription, après vingt-cinq ans de cotisation (150 francs) et étant âgé de soixante ans, à une pension annuelle et viagère de 200 francs. Tout sociétaire ayant le même âge et ayant rempli les conditions de paiement pendant trente ans, c’est-à-dire ayant versé dans la caisse sociale 180 francs, a droit à une pension de 300 francs, et comme l’obligation de payer la redevance de 6 francs par an ne cesse pas avec l’obtention de la pension, le pensionnaire liquidé à 200 francs, ou ayant payé 150 francs, a droit au supplément de 100 francs aussitôt que ses versements annuels ont atteint le chiffre de 180 francs. Les premiers pensionnaires, par ordre d’inscription ne commenceront donc à jouir de leurs pensions, acquises de plein droit, qu’en 1868 ; mais, jusqu’à cette époque, la Société distribue des secours, sous le titre de pensions provisoires.
La Société prend la défense des droits de tout sociétaire dans les circonstances où le comité reconnaît que la moralité de la cause doit motiver son intervention. Son conseil judiciaire se compose de trois avocats au conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de huit avocats à la Cour impériale, de quatre avoués près la Cour impériale, de quatre avoués près le Tribunal de première instance, de deux agréés près le Tribunal de commerce, d’un notaire et d’un huissier.
Un conseil médical, composé de vingt-six médecins et de onze pharmaciens, se trouve également attaché à l’association, et le comité lui désigne les sociétaires qui ont besoin de leurs secours gratuits. Les pharmaciens sont chargés de délivrer les médicaments, lesquels sont fournis gratis ou à moitié prix, suivant la position des sociétaires.
Le comité central se compose de soixante membres, divisés en quatre commissions : 1° celle des secours et pensions ; 2° celle des comptes ; 3° celle d’admission ; 4° conseil de famille, devant lequel peuvent être portées toutes les difficultés qui pourraient s’élever entre les sociétaires.
La Société des Artistes-Musiciens a organisé des comités dans plusieurs villes de la province, et ils fonctionnent déjà à Alger, Dieppe, La Rochelle, Lille, Marseille, Meaux, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Niort, Poitiers Provins, Strasbourg, Tonnerre, Toulon, Toulouse, Versailles.
En 1843, le nombre des sociétaires était de 1,104 ; en 1856, le chiffre fut de 3,931, répartis ainsi : Paris, 2,204. - Départements (120 localités), 1,190. Étranger (13 localités), 21.- Armée (62 régiments), 269, dont 3,093 hommes et 591 femmes. - Nouveaux sociétaires (fin juin 1856), 247. - Total, 3,931.
Les recettes de l’association se sont élevées, en treize années, à la somme de 646,122 francs ; 363,281 francs ont été employés par elle en achat de 16,309 francs de rente.
L’association a distribué en secours, depuis sa fondation jusqu’en 1855, 123,395 francs.
Les pensionnaires pour l’exercice de 1856, étaient au nombre de soixante-quatre personnes, absorbant une somme de 15,120 francs, répartie entre trente pensionnaires à 300 francs et trente-quatre pensionnaires à 180 francs.
L’association a établi un registre de demandes d’emplois et de demandes d’artistes, qui se trouve déposé chez M. LEGOUÏX, éditeur de musique, boulevard Poissonnière, 27, à l’entrée du bazar Montmartre. MM. les chefs d’orchestre et artistes sociétaires peuvent l’y consulter journellement.
Cette association est-elle utile ? Les faits sont là qui parlent plus haut que toutes les phrases, rien ne saurait les changer ni les amoindrir.
« Il y a quelque temps, la rumeur publique apprenait à l’association qu’un pauvre musicien, nommé Brion, défaillant sous le poids de la misère et du désespoir, venait de mourir, laissant dans le plus triste abandon sa femme et quatre enfants. Le comité, quoique son assistance n’eût point été réclamée, délégua immédiatement un de ses membres. Lorsqu’il se présenta, la mère, atteinte elle-même d’une maladie mortelle, avait eu le courage d’aller voir une de ses petites filles, malade, chez de braves gens qui l’avaient recueillie « La malheureuse femme ne devait plus trouver son enfant ; il était mort à la suite des privations qui avaient ruiné sa chétive existence.
« Le lendemain, quand le délégué se représenta, la pauvre mère, frappée à mort par ce dernier coup, n’avait plus rien à attendre d’aucun secours humain. Mais il fallait sauver les trois enfants qui restaient, et dont l’un était déjà épuisé par la maladie qui venait d’enlever sa sœur ; il fallait avoir le triste courage de les arracher à leur mère. La séparation fut déchirante, elle devait être éternelle. Au bout de quelques jours, de toute cette famille, il ne restait que trois orphelins.
Le comité a adopté les trois orphelins. « Il a eu bien peur, dit M. Rety, secrétaire de l’association, lorsqu’il a fallu compter, de n’être pas assez riche pour accomplir sa tâche ; mais, grâce à de généreux efforts, il est parvenu à surmonter tous les obstacles, et il peut exprimer aujourd’hui, à l’association, avec autant de fierté que de bonheur, la profonde reconnaissance des enfants de l’infortuné Brion.
Nous avons dit précédemment quels furent les signataires de l’acte d’association des ménétriers de Saint-Julien, il est juste de signaler également à la postérité ces hommes de bien qui, les premiers, se sont réunis à M. le baron Taylor, et qui ont signé avec lui l’acte de société. Voici leurs noms dans l’ordre des signatures données à l’acte d’association.
1 MM. Taylor (le baron). - 2 Louvois (le marquis de). - 3 Kastner. - 4 Laty. - 5 Zimmerman ainé. - 6 Berton. - 7 Béchem. - 8 Manéra. - 9 Genevay. - 10 Battanchon. 12 Gouffé. - 13 Auber. 14 Tulou. – 15 De Bez (Charles). - 16 Girard. – 17 Schiltz. - 18 Doche. - 19 Halévy. - 20 Bourges (Maurice). - 21 Bureau (Allyre). - 22 Hormille. - 23 Meyer-Beer. - 24 Doras. - 25 Mercadier. - 26 Dauverné aîné. - 27 Monnais (Édouard). - 28 Demouy. - 29 Nargeot. 30 Troupenas. - 31. Rousselot. - 32 Adam (Adolphe). - 33 Croisilles. - 34 Onslow. - 35 Tolbecque (J.-B.). - 36 Thalberg. - 37 Carafa. - 38 Meifred. 39 Habeneck aîné. - 40 Guénée. – 41 Tilmant aîné. - 42 Herz (H.). 43 - Vogt. - 44 Schlesinger. 45 Berlioz. - 46 Martinez de La Rosa.
Si l’utilité de l’association fondée par M. le baron Taylor était jamais niée, si les bienfaits qu’elle répand étaient contestés, ce n’est pas par des mots qu’il faudra répondre ; on dira simplement ce qui a été fait par elle ; pour laisser tout leur mérite à certaines actions, on ne les loue pas, on les raconte.
Les orchestres des vingt-cinq théâtres, existant en 1848, se composaient de six cent trente-six exécutants, dont les appointements montaient à 588,000 fr. environ. Deux cent soixante-sept musiciens étaient attachés aux cinq premiers théâtres, et recevaient annuellement 298,000 francs ; cent treize étaient attachés aux cinq théâtres de la deuxième catégorie ; ils recevaient 97,000 francs, et deux cent cinquante-six, attachés aux quinze théâtres de la troisième, percevaient 193,000 francs de salaire.
Il se donne dans Paris environ dix mille bals par an, tant particuliers que publics ; en mettant une moyenne de quatre musiciens par bal et un salaire de 6 francs par nuit, ont trouve quarante mille soirées d’exécutants, produisant une somme de 240, 000 francs.
CHAPITRE VI
Après avoir résumé, le plus rapidement possible, l’histoire de la musique, celle des facteurs d’instruments et celle des musiciens, nous allons parler des travaux si divers de la facture instrumentale. Nous ne pouvons pas cependant aborder cette partie de notre travail sans nous arrêter un moment devant deux instruments, organum, chefs-d’œuvre de création, que le facteur étudie sans cesse : l’ouïe, qui sert à percevoir les sons, et la voix, qui les émet ; instruments si parfaits, qu’ils servent, depuis le premier âge du monde, de modèle à l’imitation. Le génie humain s’est évertué et s’évertue, chaque jour encore, à les imiter par mille moyens mécaniques, mais sans parvenir à la perfection, parce que ces deux instruments, types par excellence de ce qui est et de ce qui sera, réunissent toutes les qualités de ceux que le genre humain a déjà construits et de ceux que l’imagination et l’esprit de l’homme n’ont pas encore conçus.
L’OUIE.
« L’organe de l’ouïe a évidemment, dit Charles Nodier, produit la parole, la poésie, la musique ; et la parole, la poésie et la musique ont aussi évidemment produit les perfectionnements de la civilisation. »
Oreille vient du mot latin auris, que quelques étymologistes ont dérivé de haurire, qui signifie tirer, puiser, parce que, disent-ils, les oreilles tirent ou reçoivent la voix et les sous dans leurs cavités.
L’oreille serait seule, en effet, un chef-d’œuvre de construction, si tout dans la nature, la chose la plus simple, comme la plus compliquée, n’était autant de merveilles et de chefs-d’œuvre, dont la contemplation fait rejeter bien loin le hasard de la création et démontre avec évidence la puissance et la réalité d’un Créateur suprême.
L’oreille ou l’organe de l’ouïe est très-rapproché du cerveau et très-voisin des yeux, avec lesquels il a une analogie de fonctions remarquable ; ces deux sens annoncent à la créature les objets extérieurs. Un musicien joue-t-il un morceau, les yeux lisent les notes, et l’oreille l’avertit si l’exécution est juste ou fautive ; la communication entre les yeux et l’ouïe est tellement intime, que, lorsque vous lisez : ut, mi, sol, l’idée du son est déjà fixée, et si vous exécutez ut, mi, la, aussitôt l’oreille perçoit la différence.
L’absence d’un de ces organes rend l’autre beaucoup plus attentif. Ainsi, on remarque qu’un sourd voit avec plus de rectitude, et que, chez un aveugle, l’oreille est plus sensible et plus fine.
Nous allons donner un aperçu de la construction anatomique de l’oreille ; cet aperçu est nécessaire à toutes les personnes qui s’occupent de la fabrication des instruments. Nous ne discuterons cependant pas si l’oreille est composée de conduits nerveux, comme le prétendent Davernay et plusieurs autres, ou de cordes sonores, ainsi que le dit Valrosa ; ou de filaments résistants, selon le dire de Cassebohm ; ou de filaments nerveux, d’après les recherches de Simon Cellicus ; ou de fils transparents, arrondis, décrits par Morgagny ; ou de tuyaux membraneux, comme cherchent à le prouver Scarpa et Tourde.
Ce que nous constaterons d’abord, c’est la sympathie qui existe entre les deux organes de l’ouïe, sympathie qui se fait remarquer dans toutes les circonstances. Fermez une oreille, vous entendrez le bruit extérieur ; fermez l’autre aussi, vous n’entendrez plus rien. Faites vibrer la corde d’un violon, ouvrez une oreille, vous entendrez un son ; ouvrez-les toutes les deux, vous n’entendrez de même qu’un seul son, quoique les vibrations de l’air viennent frapper de l’un et de l’autre côté.
Quoique l’homme ait généralement des sens plus parfaits que les animaux, il en est cependant qui l’emportent sur lui à certains égards. L’aigle fixe le soleil, reconnaît sa proie à de très-grandes distances, le renard et autres ont une finesse d’odorat étonnante ; le lapin, le lièvre et la belette ont de grandes oreilles d’une extrême mobilité, qu’ils ont la faculté de mouvoir en plusieurs sens, et surtout en devant, ce qui est une sauvegarde pour leur timidité et leur faiblesse.
L’homme sauvage a aussi l’ouïe beaucoup plus fine que l’homme civilisé ; son oreille extérieure est moins aplatie, moins rapprochée des tempes, parce qu’elle n’est pas comprimée par toutes ces folles inventions dont notre enfance est victime.
Afin de recevoir les sons avec plus d’avantage et de sûreté, la nature a construit, pour le sens de l’ouïe, un appareil extérieur, qui est formé de cartilages et se nomme l’oreille extérieure ou externe ; cette oreille présente plusieurs contours élevés et des enfoncements destinés à retenir les sous et à les fléchir vers l’intérieur de l’appareil. Le centre de cet appareil se nomme conque et tient à un canal qui s’appelle conduit auditif, dont la construction est en grande partie osseuse, et dont la direction est variée ; l’épiderme se continue dans ce conduit auditif, de même que la peau, qui devient mince peu à peu et est exactement étendue sur l’os ; elle est, pour cette raison, très-sensible aux démangeaisons et autres sensations. Une partie aussi intéressante méritait l’attention du grand Architecte ; et il l’a conséquemment enduite d’une onctuosité qui la défend contre les injures de l’air et chasse et arrête les insectes. Une petite forêt de poils, qui s’y trouve, est destinée aux mêmes usages Au bout de ce canal se trouve la membrane du tympan située obliquement, un peu concave du côté du conduit auditif. Sa tension donne plus d’intensité au son, et son relâchement en diminue la force. Aussi, lorsqu’on est distrait, on perd facilement des sous légers qu’une vive attention nous ferait saisir. Un ressort quelconque ne peut être trop forcé sans inconvénient ; il en est de même du tympan.
La caisse du tambour est une grotte située derrière la membrane du tympan ; sa forme est irrégulière ; elle renferme quatre petits os dont la dénomination exprime la figure ; le premier se nomme le marteau ; il a une tête ronde au cou, un long manche qui descend le long de la membrane du tympan jusqu’à la partie moyenne ; il est mu par trois puissances ; cet os est articulé ou joint avec l’enclume, qui est un petit os plus court et plus épais.
Le marteau communique à l’enclume les ébranlements qu’il a reçus de la membrane du tympan ; l’enclume, à son tour, transmet ses mouvements à l’étrier, qui est ainsi nommé parce qu’il ressemble assez à un étrier ; il a deux branches un peu courbes ; la base est ovale et remplit exactement une ouverture appelée fenêtre ovale ; il est mu par une seule puissance ; le dernier osselet est nommé lenticulaire ; il est fort petit, et même plusieurs anatomistes ne le reconnaissent pas. De la cavité du tympan partent plusieurs canaux ; en devant c’est la trompe qui est le plus considérable de tous, et, formée de cartilages et de membranes, elle se termine par une ouverture elliptique très-large derrière les narines, dans la cavité du gosier. L’air, lorsque nous faisons le mouvement d’aspiration, entre par ce canal dans le tympan, s’y renouvelle, et la mucosité se répand autour des osselets pour les oindre.
Lorsque des sons violents poussent la membrane en dedans du tympan, il peut sortir une petite quantité d’air par la trompe. Cette membrane dirige aussi à l’organe de l’ouïe les sons reçus par la bouche ; de là vient le bourdonnement lorsqu’on bâille, c’est ce qui rend les sons moins distincts ; en effet, l’air, poussé en plus grande abondance par la trompe dans le tympan, résiste aux ébranlements de l’air extérieur. La fenêtre ovale conduit dans le vestibule, qui est une cavité ronde, tracée dans la partie dure du rocher et adjacente à la partie interne du tympan.
On y trouve les orifices des trois canaux demi-circulaires ; canaux écailleux et distincts dans la première enfance, mais qui, plus tard, sont seulement tracés dans la partie dure du rocher.
Le limaçon est placé dans la partie antérieure du rocher, un de ces orifices bâille dans le vestibule, et l’autre dans la fenêtre ronde, située au fond du tympan.
Le limaçon fait d’un noyau osseux et conique, dont la pointe est inclinée en dedans, est divisé dans son milieu par un sillon et criblé, à la base et dans toute sa longueur, d’une grande quantité de trous qui se terminent par des tuyaux qu’on appelle échelons. Ce canal a deux loges, et il est divisé par une cloison qu’on a nommée lame spirale.
Voilà toute la charpente osseuse de l’oreille ; il lui fallait la vie et le sentiment. Les vaisseaux sanguins et les nerfs furent destinés à ces deux fins. Les premiers sont fournis par des artères et des veines des parties environnantes.
Les nerfs de l’oreille s’appellent nerfs auditifs ; ils ont deux portions, une dure et une molle. La portion molle fournit aux limaçons, aux canaux demi-circulaires et au vestibule ; la portion dure parait n’entrer dans l’oreille qu’en passant et pour aller communiquer avec les nerfs du dehors, qui sont voisins.
Les ondes sonores de l’air tombent sur l’oreille, qui les reçoit conformément aux lois de la physique. Les angles de réflexion du son sur les corps durs sont égaux aux angles d’incidence ; le même son, poussé dans l’air libre, s’affaiblit, parce qu’il s’étend dans une sphère, très-vaste ; il conserve sa force si on le pousse dans un cylindre, et si on le réunit dans le foyer d’une ellipse ou d’une parabole, il acquerra de la force.
De là, il est aisé de voir combien le Créateur a manifesté sa puissance et son attention dans la structure de l’oreille et dans les lois qu’il a imposées au son.
Le nerf, qui se rend dans le vestibule et dans les canaux demi-circulaires, est frappé par les ébranlements de l’air extérieur, qui se rendent jusqu’à l’étrier et touchent, par la fenêtre ovale, la pulpe du nerf, qui y est mu ; il se sépare, sans doute, de cette pulpe des rameaux qui passent par les petits trous des noyaux et se distribuent au périoste du limaçon et à la partie membraneuse de la lame spirale. Le limaçon parait destiné à être l’organe immédiat de l’ouïe. Cependant les poissons, qui en sont privés, ne laissent pas d’entendre très-bien le moindre bruit, quoique l’on ait voulu leur refuser la jouissance de cette fonction. Cette observation ne détruit cependant pas les droits du limaçon à cet égard, et nous sommes très-porté à croire, avec un grand nombre d’auteurs, que la lame spirale, remplie de nerfs, est ébranlée par l’oscillation de la membrane interne du tympan, qui agite l’air de cette cavité, de sorte qu’il ébranle la membrane de la fenêtre ronde, et celle-ci l’air du limaçon. La lame spirale est triangulaire ; elle forme angle aigu à son sommet, et on peut imaginer dans cette lame un nombre infini de cordes, de plus en plus courtes, qui s’accordent et sont en harmonie avec les différents sons. Celles de la base du limaçon tremblent avec les sons graves, et les plus courtes, situées à la pointe, sont agitées par les sons aigus.
Les secousses élastiques de l’air arrivent aux nerfs auditifs par l’oreille extérieure, par le conduit auditif, par la membrane du tympan, et se communiquent, par les os contigus, plus exactement dans le vestibule, plus confusément, au moyen de l’air du tympan, dans la fenêtre ronde, dans le limaçon ; on ne sait rien de plus ; mais il est constaté que le tremblement sonore et élastique, se transmet au cerveau par la trompe et par tous les os du crâne.
La distinction des sons dépend, sans doute, de l’ébranlement du nerf acoustique, suivant qu’ils se succèdent plus ou moins promptement dans un petit espace de temps. Il n’est pas nécessaire que l’âme puisse les nombrer, il suffit qu’il existe dans la pensée des changements, conformes à ces ébranlements.
Des naturalistes ont étendu la sympathie de l’oreille beaucoup plus loin, ils ont prétendu que, en coupant les oreilles, on rendait le patient impuissant, et cette fausse croyance, donna naissance, en grande partie, à la loi qui jadis ordonnait cette opération sur certains coupables afin qu’ils ne reproduisent plus leurs semblables.
Il est assez remarquable que la grandeur de l’oreille ne fait rien pour l’ouïe, et si la grandeur ajoutait quelque qualité à l’entendement, l’âne serait celui des animaux qui aurait cet organe le plus, parfait ; mais il n’en est rien, la grandeur de l’oreille ne fait rien à sa bonté. On peut avoir de grandes oreilles, de larges oreilles, et n’avoir pas d’oreille, c’est-à-dire n’entendre pas bien.
LA VOIX.
« L’homme est arrivé, dit Charles Nodier ; il tenait, de la nature animale, la propriété de la vocalisation ou du cri. »
« Il avait, par-dessus toutes les espèces, l’heureuse conformation d’un, organe admirablement disposé pour la parole ; instrument à touches, à cordes, à vent, dont la construction sublime fera le désespoir éternel des facteurs, et qui module des chants si supérieurs, à toutes les mélodies de la musique artificielle, dans la bouche des Malibran, des Damoreau. Il avait dans les poumons un souffle intelligent et sensible ; dans ses lèvres, un timbre épanoui, mobile, extensible, rétractible, qui jette le son, qui, le modifie, qui le renforce, qui l’assouplit, qui le contraint, qui le voile, qui l’éteint ; dans sa langue, un marteau souple, flexible, onduleux, qui se replie et qui s’interpose entre ses valves, selon qu’il convient de retenir ou d’épancher la voix, qui attaque ses touches avec énergie ou qui les effleure avec mollesse ; dans ses dents un clavier ferme, aigu, strident ; à son palais, un tympan grave et sonore : luxe inutile, pourtant, s’il n’avait pas eu la pensée. Et celui qui a fait ce qui est, n’a jamais rien fait d’inutile. L’homme parla parce qu’il pensait. Son langage fut d’abord simplement vocal. »
Le larynx, situé au haut du cou, dans la partie qui est en devant se nomme vulgairement la pomme d’Adam, est le principal organe de la voix. L’air en est la matière les poumons servent de soufflets ; la trachée artérée sert de porte-vent ; l’effort des parois de la poitrine est le poids qui charge le soufflet de l’orgue. Les organes de la voix peuvent donc être regardés comme des instruments à cordes et à vent.
La prodigieuse quantité de tons et d’accords qui font l’objet principal, de la musique, la délicatesse, la justesse et la promptitude des mouvements qui la produisent, sont admirables. Tout dépend d’un allongement, et d’un raccourcissement, dont les différences sont renfermées dans les bornes de : deux ou trois lignes.
On a divisé l’octave en trois cent-une parties, qu’une voix sans défaut, conduite par une oreille fine, peut entonner. Il n’y a rien que de très-ordinaire à une voix qui va à trois octaves, en comptant les tons forcés au-dessous de la voix pleine et au-dessus du fausset : ce sont donc neuf cent-trois parties de tons marquées dans un si petit espace, par des divisions et subdivisions qui leur sont propres.
Si. l’imagination les confond, la nature les distingue, et elle choisit le point nécessaire, pour chaque parcelle de ton, avec une justesse qu’il est difficile de concevoir.
Il est aisé de voir que les instruments à vent, les plus propres à l’harmonie, ne pourraient être comparés à la voix. Cette dernière l’emporte en perfection sur les flûtes, les, jeux à biseaux de l’orgue et les cors de chasse, et l’usage même des instruments à vent est opposé et nuisible à l’organe, de la voix ; l’expérience journalière le confirme.
Pour que la voix se forme, il faut que l’air soit poussé avec force dans la glotte, et par la glotte qui, se rétrécit pour lors ; l’air se brise sur les bords de cette même glotte, qui, forment alors comme deux lames vibrantes qui, semblables à celle des touches, permettent ou interceptent de temps en temps le passage de l’air, et qui ébranlent le larynx, lequel réagit sur l’air et augmente son action.
C’est la quantité d’air, poussée par les poumons, qui détermine la mesure de la voix, et elle est proportionnée à la capacité et à l’élasticité des poumons, de la trachée artère et du larynx ; la glotte se rétrécit dans le ton aigu et se dilate dans le ton grave. La raison en est, qu’il y a existence de plusieurs tremblements, dans le premier cas, et moins dans le dernier. Le larynx s’élève avec d’autant plus d’efforts, que la voix est plus aiguë. La tête, même, est alors portée en arrière, pour laisser mouvoir tous les ressorts avec plus d’aisance et de force ; pour l’octave, le larynx se hausse d’un demi-pouce. Les oiseaux qui chantent ont la glotte étroite et très-élastique : cette dernière est, au contraire, large, dans les animaux qui n’ont qu’une voix enrouée ; elle est encore plus large dans ceux qui mugissent et dans ceux qui sont muets. Le sifflement prouve ces assertions, en ce que le son aigu dépend évidemment du rétrécissement des joues et des lèvres. Les instruments de musique ne forment aussi des sons plus ou moins aigus, qu’en raison du diamètre de l’ouverture par laquelle l’air sort, et de la célérité de celui qu’on y pousse. Telles sont les causes qui produisent la différence des voix dans les deux sexes.
Les femmes, ayant des organes plus mobiles, plus fins et moins amples, doivent avoir la voix plus aiguë : le contraire est chez l’homme, et la voix la plus grave se termine par un souffle muet. La voix modulée par des différents passages, du ton grave à l’aigu, forme le chant qui est produit par les tremblements du larynx et par sa suspension entre des forces contrariées : c’est ce qui distingue la parole du chant. Il est, conséquemment, plus pénible de chanter que de parler, par rapport à l’action vive et continuelle des puissances qui émeuvent le larynx et le mettent en équilibre ; c’est pourquoi ceux qui chantent immodérément s’épuisent la poitrine. Les efforts de tous les muscles nécessaires pour mettre enjeu tout l’appareil de la voix produisent des frottements pernicieux et emportent la liqueur qui enduit ces parties.
C’est autrement dans la parole. Les tons aigus et graves ont peu de différence. La parole harmonieuse a diverses variétés dans. les tons, et elles dépendent de l’action des organes de la bouche, qui est moins laborieuse que l’action du chant.
La parole consiste dans la prononciation des lettres, différente suivant les nations. La division du plus grand nombre des lettres est cependant la même par toute la terre. On appelle voyelles les lettres qui se forment par la voix, uniquement exprimées par la bouche, sans donner de coups de langue contre aucune partie. Les consonnes se forment par quelques coups de langue contre certaines parties de la bouche, des lèvres ou des deux.
Il est un peu difficile d’assigner la cause de la diversité des tons. Dépend-elle de la longueur des ligaments de la glotte et des vibrations plus ou moins fréquentes de ces mêmes ligaments ? Nous ne le déciderons pas. Les oiseaux ont une glotte osseuse et cartilagineuse, qui, par cela même, n’est pas capable d’extension, et cependant ils sont les musiciens des airs. Les pourquoi ? et les comment ? paraissent inaccessibles, dans la nature, à tout homme qui pense et qui voit en grand.
CHAPITRE VII.
Avant d’analyser les travaux modernes de la facture instrumentale, nous allons, pour être conséquent avec l’ordre employé dans la partie historique de cet ouvrage, donner une idée des produits de cette facture des âges précédents, en décrivant rapidement les divers instruments employés à différentes époques, depuis les temps les plus reculés du moyen âge jusqu’à celle de la révolution de 1789, époque de renaissance pour les arts et pour l’industrie.
Nous partageons ces instruments en cinq grandes divisions. 1° les instruments à vent ; 2° les instruments à cordes ; 3° les instruments à percussion ; 4° les crotales. 5° les instruments mixtes, c’est-à-dire ceux qui tiennent, par leurs parties essentielles, à plusieurs divisions.
On trouve dans les anciens manuscrits un bien grand nombre de noms d’instruments ; mais rassurons-nous, beaucoup de ces noms divers s’appliquaient au même instrument ou n’étaient que l’appellation d’un de ses dérivés. Nous aurons soin d’indiquer au lecteur ces divers noms, qui souvent l’embarrassent quand il les rencontre dans les ouvrages des vieux historiens.
Les grandes familles d’instruments, malgré leurs appellations si diverses, n’étaient pas aussi nombreuses que l’on pourrait le supposer ; la multiplicité de leurs noms faisait leur principale force.
PREMIÈRE DIVISION.
INSTRUMENTS A VENT.
Tous les instruments à vent se composent d’un ou de plusieurs tubes agencés les uns au bout des autres ; les tubes sont, dans la majeure partie de ces instruments, percés, de distance en distance, de petits trous que l’exécutant ouvre ou bouche à volonté avec le bout des doigts, selon la nature du son qu’il veut produire. Dans plusieurs d’entre eux, de petites soupapes de métal, se mouvant sur un ressort, sont ajustées sur les tubes à des distances voulues et servent au même usage que les doigts qui les font mouvoir, pour ouvrir ou boucher les trous selon leur besoin. On les construisit en toute matière, soit animale, soit végétale, soit minérale ; on employa également l’os, l’ivoire, l’écaille, la corne, le bois, l’or, l’argent, le platine, le cuivre, le bronze, l’acier, le fer, le cristal, le verre, la porcelaine, la terre, l’albâtre, le papier, etc., etc. ; la matière n’étant pas, dans les instruments à vent, le corps sonore, mais servant seulement à renfermer, dans des proportions voulues, la colonne d’air mise en vibration par les lèvres, laquelle forme, dans cette division d’instruments, le véritable corps sonore.
Les instruments à vent sont, si nous exceptons les crotales, les premiers instruments dont l’homme se soit servi ; un simple roseau, un faible chalumeau donna naissance, pour ainsi dire, à l’harmonie instrumentale.
Nous ne pouvons pas, en parlant des instruments du moyen âge, nous contenter de la classification moderne ; aujourd’hui, on est dans l’usage de diviser les instruments à vent en instruments de bois et en instruments de cuivre ; mais, pour nous, cette division serait insuffisante, car, dans l’antiquité, on faisait des instruments de toutes matières : il y avait des trompettes en bois et des flûtes en argent. Nous nous trouvons donc forcé d’adopter un autre ordre pour les instruments à vent, et nous les partagerons en trois grandes familles. Dans la première, nous rangerons tous les instruments qui n’ont point de bocaux. (Par bocal, on entend un petit hémisphère concave, de métal, d’ivoire, de bois ou de toute autre nature, percé au milieu, placé à l’extrémité supérieure de l’instrument, et sur lequel l’exécutant place ses lèvres pour mettre l’air en vibration.) Dans la seconde famille, se réuniront tous les instruments munis de bocaux, et la troisième comprendra les instruments avec réservoir d’air.
Notre première famille formera deux sections : la première, composée des instruments à anche simple, et la seconde, des instruments à anche double.
PREMIERE FAMILLE
INSTRUMENTS A VENT SANS BOCAUX.
Première section
INSTRUMENTS A ANCHE SIMPLE.
La FLUTE, un des plus anciens instruments, est le nom générique de cette famille d’instruments fort nombreux. Les poëtes en attribuaient l’invention à Apollon, à Pallas, à Mercure, à Pan. Selon Pausanias, un nommé Ardale en fut l’inventeur ; on le disait également créateur de l’art d’accompagner le chant et la voix avec les flûtes, qui se divisaient alors en courbes, longues, courtes, moyennes, simples, doubles, égales, inégales, etc.
On distinguait, chez les anciens, les flûtes sarranes, phrygiennes, lydiennes. Celles destinées aux spectacles étaient d’argent, d’ivoire ou d’os, et celles des sacrifices, de bois. A Rome, les joueurs de flûte étaient les seuls instrumentistes employés, soit dans les sacrifices, soit dans les funérailles, soit dans les festins.
La flûte était, dans les premiers temps, d’une très-grande simplicité, et, comme dit Horace, avec peu de trous. Athénée prétend que ce fut Alexandride, musicien de l’ancienne Grèce, qui, le premier, produisit sur le même instrument des tons élevés et des tons bas : « Ce fut, dit-il, par le moyen des trous ; ) » avant lui, on ne connaissait en ce genre que la flûte de Pan. Le nombre de trous fut limité à quatre, jusqu’à ce que Diodore, de Thèbes en Béotie, en ajoutât d’autres. « Il perfectionna cet instrument, dit Pollux (Onom. IV, 10), en faisant une ouverture latérale pour l’embouchure. »
Dans son enfance la flûte était faite de roseaux et ceux provenant du lac Orchoméniens, en Grèce, étaient renommés pour cet usage. (PLINE, XVI-36). Clonas, qui vint quelques années après Terpandre, fut, dit-on, le premier qui établit des règles et composa des airs pour la flûte. Prononius de Thèbes réunit sur une seule flûte les effets des flûtes dorienne, phrygienne et lydienne. Cependant on peut croire que cette amélioration n’a rapport qu’à la double flûte.
Ce qu’on nommait alors invention, chez les anciens Grecs, n’était réellement qu’une importation, car les flûtes étaient connues bien antérieurement des Egyptiens. On a retrouvé, représenté sur des sculptures, d’une époque excessivement reculée et qui ornaient un tombeau situé derrière la grande pyramide, vieux de trois à quatre mille ans, un concert vocal et instrumental consistant en deux harpes, une flûte et plusieurs chanteurs ; sur les monuments des Pharaons de la dix-huitième dynastie, on rencontre plusieurs représentations semblables. L’exécutant y était assis à terre, ou agenouillé, ou debout ; le plus souvent cet emploi de joueur de flûte est exercé par des femmes, et ce qui doit rendre la reproduction de cet instrument fort ititéressant pour l’antiquaire, c’est la présence du mot CHBI dont l’écriture hiérogliphique, en langue cophte, a la signification de Flûte. Ce nom est très-remarquable et prouve qu’à cette époque les flûtes étaient construites comme en Béotie, et comme de nos jours dans quelques pays, avec le tibia ou os de la jambe de certains animaux, et le mot chbi-n-pat est le tibia cruris: aussi les Latins ont souvent appelé tibia une flûte tenue par les deux mains ; elle était parfois excessivement longue et les trous se trouvaient si. éloignée de l’embouchure que le musicien était obligé d’allonger les bras de toute leur longueur.
La flûte simple se trouve très-rarement représentée sur les sculptures, d’où l’on peut conclure qu’elle ne jouissait pas d’une grande estime, et c’est ce qu’on remarque également dans beaucoup d’autres pays où elle a été considérée comme instrument pastoral. La flûte égyptienne était un tube mince, sans augmentation de grosseur à la tête ; quand on s’en servait on la tenait des deux mains : la flûte ordinaire était d’une grandeur médiocre, ne dépassant pas un pied ou dix-huit pouces au plus. Il en existe au musée de Leyde dont la longueur varie de sept pouces jusqu’à quinze. Quelques-unes de ces flûtes ont trois et même quatre trous comme celles qui sont au musée Britannique, elles ont une embouchure également en roseau, et d’autrefois c’est un tuyau de paille commune, fixé dans la partie supérieure de la flûte, et l’ouverture réservée est si petite que le souffle ne s’y introduit qu’avec assez de difficultés.
Les flûtes doubles avaient, dans le principe, une embouchure, sans doute commune, mais, plus tard, on les sépara ; elles étaient jouées chacune d’une main.
Dans les peintures d’Herculanum, quelques flûtes doubles sont garnies de chevilles dans la partie supérieure, vers l’extrémité de l’instrument, dans le but, sans doute, de changer de ton ou de se procurer une note supplémentaire par l’enlèvement d’une ou plusieurs chevilles.
La FLUTE LONGUE et DROITE se nommait, en France, pipe, sublet, flaros de saus, muse de blé, elle doit être la plus ancienne, et comprenait différentes variétés. Tout était bon pour faire une flûte : une branche de saule, une tige de roseau, un brin de blé, que l’on taillait et perçait, fournissait l’instrument. Plus tard, on en fit avec des os et particulièrement avec les os des grandes volatiles. Le flageol, flagel, flajos, flaveteau, flautet, était une variété de cette flûte. Elle était percée de trois ou de six trous, et se montrait presque toujours en compagnie du tambour ou tambourin.
On lit dans l’Orchésographie de Thoinot Arbeau : « Quant à notre tambourin, nous n’y mettons point de sonnettes et l’accompagnons ordinairement d’une longue flûte ou grand tibia, et, de ladite Flûte, le joueur chante toutes chansons que bon lui semble, la tenant avec la main du bras gauche, duquel il soutient le tambourin. Le bout près de la lumière est soutenu dans la bouche du joueur et le bout d’en bas est soutenu entre les doigts auriculaires et le médiaine (médiaire) et, outre ce, afin qu’elle ne coule pas hors la main du joueur, il y a une esguillette au bas de ladite flûte où se met ledit médiaire pour l’engaiger et la soutenir ; et n’a que trois pertuis, deux devant et cinq par derrière et est admirablement inventée, car du doigt démonstrant (l’index) et du doigt du milieu qui touche sur les deux pertuis devant et du pouce qui touche sur le pertuis derrière, tous les tons et voix de la gamme s’y trouvent facilement. » - La flûte à six trous avait un bec ; on la nommait arigot au seizième siècle ; elle servait quelquefois d’accompagnement au tambour militaire. Thoinot Arbeau, dans l’ouvrage cité plus haut, dit qu’ « aulcuns usent au lieu du fifre dudit flageol et fluttet nommé arigot, lequel, selon sa petitesse, a plus ou moins de trous ; les mieux faits ont, quatre trous devant et deux derrière et leur son est fort éclatant, et pourrait-on les appeler petites tibies.» Le GALOUBET provençal, encore en usage de nos jours dans cette partie de la France, est de cette famille et ne marche pas sans tambourin qui sert à marquer au joueur le rhythme et la mesure. Cet instrument est percé de trois trous seulement et l’exécutant n’emploie que la main gauche. Il y avait également une flûte à neuf trous qui, en réalité, n’en avait que huit, puisqu’il y en avait deux diamétralement opposés et que l’on bouchait avec de la cire celui dont on ne faisait pas usage. Les basses avaient une clef que le petit doigt faisait mouvoir pour ouvrir le dernier trou du côté opposé à l’embouchure ; les flûtes les plus graves s’embouchaient au moyen d’un serpentin qui descendait le long du corps de l’instrument, jusqu’à l’endroit où les lèvres de l’exécutant pouvaient facilement s’y appliquer ; il y en avait qui pouvaient avoir de sept à huit pieds de haut.
FLUTE TRAVERSIÈRE, ainsi nommée pour la distinguer des précédentes et pour indiquer qu’elle ne s’embouche pas verticalement, mais de côté, par une ouverture latérale ; elle était moins populaire que la flûte droite, parce qu’elle exigeait plus d’art et offrait plus de difficultés pour en tirer des sons. L’embouchure consistait en un trou rond percé d’un côté du tube, à peu près à la hauteur de la lumière dans les flûtes droites. Il y en avait six autres pour les doigts ; dans la suite, il y en eut une septième que l’on ouvrait au moyen d’une clef. En 1722, on allongea le pied de la flûte pour gagner un ton de plus dans le bas, et l’on ajouta une clef pour avoir l’ut dièze. Ce fut en France qu’eut lieu ce perfectionnement ; car on lit dans une méthode pour apprendre à jouer de la flûte, ouvrage écrit par Joachim Quantz, musicien de la chambre du roi da Prusse, Frédéric II, et publié en 1752 : « Les Français sont les premiers qui ont rendu la flûte « plus parfaite qu’elle n’était en Allemagne en y ajoutant une clef, laquelle est indispensable pour les demi-tons de ré dièze ou mi bémol. »
Quantz ajouta une seconde clef ; elle était courbe et servait à faire sentir la différence qui existe entre ré dièze et mi bémol. Ce même musicien imagina, en 1745, pour hausser ou baisser le ton de la flûte, l’emboîtement de la tête que l’on nomme aujourd’hui pompe et le bouchon mobile avec sa vis de rappel.
En 1789, la flûte avait déjà trois petites clefs : fa naturel, la, et si bémol ; on lui donnait l’épithète d’Allemands. - C’était une famille entière dont deux, le moyen et le plus petit de la bande, nous sont restés, car, comme la flûte droite, la flûte traversière avait son système complet ; la petite flûte ou fifre était en usage dans l’infanterie française, à partir de Louis XIII ; on la nommait aussi arigot.
La FLUTE DE PAN, instrument dont l’invention se perd dans la nuit des temps, est parvenue cependant jusqu’à nous, et on peut l’apercevoir encore, fixée dans la cravate de quelques artistes nomades : elle se compose d’un assemblage de petits tuyaux d’inégale grandeur, faits ordinairement de roseau et solidement fixés ensemble avec de la cire ou du mastic, ne donnant chacun qu’une seule note ; dans l’origine, cet instrument n’avait que sept tubes. Pour en obtenir le son l’on effleure l’ouverture du bout des lèvres, comme on le fait dans une clef forée ; on nommait aussi cette flûte syringue, pipeaux, frestel.
En 1690, Denner de Nuremberg, voulant perfectionner l’ancien chalumeau allemand, arriva insensiblement à construire une CLARINETTE qui remplaça presque aussitôt le hautbois des forêts dans les orchestres. Tout en ayant, par la forme, beaucoup de rapport avec le hautbois, cet instrument en diffère essentiellement par le timbre et par son embouchure à anches simples. La clarinette qui, dans son origine, n’avait que sept trous et deux clefs, une pour le la et une pour le si, a végété longtemps avant d’atteindre la perfection de la flûte, du hautbois et du basson. Lefebvre, en 1788, y ajouta une clef pour faire sortir bien juste l’ut dièze d’en bas. Le principe acoustique de la clarinette offre cette différence avec celui des autres instruments à vent, qu’elle n’octavie pas, mais qu’elle quintoie lorsque le son voulu ne se produit pas.
COR DE BASSET. En 1770, on imagina à Pessau, en Bavière, un instrument nommé cor de basset, qui unit à la douceur du chant quelque chose de sombre ; cet instrument, perfectionné, en 1782 par Lotz de Presbourg, est de même nature que la clarinette et n’en diffère qu’en ce qu’il est plus grand et que sa forme est un peu recourbée ; il a la même embouchure et le même doigté.
Deuxième section.
INSTRUMENTS A VENT À ANCHE DOUBLE.
Le CHALUMEAU, chalemie, chalemelle, calamel, muse, est un instrument dont l’embouchure se compose d’un morceau de roseau taillé d’une seule pièce ou divisé en deux parties ou languettes très minces rapprochées l’une de l’autre et jointes de telle sorte qu’il ne reste entre elles qu’une très-petite fente pour le passage du souffle, le tube inférieur s’élargissant en forme de pavillon. Le chalumeau avait de six à neuf trous et était ordinairement sans clef ; il avait quelquefois, à son extrémité, une boite dans laquelle était fourrée la languette de roseau qui servait d’embouchure.
Le HAUTBOIS ne différait du précédent que dans la dimension, le nombre de trous et des clefs dont il était muni. Il se composait d’un tube principal auquel venait s’adapter le petit tuyau appelé anche, qui servait à emboucher l’instrument ; cette anche consistait en deux languettes de roseau placées horizontalement l’une sur l’autre et montées sur un petit corps de métal appelé cuivret ; souvent elle était cachée sous une boîte spéciale ayant au milieu une ouverture circulaire qu’on plaçait à la bouche. Les clefs, lorsqu’il y en avait, étaient pareillement enfermées dans une boite percée tout autour d’une certaine quantité de petits trous ; les instruments de cette famille, du diapason le plus élevé, n’avaient point de clefs ou n’en avaient qu’une et six trous. Il y avait des dessus de hautbois, des hautes contres, des tailles et même des basses de hautbois qui avaient jusqu’à cinq pieds de longueur.
Les hautbois étaient de quatre sortes : il y avait le hautbois ordinaire, le hautbois de Poitou, le hautbois des forêts et le hautbois d’amour ces deux derniers étaient moins sonores que le hautbois ordinaire ; le son, quoique agréable, en était moins éclatant et plus velouté. Il y avait aussi la bombarde qui avait six trous pour les doigts.
Le hautbois reçut des améliorations dans le dix-septième siècle, et les frères Besozzi, qui se firent entendre à Paris, en 1725, montrèrent un si grand talent, qu’on leur attribua l’invention de cet instrument, qui, sous leurs doigts, paraissait tout à fait nouveau, quoiqu’il fût connu en France du temps de Thoinot Arbeau, qui en fait la description dans son Orchésographie imprimée en 1589.
Dans les seizième et dix-septième siècles, il est souvent parlé de joueurs de hautbois et de gros bois. Par gros bois, on entendait les instruments employés en qualité de basses du hautbois et dépendant de leurs systèmes, ou bien provenant de familles instrumentales dérivées de la leur.
Les instruments en forme de crosse se nommaient CROMORNES ou tournebouts, corruption du mot allemand krumbhœrner (cors courbés) ; ils se composaient d’un tuyau de bois muni d’une anche renfermée dans une boite forée au milieu comme celle de certains chalumeaux ; ils avaient ordinairement six trous et plus bas un septième ; quelquefois, pour lui donner plus de gravité, on ajoutait deux ou trois trous en sus, et l’on donnait alors à l’instrument une ou deux clefs pour les fermer. Ces grands cromornes s’employaient comme basses du hautbois. Ces instruments, dits gros bois, furent en usage jusqu’au milieu du dix-huitième siècle ; il s’en trouvait plusieurs dans la musique de Louis XIV ; celui qui s’employait comme contrebasse de hautbois en avait la forme ; il était percé de onze trous ; à l’extrémité du tube, se trouvait un serpentin semblable à celui des flûtes douces de grande taille, mais au bout duquel on mettait une anche.
Le BASSON est nommé par les anciens auteurs français dulcian, doucine, à cause de la douceur de son timbre, et fagotto en italien ; on n’est pas d’accord sur l’étymologie de ce nom ; les uns veulent qu’il dérive du grec, et les autres de fagot, faisceau, réunion de plusieurs pièces de bois liées ensemble. Cet instrument fut inventé, en 1539, par un chanoine de Pavie, nommé Afranio ; dans son origine, il eut peu de succès ; mais perfectionné plus tard, en 1578, par Sigismond Scheltzer, il vint augmenter la famille du hautbois. Le basson fit sa première entrée dans l’orchestre dans la pastorale de Cambert, Pomone, en 1659 ; il n’avait alors que trois clefs : celle de si bémol, ré et fa grave ; son étendue s’arrêtait au la aigu ; en 1751, il lui fut ajouté une quatrième clef. Le basson, dans son origine, eut aussi ses dérivés, connus sous les noms de courtauds et cervelas, noms qui indiquent suffisamment leurs formes. Le COURTAUD était composé d’un morceau de bois cylindrique ayant onze trous, sept en dessus et quatre en dessous. Outre ces trous, il en avait encore six autres, trois à droite pour ceux qui faisaient usage de la main droite, et trois à gauche pour ceux qui étaient gauchers ; on bouchait avec de la cire les trous inutiles. Ces instruments servaient de basses aux musettes ; le CERVELAS, n’était qu’un courtaud de forme tellement raccourci, qu’on le pouvait cacher dans la main, n’ayant ordinairement que cinq pouces de long ; il devait, à la manière dont il était percé et à la division intérieure, la gravité de ses sons, qui égalaient ceux qu’aurait rendus un instrument huit fois plus long ; il était percé, aux extrémités, de huit trous pratiqués circulairement et bouchés avec une feuille de parchemin ; le cylindre était percé de quatorze trous. Il y avait encore, à cette époque, dans la famille du hautbois, des instruments peu en usage en France, les doppioni les sordunem, les schryari et les bassanelli, portant le nom de leur inventeur, Giovanni Bassano, compositeur vénitien du dix-septième siècle ; Nous ne devons pas oublier de signaler le HAUTBOIS DES FORÊTS, portant une anche en cuivre, dont le son participait et du chalumeau et de la musette, et le HAUTBOIS D’AMOUR, dont le diapason était d’une octave au-dessous du précédent ; il avait une anche de roseau. On les unissait au cor de chasse pour les effets d’harmonie champêtre.
Le COR ANGLAIS n’est qu’un hautbois d’une dimension plus grande et légèrement recourbé dans sa forme ; le pavillon est terminé en boule, au lieu d’être évasé. Cet instrument, inventé à Bargame, par Ferlandis, il y a une soixantaine d’années, occupe, dans la famille du hautbois, la même place que la viole dans celle du violon ; il sonne une quinte plus bas et n’est admis dans les orchestres que pour l’exécution d’un solo.
DEUXIEME FAMILLLE.
INSTRUMENTS À VENT AVEC BOCAUX.
Le COR et la TROMPETTE formant une famille d’instruments, très-connue et très en usage dans le moyen âge, sous les noms de tube, bucine, triblère, estives, clarine, claronceau, araine, trompe, trompette, cor, corne, cornet, menuel, graisle, huchet, oliphan, sont d’une origine aussi ancienne que la flûte ; la trompette était en usage en Égypte ; on la retrouve sculptée sur les monuments de l’époque la plus reculée, semblable à celle en usage chez le peuple hébreu ; elle avait dix-huit pouces de longueur environ, et, pour en jouer, l’exécutant la tenait avec les deux mains.,
On ignore à quelle époque la trompette fut connue en Grèce ; on la rencontre à peine mentionnée par Homère, au siège de Troie ; cependant Athénée assure que ce furent les Tyrhénéens qui inventèrent la trompette et le cor. Dans la suite, cet instrument devint plus tard le partage exclusif des musiques militaires et des musiciens ambulants.
Dans certaines parties de l’Égypte, il existait un préjugé défavorable à la trompette, et l’on vit les habitants de Busiris et de Lycopolis s’abstenir de son usage, « parce que, dit Plutarque, ses sons ressemblent aux cris d’un âne, ce qui rendait cet instrument typhonien, c’est-à-dire qu’il rappelait un animal emblématique du génie du mal. »
Les Israélites avaient des trompettes tant pour la guerre que pour le service divin, ainsi que pour les fêtes et les divertissements Les Grecs avaient, eux, six espèces de trompettes, et les Romains quatre.
L’invention de ces instruments est simple et a dû être le fruit du hasard ; mais ils ne doivent pas leur origine au même peuple que la flûte, car si celle-ci dénote des mœurs douces et champêtres, les autres accusent des instincts guerriers et chasseurs ; l’un appartient à un peuple primitif, l’autre à une époque moins reculée, celle où les besoins physiques se sont fait sentir, où la propriété était déjà cause à discussion. Le COR, corne, cornet, corniart, corneteau, annonce par son nom son origine, qui vient d’une corne qui servit pendant longtemps d’instrument de chant et de guerre. Les Latins le nommaient cornua ; en Allemand, cet instrument se nomme horne, corne, et en Anglais bugle, de buffle, qui est l’animal auquel ils empruntèrent les cornes pour servir d’instrument. On peut se faire une idée exacte de cet instrument en examinant une CORNE D’APPEL en usage encore aujourd’hui parmi les chasseurs. Voulez-vous avoir encore une image de l’ancien cor ou cornet, contemplez ces instruments en terre cuite, qui se trouvent, en temps de carnaxal, aux mains des gamins de Paris.
Quand le luxe s’introduisit à la cour des rois et des seigneurs, on substitua à la modeste corne l’éclatant ivoire ; on nomme alors le cor OLIPHANT, corruption du mot éléphant, appliqué, par métonymie, à l’ivoire, comme nous avons vu, en Angleterre, bugle, corruption de buffle, donner son nom à l’instrument ; il était fort difficile d’en tirer des sons avec des embouchures grossièrement façonnées et un tuyau n’ayant que deux ouvertures essentielles et n’étant percé d’aucuns trous latéraux, et ce fut en faisant de trop grands efforts pour le faire résonner que Roland se donna involontairement la mort, Le HUCHET, issu de l’ancien mot hucher, appeler, était une espèce de cornet de chasse qui servait également à la guerre. Le MENUEL, menoel, morniel, du latin minus, était un diminutif du cor. Le GRAISLE désignait un instrument d’un son maigre et strident, comme l’indique son nom grêle ; on s’en servait pour annoncer le repas et pour appeler aux ablutions, qui avaient ordinairement lieu avant et après le repas.
Les instruments que nous venons de citer n’étaient pas toujours des cornes ou de l’ivoire en ayant la forme, on employait également le bois courbé, soit en forme de corne, soit en forme d’un S ; les autres étaient droits, ressemblants à des cornets de papier. Par la suite, tous ces différents cors ou cornets ayant été percés de trous comme les flûtes et les hautbois, ils formèrent la famille des CORNETS À BOUQUIN, nommée par les Allemands zinken ; il y en avait deux espèces : l’une droite, qui admettait deux subdivisions : celle dont l’embouchure se séparait du tube principal, et l’autre dont l’embouchure y était adhérente. Les plus grands, cornets à bouquin avaient la forme de l’S ; l’embouchure était de bois et formait une pièce séparée, que les facteurs français nommaient bouquin (petit bout), qui exprime encore aujourd’hui, en France, le bout d’ambre ou d’ivoire adapté aux pipes d’origine turque, et de là est venu le terme générique de cornets à bouquin.
Ces instruments se fabriquaient en bois de cormier, prunier ou autre ; on les recouvrait de cuir pour garantir de l’humidité. Ils faisaient partie, sous Louis XIV, de la bande de la grande Écurie. Gluck en a fait l’emploi dans un de ses ouvrages, et on s’en sert encore en Allemagne pour jouer les dessus en compagnie des trombonnes, alto, ténor et basse. Le métal fut également employé dans la construction de ces instruments.
BUCCINE, bocine, basune, buxine, bussine, buizine, bosœne, buze, etc., etc. Chez les anciens, la buccina n’était autre chose, dans l’origine, que la coquille du buccin marin, dont,, on faisait un instrument en pratiquant un trou pour l’embouchure, dans la partie inférieure qui était pointue ; on en fit ensuite en différentes matières, et surtout en airain, tout en lui conservant sa forme ; mais, plus lard, on désigna également,. sous le nom de buccin, la SAQUEBUTE, trompette dont la tige se repliait sur elle-même, de façon quelle tuyau ou le pavillon était parallèle au tuyau de l’embouchure et dela même longueurque ce dernier ; plus tard, on lui donna le nom de TROMPETTE HARMONIQUE, TROMPETTE ROMPUE, et enfin TROMBONNE. La saquebute, comme beaucoup d’autres instruments, se divisait en quatre parties. On donne encore aujourd’hui le nom de BUCCIN à une espèce de trombonne dont le pavillon est taillé en forme de serpent et dont on fait usage dans l’harmonie militaire.
TROMPES ET TROMPETTES. - Ces deux instruments, composés, dans l’origine, d’un simple tube droit, d’une seule pièce, plus ou moins élargi à sa base, en forme de pavillon, ressemblaient à la TUBA antique et à ces trompettes construites par M. Schilz pour la cérémonie de la translation des cendres de l’Empereur.
Le tube était ordinairement de métal, mais quelquefois en bois ; les instruments des trompettes du roi Charles V étaient en argent. On employait le mot trompettes comme diminutif de trompe ; plus tard, ce diminutif devint un terme générique, applicable à des instruments de toutes dimensions, que la tige fût droite et d’une seule pièce, ou qu’elle fût repliée parallèlement sur elle-même en plusieurs parties. Ce fut sous Louis XII, vers la fin du quinzième siècle, qu’un Français, nommé Maurin, donna à la trompette sa forme actuelle. On vit alors le nom de TROMPE s’appliquer également à une variété du cor, c’est-à-dire à un instrument demi-circulaire, dont le tube s’évase insensiblement de l’embouchure au pavillon, et qui, quelquefois, se replie sur lui-même en faisant plusieurs anneaux..
Les trompettes droites, longues de près de six pieds, étaient trop incommodes pour qu’on ne cherchât pas à en changer la forme ; aussi vit-on, dès le quinzième siècle, des trompes doubles ou à tiges repliées. On courbait la tige de diverses façons ; quelquefois elle ne formait qu’un. simple anneau en tortille, ou bien cette tige était repliée plusieurs fois en zigzag, la- seconde courbure étant en sens inverse de la première ; enfin, cette tige, partagée en plusieurs parties nommées branches, était courbée en deux endroits nommés potence : c’est la trompette de guerre. Au milieu du dix-huitième siècle, on chercha, dans le Hanovre, les moyens de modifier les sons de la trompette et du cor pour les approprier aux tons des orchestres ; on y parvint en adaptant de tuyaux mobiles appelés cors de rechange ou tons ; mais comme ce moyen laissait encore beaucoup à désirer, on eut bientôt l’idée de leur faire l’application des clefs employées dans les flûtes et hautbois : ce furent les frères Braun qui introduisirent en France, en 1770, ces trompettes ainsi perfectionnées nous verrons plus tard se présenter les autres perfectionnements selon leur ordre de date. Le cor fut introduit sous Louis XV dans la musique militaire. Un Allemand, nommé Hampl, découvrit, en 1760, qu’il était possible de produire un plus grand nombre de sons en bouchant en partie, avec la main, la portion ouverte de l’instrument, qu’on nomme le pavillon. Un autre facteur, appelé Haltenhoff, compléta ces améliorations en y ajoutant une pompe à coulisse, au moyen de laquelle on règle la justesse de l’intonnation. Lebrun, corniste français au service du roi de Prusse, imagina également, dans le siècle dernier, de se servir d’une boîte conique, en carton, percée d’un trou, pour produire les effets d’écho.
Le CLAIRON, claron, claronceau, espèce de trompette d’un son plus mordant que la trompette ordinaire ; ces instruments étaient faits quelquefois en argent ; les chroniques en font souvent mention. Il faut également ranger dans cette section l’affreux SERPENT inventé, sous Louis XIV, par un chanoine de Sens ou d’Auxerre ; il servait à accompagner le plain-chant ; cet instrument fut fatal au chant ecclésiastique, parce que, rauque, âpre, inégal, souvent peu juste dans ses intonnations et peu facile à jouer, il rendait le chant lourd, traînant, monotone. En 1780, un nommé Rigibo, musicien de l’église de Saint-Pierre, à Lille, chercha à améliorer le Serpent, par une nouvelle perce de l’instrument et par l’addition de plusieurs clefs ; ainsi on peut considérer Rigibo comme le premier inventeur du basson russe, qui nous est revenu du Nord près de trente ans après. Il a été remplacé depuis par l’ophicléide.
TROISlÈME FAMILLE.
INSTRUMENTS A VENT, AVEC RÉSERVOIR D’AIR,
Première section.
INSTRUMENTS AVEC RÉSERVOIR D’AIR, SANS CLAVIER.
La CORNEMUSE, nommée également, dans les anciennes poésies, pipe, pibole, chalemelle, chalemie, muse, musette, sacomuse, chevrette, vize, loures, épithètes qui désignent les parties essentielles de cet instrument : une outre, à laquelle se trouvaient appliqués soit des chalumeaux, soit des hautbois, soit des cromornes. De là, le double sens de certaines épithètes qui désignent souvent ou l’instrument composé, ou l’instrument simple. Cet instrument est d’une haute antiquité, car, à Rome, sur un bas-relief grec, dans le palais de Santa-Croce, situé près de l’église Saint-Charles, on voit une cornemuse fort exactement représentée, et ce qui paraîtra plus extraordinaire, c’est que le personnage qui tient l’instrument ressemble, pour le costume et le caractère de la figure, à un habitant des hautes terres de l’Écosse (Higlanders) ; on trouve une autre représentation de la cornemuse dans le muséum Albani. Sur une pierre gravée, citée par Maffeï, représentant une saturnale, on voit un satyre tenant une cornemuse ou un instrument semblable.
Il y a eu des personnes qui ont cru que la cornemuse était la pythaules dont parle Varron, mais cette opinion a été réfutée par Saumaise. Diodore prétend que le Sicilien Daphnis en fut l’inventeur. M.Kastner, auquel, avec sa permission, nous empruntons toujours beaucoup, s’appuyant d’un passage de saint-Jérôme, qui attribue le nom de chorus à un instrument formé d’une peau et de deux tuyaux d’airain, dont l’un était l’embouchure et l’autre le pavillon, et ensuite d’une figure trouvée par Gerbert, dans un manuscrit du neuvième siècle, où la cornemuse est désignée sous le nom de chorus, croit que le chorus des anciens a donné naissance à la cornemuse.
La CORNEMUSE et tous ses dérivés, comme la musette, la sourdeline et la zampogne, ne différaient, entre eux, que par de légers détails de construction. Les parties de la cornemuse et des instruments de la même espèce sont : la peau de mouton que l’on enfle par le moyen d’un porte-vent enté sur cette peau et qui est bouché par une soupape ; le vent y est introduit de deux manières : par la bouche ou par celui d’un soufflet mis en jeu par le bras gauche. Le vent n’a d’issue que par trois chalumeaux. l’un s’appelle grand bourdon, l’autre petit bourdon, et le troisième la flûte ; quand on joue la cornemuse, le grand bourdon passe pardessus l’épaule gauche. La différence qui existe dans la musette et la cornemuse consiste dans le bourdon de la musette, qui porte quatre anches sur un cylindre dont on ferme ou on ouvre à volonté les trous ou rainures. La flûte est à anches ; elle est nommée flûte, mais c’est véritablement un hautbois ; elle était percée anciennement de six trous, mais elle a subi des améliorations, et, aujourd’hui, elle a onze trous, dont plusieurs garnis de clefs mobiles ; le petit bourdon a trente-cinq centimètres de longueur, le porte-vent, dix-huit, et le hautbois, quarante-cinq, y compris l’anche.
Nous croyons la cornemuse d’origine celtique, car on ne la retrouve que dans les lieux où se réfugièrent les restes de ces nations. En Basse-Bretagne, cet instrument se nomme encore BIGNOU, mot d’origine celtique, qui dérive de bigna (se renfler beaucoup). Ce qui vient encore à l’appui de notre dire, c’est que la cornemuse se rencontre en Danemarck, en Irlande, en Ecosse, dans le Bas-Poitou et dans la Basse-Bretagne ; cet instrument semble avoir suivi l’émigration bardique et lui avoir survécu. Quant à la musette, on croit qu’elle fut inventée par Colin Muset, officier de Thibaud de Champagne, roi de Navarre et qu’elle en prit le nom. La SOURDELINE est née, assure-t-on, en Italie, et y fut inventée par Jean-Baptiste Riva ; il existe un instrument semblable parmi les Arabes, nommé, par eux, sumara-el-kurbe ; il est en usage en Egypte. Le haut des flûtes est en bois dur et les pavillons sont en corne.
Sous Louis XIV, la musette figurait dans les concerts de la cour et faisait partie de la bande, instrumentale dite de la grande écurie.
Deuxième section
INSTRUMENTS A VENT, AVEC RÉSERVOIR D’AIR ET AVEC CLAVIER.
L’ORGUE est le plus riche, le plus complet, comme le plus puissant des instruments. Sa composition est trop connue pour que nous ayons besoin d’en faire ici une description détaillée ; nous dirons seulement que l’orgue se compose d’un certain nombre de tuyaux, divisés par jeux, que l’on appelle registre, rendant, autant que faire se peut, les sons d’un instrument que l’on a cherché à imiter ; les embouchures de ces tuyaux sont placées sur des sommiers et sont mises par eux en communication avec un réservoir à air, alimenté par des. soufflets ; il est établi un ou plusieurs claviers superposés, dont la touches en basculant, élève la soupape appliquée à l’embouchure du tuyau, donne passage à l’air et fait parler la note. - Il y a encore souvent, sous les pieds de l’organiste, un clavier qui lui permet de se servir de ses pieds pour augmenter ses moyens d’action. On sent que, pour arriver à une structure aussi compliquée que celle des orgues de Saint-Denis, de la Madeleine, de Saint-Eustache et de Fribourg, il a fallu plusieurs siècles.
Dans les premiers temps, l’orgue ne posséda qu’un très-petit nombre de tuyaux ; il n’y avait qu’un seul registre ; il avait un clavier en bois et n’était pas muni de clavier de pied. On croit que le plus ancien modèle d’orgue à un seul jeu avait reçu le nom de ragabellum, d’où est venu celui de régale. Chercher l’origine de l’orgue est chose bien difficile ; mais nous croyons, comme M. Kastner, que la syrinx adaptée à la cornemuse, comme elle se trouve représentée sur une médaille contorniate de Néron, citée par Blanchini, a pu donner l’idée de l’orgue ; car les plus anciennes orgues pneumatiques que l’on connaisse, les plus grandes, même, ont toutes la forme d’une vaste syrinx placée sur un sommier et mise en vibration par le moyen d’un soufflet, comme on peut le remarquer sur celles qui sont représentées sur l’obélisque érigé à Constantinople, sous Théodore le Grand. L’orgue pneumatique était déjà connu et usité au quatrième siècle, mais il ne remonte, en France, dit-on, que vers le huitième ; cependant nous croyons le contraire, car les Romains ont dû importer cet instrument dans les provinces conquises par eux.
Pépin, en 754, reçut un semblable instrument en présent de Constantin Copronyme, empereur d’Orient. Etait-ce un grand orgue ou une de celles nommées orguettes que nous voyons citées plus tard par les poëtes et les historiens ?... Il n’est plus parlé d’orgues, postérieurement au règne de Charlemagne, qu’à l’occasion de Georges de Venise qui se fixa, en 814, à la cour de Louis le Pieux, laquel l’envoya à Aix-la-Chapelle, où il lui fit fournir tous les matériaux nécessaires à la construction d’un orgue. Don Bedos est d’avis que cet instrument était un orgue hydraulique, c’est-à-dire mu par l’eau ; il s’appuie d’un passage d’Edginhard : « Il se trouve ici, dit-il, un Vénitien « nommé Georgius, qui, de son pays, s’est rendu auprès de l’empereur et qui, dans le palais impérial d’Aix-la-Chapelle, a construit, avec un art merveilleux, un orgue qu’en langue grecque on appelle orgue hydraulique. »
Mais Wallafridus Strabo parle d’un autre orgue qui existait dans la cathédrale d’Aix-la-Chapelle. Cet auteur prétend que ce fut le premier instrument de cette espèce dont les soufflets pouvaient être mis en mouvement sans le secours de l’eau ; malgré les ténèbres qui règnent sur les circonstances qui ont donné lieu à la construction de l’orgue de cette cathédrale ou qui en ont amené le perfectionnement, il est certain que, dans la seconde moitié du neuvième siècle, l’Allemagne possédait des orgues d’une facture assez remarquable. Zarlino, écrivain italien, prétend que les orgues sont venues de la Grèce en Allemagne, en passant par la Hongrie, et qu’elles furent d’abord accueillies en Bavière. Cet écrivain prétend qu’il existait, à la cathédrale de Munich, un orgue dont les tuyaux étaient fabriqués d’un seul et même morceau de bois. Au dixième siècle, l’Allemagne, et particulièrement la Bavière, fournissaient l’Italie de facteurs et d’organistes.
Les petites orgues prenaient différents noms, suivant la destination qu’elles recevaient, et s’appelaient orgues portatives, quand on pouvait, pour en jouer, les porter devant soi, dans le cas contraire, elles prenaient le nom d’orgues positives.
L’ORGUE PORTATIF, orguettes, orgues, était composé d’une boite ou plutôt d’une caisse plus haute que longue et renfermant un, deux, ou plus de rangées de tuyaux, au nombre de sept et huit, ayant des longueurs différentes et leur orifice aboutissant au sommier ; devant les tuyaux se trouvait le clavier qui était simple ou double ; le soufflet qui complétait l’appareil et faisait pénétrer l’air dans le sommier était derrière la caisse.
Cet instrument se portait suspendu au col par une courroie, comme on le voit encore chez les petits Savoisiens qui se promènent dans Paris avec des espèces d’épinettes à cylindre ; le musicien faisait mouvoir le soufflet de la main gauche et se servait de la droite pour toucher le clavier.
L’ORGUE POSITIF, plus grand et plus lourd que le précédent, est, sans doute, l’instrument qui, le premier, se sera introduit dais nos églises ; il avait plusieurs jeux, un clavier et deux soufflets pour le mettre en jeu ; il y avait dans l’orgue positif une variété de jeux nommée régale. Quand cet instrument n’était composé que de tuyaux excessivement courts et contenus dans un coffre très-plat, le son en était perçant et criard ; mais quand, au contraire, on y adaptait des tuyaux d’une certaine longueur, et quand le couvercle en était fermé, le son, alors, avait quelque douceur et était assez agréable pour être admis comme partie dans les orchestres d’opéra : Monteverde s’en est servi dans son opéra d’Eurydice, en 1607.Ces petites orgues, que les Italiens appelaient Ninfali, sont aussi anciennes que les autres petites orgues, et on prétend qu’elles ont reçu le nom de régales, parce que le premier instrument de cette espèce fut offert à un roi.
Les ORGUES HYDRAULIQUES étaient des orgues dont les soufflets étaient mis en jeu par le moyen de l’eau ; mais l’humidité, si nuisible à tous les instruments, les fit bientôt abandonner ; Forkel pense que les orgues pneumatiques, sur la nature desquelles les opinions sont très-partagées, n’étaient autre chose qu’une tentative de perfectionnement à l’idée première, tentative qui n’atteignit pas son but et dont on ne put se contenter. On revint bientôt à l’ancien procédé que l’on tâcha d’améliorer ; mais l’art de construire les orgues resta longtemps dans l’enfance et ne commença à prendre du développement que vers le quatorzième siècle. La facture ancienne avait alors, pour caractère spécial, non d’introduire des modifications, mais seulement des améliorations dans les différentes branches dont l’orgue se composait.
La soufflerie fut la partie principale dont on s’occupa d’abord car, pour mettre en jeu les soufflets de l’orgue de Winchester construit en 951, il fallait soixante-dix hommes vigoureux, et l’organiste ne pouvait enfoncer les touches larges de six pouces qu’à coups de poing.
On essaya, plus tard, de faire des tuyaux en diverses matières, mais on finit par s’assurer que le zinc et le bois étaient ce qu’il y avait de mieux pour la construction des corps sonores. François Landino, surnommé, en 1350, en Italie, Francesco d’Egli Organi, à cause de son habileté, Mœser, en Allemagne, Schmidt, en Angleterre, Cliquot, en France, se sont acquis, par leur intelligence et leur talent, une impérissable renommée dans la facture de l’orgue.
A mesure que l’usage des grandes orgues devenait général, on vit les petites orgues portatives perdre leur faveur. On ne rencontre guère, au dix-huitième siècle, que la régale et l’orgue en table, lequel a donné naissance à l’orgue à cylindre, appelé orgue de barbarie et à la serinette ; on retrouve l’orgue régale dans un jeu d’anches du grand orgue et l’orgue positif dans le petit orgue qui lui sert d’annexe.
Dès le quinzième siècle, l’orgue commença à sortir de son état d’imperfection. D’importantes découvertes vinrent successivement l’enrichir, surtout celle de Bernard Mured, qui imagina., en 1470, les pédales, qui firent de l’orgue un instrument colossal ; mais il lui manquait le moyen de nuancer, d’augmenter ou de diminuer graduellement l’intensité du son ; et pendant plus de cent cinquante ans, on fit des essais multipliés, pour résoudre ce problème. D’abord, on imagina les trappes, les jalousies s’ouvrant ou se fermant à la volonté de l’exécutant, idée qui avait déjà été appliquée au clavecin où un bouton, poussé par le genou, soulevait le couvercle.
Ce mécanisme n’obviait que bien piètrement au défaut reproché à l’orgue ; l’abbé Vogler y ajouta un appareil acoustique. On chercha bien encore des moyens extérieurs, mais sans résultat satisfaisant ; on en vint enfin à demander, au mécanisme de l’instrument, les moyens de modifier le son on fit des ventaux particuliers, au moyen desquels l’organiste put régler, à son gré, l’intensité du vent. Une plaque métallique, tournant sur un axe fixé horizontalement dans le conduit principal de l’air, était destinée à cette opération. Cette plaque, mue par une pédale, était-elle dans la position naturelle, tout l’air passait librement dans les tuyaux ; mais, à mesure quelle se tournait, elle rétrécissait le canal et l’intensité du vent diminuait. Arrivée à une position perpendiculaire, elle fermait tout à fait le passage ; on obtenait bien un diminuendo sensible, mais le ton s’en trouvait altéré ; il perdait de sa vigueur et le pianissimo ne ressemblait plus qu’au râlement d’un mourants L’abbé Vogler usa de ce moyen, mais seulement pour donner de la vibration aux jeux des anches libres déjà connus de son temps.
L’ORGUE EXPRESSIF est une invention qui appartient à la France et que nul n’a. le droit de revendiquer. C’est Claude Perrault qui, le premier, en a conçu l’idée, en s’occupant de la reconstruction de l’orgue hydraulique des anciens, d’après la description que Vitruve en a laissée. « Je cherchai, dit cet homme célèbre, les moyens de donner à l’instrument la faculté de pousser des sons différents en force pour imiter les accents de la voix et le fort et le faible que le mouvement de l’archet et la variété du souffle produit dans les violons, dans les flûtes et dans les hautbois ; » et. voici ce qu’il ajoute dans une note de sa traduction de Vitruve, publiée en 1675 : « C’est ce qu’on n’a pas encore eu la pensée d’essayer et que j’ai trouvé moyen de faire depuis peu, en ajoutant une seconde laye ou coffre à celui qui est d’ordinaire dans les orgues, et ne faisant qu’un même clavier passé sous les deux layes ; afin que chaque marche, balançant sur une tringle comme au clavecin, puisse tirer la soupape de la laye de derrière par le moyen d’un pilote qui la fait basculer ; parce que la queue par laquelle cette soupape est attachée au sommier, étant coupée en chanfrein, cette queue, qui est poussée contre le sommier par le pilote, fait que l’autre bout s’en éloigne et ouvre la lumière par où le vent entre dans les rainures du sommier. Et il faut entendre que tout dépend de la longueur des pilotes qui doit être telle, que la touche, étant peu baissée, ouvre seulement la soupape de la laye de devant et n’ouvre celle de derrière que lorsqu’on enfonce davantage et de manière que le pilote touche de la queue la. soupape de la laye de derrière ; car, par ce moyen, lorsqu’on touche les marches légèrement, il, n’y a que les tuyaux de la laye de devant qui sonnent, et lorsqu’on enfonce davantage, les tuyaux de la laye de derrière sonnent aussi, et, étant joints avec ceux de la laye de devant qui leur sont accordés à l’unisson, ils doublent la force du son, ce qui fait un fort bon effet quand une main légère est habituée à bien ménager ce fort et ce faible. » Ce mécanisme, tout en donnant des tons renflés ou diminués, laissait encore beaucoup à désirer, car le son ne s’émettait que par saccade ; cette invention, qui eût pu avoir d’immenses résultats au moyen de quelques perfectionnements, resta oubliée. Dans le dix-huitième siècle, un nommé Jean Moreau produisit dans un orgue, à Saint-Jean-à-Gouda, un crescendo par adjonction graduée et successif d’un certain nombre de tuyaux ; l’instrument avait trois claviers et pédales et cinquante-deux registres ; le clavier, lorsque tous les trois étaient accouplés, permettait à l’organiste d’enfler ou diminuer le son au moyen de la pression des doigts. Quand on enfonçait la touche de l’épaisseur d’un écu, le jeu du clavier parlait, l’enfonçait-il davantage, l’autre clavier faisait parler aussi son jeu, et enfin lorsque la touche était comprimée jusqu’au fond, tous les trois claviers parlaient ensemble.
En 1740, Schroeter, l’inventeur du piano, prétendit avoir résolu le problème de l’orgue expressif ; il traça les plans de l’instrument, mais il était trop pauvre pour le construire. Un mécanicien, connaissant son état de gêne, fut le trouver et lui offrit cinq cents écus de son projet, prétendant, en sus, acheter l’honneur de l’invention. Schroeter, indigné, refusa et brûla son plan. Gerber, dans le Dictionnaire des Musiciens, dit que les frères Burons, facteurs français, construisirent, en 1769, à Angers, un orgue qui possédait un mécanisme propre à renfler et diminuer le son.
André Stein, facteur de pianos et d’orgues, construisit, en 1772, un piano organisé, dont le jeu de flûte était susceptible d’expression ; le renflement et la diminution du son dépendaient de la pression des doigts ; mais cette pression avait le défaut de faire baisser on hausser les tons, et, pour jouer juste, il fallait appuyer le genou sur une pommette.
Sébastien Erard se mit également à l’œuvre pour résoudre, d’une manière plus satisfaisante, ce grand problème. Après d’innombrables essais il crut avoir réussi, et il chercha à appliquer son procédé à un orgue qu’il était chargé de construire pour la reine Marie-Antoinette, quelques années avant la révolution : « J’ai touché, dit Grétry dans le troisième volume de ses Essais, imprimés en l’an 1er de la République, cinq ou six notes d’un buffet d’orgues qu’Erard avait rendues susceptibles de nuances ; plus on enfonçait la touche, plus le son augmentait ; il diminuait en relevant doucement le doigt : c’est la pierre philosophale en musique que cette trouvaille. » Les événements qui se succédèrent empêchèrent Sébastien Erard d’achever cet instrument ; mais nous le verrons plus tard reprendre, pour la chapelle des Tuileries, cet ouvrage, qui fut, pour ainsi dire, le précurseur de deux révolutions.
CHAPITRE VIII.
DEUXIEME DIVISION
INSTRUMENTS A CORDES.
Nous suivrons, pour les instruments à cordes, la même marche que celle que nous avons adoptée pour les instruments à vent, c’est-à-dire que nous irons du simple au composé. Nous commencerons par décrire le MONOCORDE, base de tous ces instruments, et si nous venons à parler de l’archet, ce ne sera qu’accidentellement : car, selon nous, les cordes furent pincées et frappées avant que d’être frottées ; il fallait avoir déjà un raisonnement assez grand pour arriver à ce moyen mécanique de vibrations. Si nous examinons attentivement le progrès instinctif chez un enfant nous voyons la percussion précéder tous les autres mouvements pour produire le bruit qui le distrait. L’esprit de l’homme est, dans sa marche, semblable à l’instinct gymnastique chez l’enfant. Etudiez les progrès de son intelligence : dans le principe, il hésite ; puis le courage lui vient ; il se lève, mais il trébuche ; ses pas deviennent ensuite plus assurés ; puis, enfin, sentant sa force, ayant foi en elle, il entreprend une sorte de course au clocher sans s’occuper des obstacles dont le chemin est obstrué ; il marche à pas précipités. Mais si quelques-uns arrivent au but et même le dépassent, combien aussi en est-il qui tombent en route et se cassent le cou avant de l’avoir pu atteindre ! L’homme est toujours un enfant ; la civilisation et l’éducation seules le font changer de nature. L’enfant aime le bruit, préfère une cliquette, un tambour à tout son mélodieux ; voyez si le paysan sans éducation, si le sauvage n’a pas les mêmes préférences. Ils se réjouissent tous deux au son des instruments les plus discordants, de la vielle, de la cornemuse, de la guimbarde ; ils goûtent avec charme les intonnations criardes de la trompette, du trombonne, mêlés au rhythme étourdissant de la grosse caisse. L’éducation musicale seule forme le goût, et si l’art de la musique a été si longtemps retardataire, c’est que cette éducation manquait au peuple ; mais maintenant que la musique fait partie de l’enseignement public, allez, avec le même orchestre, dans un village possédant soit un orphéon, soit une réunion d’instruments, et vous serez chassé par ces mêmes habitants, qui, il y a vingt ans, vous eussent reçu avec joie et bonheur.
Nous avons donc adopté pour les instruments à cordes la division suivante : ils formeront TROIS FAMILLES ; la première comprendra les instruments à cordes pincées ou grattées ; dans la seconde, nous rangerons les instruments à cordes frappées, et, dans la troisième, les instruments à cordes frôlées et frottées.
PREMIERE FAMILLE
INSTRUMENTS A CORDES PINCEES OU GRATTÉES.
Le MONOCORDE, instrument à une seule corde, comme l’indique son nom, dont l’ancienneté se perd dans la nuit des temps, se nommait monochordion mouscorde ; il y en avait deux espèces : celui employé par Ptolémée pour démontrer les rapports mathématiques des sons par la longueur des cordes, et celui qui servit plus tard dans l’enseignement comme espèce de diapason sur lequel on prenait l’intonnation. Le monocorde se composait, dans les premiers temps, d’une caisse carrée, oblongue, à surface plane, sur laquelle était fixé, à chaque extrémité, un chevalet immobile sur lequel était tendue une corde en boyau ou de métal, attachée à demeure d’un côté de la caisse, et retenue, du côté opposé, au moyen d’une cheville qui augmentait ou diminuait la tension par son mouvement rotatoire. Sous cette corde, on promenait un troisième chevalet que l’on fixait aux différents endroits indiqués sur la table de l’instrument ; la corde, ainsi soulevée par le chevalet mobile, rendait un son ou plus grave ou plus aigu, selon les différentes longueurs de chaque partie. Cet instrument, qui fut également appelé MAGAS, a souvent varié dans la construction de ses parties accessoires, mais sa forme générale a presque toujours été identique ; seulement on y ajouta, les uns une corde, les autres deux, mais toujours tendue à 1’unisson, ce qui donna naissance, sans doute, à l’ancienne harpe d’Éole.
La LYRE ancienne se composait d’un coup sonore formé, à ce que disent les anciens auteurs, d’une écaille de tortue et surmontée de deux branches en forme de bras réunis en haut par une traverse à laquelle se trouvaient fixées les cordes.
Diodore dit que Mercure, inventeur de cet instrument, y mit trois cordes ; mais ce nombre fut ensuite augmenté ; elle en a eu jusqu’à huit. Ces cordes se touchaient avec les doigts ou bien avec une espèce de crochet nommé PLECTRE ; on la prenait quelquefois à deux mains, ce qui s’appelait jouer en dedans et en dehors ; on voit beaucoup de lyres tenues dans cette position sur les bas-reliefs égyptiens.
La lyre était en grande estime chez les Grecs. Les chanteurs d’Homère s’en servaient pour accompagner leurs récits. En Égypte, on la trouve figurée dans toutes les cérémonies religieuses, ainsi que dans celles du peuple hébreu.
La lyre existait-elle dans les Gaules avant la domination romaine, ou y fut-elle apportée par le vainqueur ?... Nul ne peut nous le dire ; les historiens, comme les monuments, sont muets à cet égard. Les traces de cet instrument ne se rencontrent pas sur les monuments antérieurs à l’ère chrétienne.
La CYTHARE n’était qu’une variété de la lyre, mais dont la forme était plus allongée ; cet instrument était ordinairement monté de neuf cordes ; ce nombre a augmenté ou diminué ensuite, selon le caprice des artistes ; aussi il y a eu des cithares à vingt-quatre, à douze et même à six cordes. La cythare avait quelquefois la forme d’un triangle équilatéral, comme on la voit figurée sur quelques monuments de Thèbes, qui représentent également une cythare de forme carrée et quelquefois double.
Le PSALTÉRION, appelé psalteire, psalterie, psautier, et auquel on enlevait quelquefois, dans l’écriture et la prononciation, la lettre p, différait, selon saint Isidore, de la cythare par le corps sonore, qui était dans le premier à la partie supérieure, ce qui était le contraire dans le second. Il est assez difficile de bien se rendre compte de cette différence, car il y a des psaltérions carrés, triangulaires, comme l’était quelquefois la cythare ; seulement, nous croyons que cet instrument avait les dimensions plus grandes, puisque, pour en jouer, on le posait sur les genoux ou sur un appui. On a souvent confondu le psaltérion et la cithare avec la harpe. On peut ranger dans la catégorie des lyres, des cythares et du psaltérion, le DODECACHORDON, le NABLE, la SAMBUQIJE.
Le NABLE se composait d’un cadre sonore triangulaire, dont un des angles était tronqué ; les cordes étaient tendues perpendiculairement dans la partie vide du triangle. La SAMBUQUE était le nom d’un instrument à cordes composé d’une boite triangulaire, sur laquelle étaient tendues quelques cordes dans une position horizontales différent en cela du NABLE, dans lequel elles étaient posées perpendiculairement ; il y avait encore le TRIGONE et le MAGADE ; mais M. Kastner pense que ces instruments n’étaient que des sambuques ou du moins des variétés de cet instrument.
Dans le moyen âge, on fit subir, dit-on, au psaltérion antique, diverses modifications ; au lieu d’être simplement formé d’un cadre ou d’un châssis, soit carré, soit triangulaire, laissant vide l’espace traversé par les cordes, l’instrument prit une autre forme ; il se composa alors d’une caisse plate qui forma corps sonore ; elle fut percée de plusieurs trous ou ouïes. Nous croyons que ce n’est pas le psaltérion primitif qui a subi ces modifications, mais que l’instrument que nous décrivons est un nouvel instrument imité du KINNOR des Hébreux, auquel on a donné le nom ancien de psaltérion. Plus tard, on fit subir à la forme de l’instrument de légères courbures rentrantes sur les côtés, et on arrondir les angles saillants ; c’est ainsi qu’on le voit représenté, au douzième siècle, sur les monuments. On ne se contenta pas de ces cintrages légers, on en augmenta encore les proportions et on arriva à lui donner la forme que l’en aperçoit dans les monuments et manuscrits postérieurs.
Le psaltérion se portait fixé ou suspendu devant soi ; les cordes de métal du psaltérion étaient attaquées des deux mains, soit avec les doigts, soit, avec le plectre. Il y avait, suivant Gerson, des instruments à cordes d’argent et d’or mêlé d’argent, souvent simples, mais quelquefois doubles, car le nombre de cordes était aussi variable que la grandeur de l’instrument. Prœtorius dit que le psaltérion était un instrument peu estimé au seizième siècle et placé à peu près au même rang que la chifonie ou lyre des mendiants. Les habitants de l’Italie le nommaient instruments di porco, à cause de sa forme, qui ressemblait à celle d’une hure de cochon, large à son sommet, s’allongeant ou diminuant progressivement jusqu’à l’angle tronqué de la base et représentant un trapèze allongé.
Les joueurs de psaltérion faisaient partie de la musique des rois : Louis X le Butin possédait Guillot, auquel a été payé, dans un compte de la maison de ce prince, 13 livres 19 sols pour cent trente-trois jours de service. On croit généralement que cet instrument fut importé en Europe à la suite des croisades.
Passé le seizième siècle, le psaltérion tend à reprendre sa forme primitive en abandonnant ses cintrages gracieux. Ses cordes alors sont en fil de fer ou de laiton ; l’instrument a deux chevalets sur lesquels portent les cordes, et le coffre se trouve garni de chevilles de fer où les cordes sont fixées, posées ordinairement de deux en deux pour chaque note ; elles sont mises en vibration, soit légèrement avec le doigts, soit au moyen d’une plume fixée à un anneau, que l’exécutant passait à un doigt de chaque main.
La HARPE est un instrument de la plus haute antiquité ; l’Inde, l’Égypte nous offrent, sur des bas-reliefs ou des peintures murales, des représentations de cet instrument qui en font ainsi remonter l’origine au premier âge du monde. La plus ancienne représentation de la harpe est celle qui se trouvait sculptée sur un tombeau situé près des Pyramides de Geesch, et qui date de plus de trois mille ans. Il ne parait pas que cet instrument ait été en grand usage parmi les Grecs, car on ne le trouve mentionné dans aucun auteur, ni même chez les Latins. On ne connaissait dans ces provinces, à ce qu’il semble, que l’instrument triangulaire que nous avons décrit plus haut, auquel la harpe doit son origine, et qu’on retrouve également en Égypte, représenté sur une sculpture de Dakkeh, et sur une autre de Thèbes. On voit ce premier type des instruments à cordes, si simple d’abord, prendre ensuite un corps sonore continué par un montant recourbé, où sont fixées des cordes en boyau ; puis. la corps sonore augmente en dimension, il envahit bientôt toute la hauteur de l’instrument, et une branche droite, placée horizontalement dans la partie supérieure, sert à assujettir les cordes ; voilà la harpe. On peut constater, au Musée de Paris, cette progression, par l’inspection des instruments égyptiens que nous venons de décrire, et qui font partie de cette collection. Dans la suite des temps, on donna plus de grâce à l’instrument, on cintra en arc-boutant la branche supérieure.
Après avoir examiné la harpe égyptienne du Musée de Paris, et s’être convaincu qu’il n’a jamais existé ni colonne ni rien d’équivalent, pour soutenir l’extrémité extérieure de la branche sur laquelle les cordes se trouvaient enroulées, on reste étonné que cette branche pût résister à la tension de vingt à vingt-deux cordes ?
Comment la harpe s’est-elle introduite en Europe ?... quelle route a-t-elle suivie ?... Il est à présumer que, malgré le mutisme gardé à cet égard par les écrivains grecs, la harpe fut d’abord importée chez eux ; car Platon, qui passa treize années en Égypte pour y étudier les mœurs et les institutions, a dû connaître cet instrument, et les émigrations successives, qui eurent lieu sous la septième dynastie des Ptolémée durent la faire importer dans les lieux servant de refuge. On a sans doute connu l’instrument, mais son nom ne nous sera pas parvenu, ou il aura été attribué à un autre instrument, comme nous le voyons à l’époque du moyen âge, où vielle désignait violon, et aujourd’hui ce mot sert d’appellation à un tout autre instrument.
Le nom de harpe n’est pas ancien ; Charles Nodier croit « qu’il est le produit d’une onomatopée du son des cordes de l’instrument, rassemblées en grand nombre sous les doigts et ébranlées simultanément. », C’est dans le poëme de Fortunatus, au sixième siècle, que l’on rencontre le nom de harpe, et Lucinius nomme encore cithara, au seizième siècle, une harpe qui, par sa forme, accuse déjà des temps plus rapprochés. Quoi qu’il en soit, le nom de harpe a très-peu varié dans les langues modernes. Les Anglo-Saxons l’ont appelée hearpa, les Allemands herp et harf, les Anglais arp, les Italiens arpa. Harper est un vieux terme employé encore par Molière et par Sarrazin pour synonyme de prendre, saisir, dérober. Les écrivains, alors, comme ceux d’aujourd’hui, confondaient souvent entre eux beaucoup d’instruments, quitte à leur faire exécuter le plus affreux charivari Ainsi le psaltérion, le nable, le kinnor des Hébreux sont traduits, par eux, par le mot cithara. Pour donner une idée du peu de confiance que l’on doit accorder aux traductions, nous signalerons, avec M. Kastner, le passage de l’Ecriture Sainte, où il est question des instruments de musique, et qui a été traduit de diverses manières, ce qui ne laisse pas que d’embarrasser très fort l’archéologue. Ainsi, au chapitre IV de la Genèse, à l’endroit où Jubal est cité comme le père des musiciens (v. 21), une version latine dit - Fuit, inventor, tangendœ CITRARæ et TESTUDINIS ; une autre : Fuit, pater, canentium, CITHARA et ORGANA ; si nous consultons la version syriaque, nous lisons : CITHARAM et FIDES, la chaldéenne : Ipse fuit magister omnium canentium in NABLIO, scientium cantium CITHARæ et ORGANI ; l’arabe : TYMPANUM et CYTHARAM. En anglais on lit : The father of all such as handle the HARP and ORGAN ; en français : Il fut, le père de tous ceux qui touchent le VIOLON et les ORGUES. On représente toujours le roi David une harpe à la main ; mais quelle était la forme et le nom de l’instrument cité dans le texte hébreu ? S’appliquait-il véritablement à la harpe ? C’est une question que nul n’a pu résoudre.
La harpe fut d’un usage très-commun en France, au moyen âge. Nous avons déjà dit, plus haut, que le barde harpiste était rangé dans la première classe de ce corps vénérable. Cet instrument était familier aux anciens Irlandais et Ecossais, et il forme même la pièce principale des armoiries de l’Irlande. Comme on ne pouvait garnir la harpe d’autant de cordes qu’il en eût fallu mettre pour donner les sons des notes diésées ou bémolisées, ses ressources, quant à la modulation, étaient presque nulles. Vers 1660 on fit, dans le Tyrol, une première tentative pour obtenir un perfectionnement ; mais on n’arriva au but que l’on s’était proposé qu’en 1720, par l’invention des pédales, imaginées par Hochbruker, luthier à Donawerth. En 1740, la harpe à pédale n’était pas encore connue en France ; ce fut un musicien allemand, nommé Strecht, qui l’y introduisit. Hochbruker, neveu de l’inventeur des pédales, en perfectionna le mécanisme en 1770, et puis vint Naderman qui, à la fin du siècle dernier, apporta une grande perfection au mécanisme de la harpe à crochets, dont il était l’inventeur.
La harpe à trois rangées de cordes fut imaginée par Luc-Antoine Eustache, gentilhomme napolitain chambrier du pape Paul V. Un Italien, nommé Pétrius, construisit, au commencement du dix-septième siècle, une nouvelle harpe qui fut, Pendant quelques années, très en vogue à Paris.
Suivant les différents temps et les différents peuples, la harpe a eu plus ou moins de cordes ; maintenant son nombre varie entre trente et trente-six.
La ROTE était un instrument qui participait de la harpe et du psaltérion, avec lesquels on la confondait souvent. Elle avait la forme d’une harpe diminuée elle était également montée de cordes de boyaux. La rote, qui était triangulaire comme la harpe, avait une table ou caisse sonore percée d’ouïes, laquelle embrassait la totalité ou la presque totalité de l’intérieur du triangle et formait un fond placé sous les cordes. Cet instrument ne pouvait être ainsi touché que d’un côté.
Il y avait encore une espèce de petite rote nommée, par les Italiens, ARPANETTA, qui était composée d’un fond plein, d’une caisse sonore, percée d’ouïes, montée avec des cordes de métal.
Ces instruments furent en grand honneur et on lit dans les Lèges Vallicœ, dont quelques documents remontent à quatre cents ans avant l’ère chrétienne, que les trois choses indispensables à. un gentilhomme ou baron sont : sa harpe, son manteau et son échiquier. - Plus loin, on y lit encore que trois choses sont nécessaires à un homme dans sa maison, savoir : une femme Vertueuse, un coussin sur sa chaise et une HARPE bien accordée.
Le LUTH était composé d’un corps sonore de forme ovale et d’un manche plié d’équerre en arrière, où se trouvait fixée une des extrémités des cordes tendues sur la table de résonnance . Cet instrument était fort anciennement connu en Egypte, où on le trouve représenté sur les monuments de la première époque et dans l’Inde également. Les Grecs et les Romains connurent le luth, mais le confondirent souvent avec la lyre et ses dérivées. Le LUTH, nommé également luit, leuth, lue, lus, eut, dans l’origine, dit-on, une écaille de tortue pour corps sonore, ensuite on le construisit en bois ; mais on lui conserva son dos arrondi ; et, de ce côté, au lieu de présenter une surface unie, il fut façonné à côtes ; au milieu de la table de résonnance qui était plate, il y avait une ouverture circulaire découpée ; ce large ouïe s’appelait rose, rosette, rosace. Le corps sonore était adapté à un manche divisé, d’espace en espace, par des sillets formés de cordes de boyaux. Les cordes de l’instrument étaient en boyaux et distribuées sur plusieurs rangs : les uns, simples, composés d’une corde seulement, les autres, doubles, comprenant deux cordes accordées à 1’unisson. Les plus anciens luths avaient peu de cordes ; mais ceux du dix-septième siècle comptaient jusqu’à six rangs de cordes, dont cinq doubles et un rang plus élevé, composé d’une seule corde nommée chanterelle, soit : onze cordes en tout. Ce nombre fut ensuite augmenté de cinq rangs doubles ajoutés au grave, ce qui donna au luth vingt-quatre cordes placées sur treize rangs, savoir : onze de cordes doubles et deux plus élevés, n’ayant qu’une corde chacune. Les huit cordes les plus graves servaient, pour la basse, et les autres, pour la mélodie.
La MANDORE, mandolle, était un petit luth ou dessus du luth, dont le corps sonore était bombé et taillé à côtes comme celui du luth ordinaire, mais avec, le manche plus court : il avait des cordes en boyaux, qui furent d’abord au nombre de quatre, et puis, ensuite, de treize, accordées deux par deux. On faisait vibrer ces cordes avec les doigts ou avec un plectre.
La MANDOLINE ressemblait au luth, quant à la forme du corps sonore, mais elle avait un manche plus court encore. Fort en usage en Italie, cet instrument y fut nommé mandola, mandolina, ce qui le fit confondre quelquefois avec la mandore. Il y avait deux sortes de mandoline : la napolitaine et la milanaise. La première portait quatre rangs de cordes : le plus élevé avait des cordes en boyaux ; le second, en descendant, des cordes d’acier ; le troisième, des cordes de cuivre jaune tordu ; le quatrième, des cordes en boyaux recouvertes de fil d’argent. La mandoline milanaise avait cinq rangs de cordes ; ces deux espèces de mandolines étaient plus petites que la mandore. Le COLACHON était un dérivé du luth, composé d’un petit corps sonore surmonté d’un manche excessivement long et portant deux à trois cordes en boyaux.
Le THEORBE, appelé également téorbe, thuorbe, était une sorte de grand luth qu’on appelait luth-basse et quelquefois chitarrome ; il avait deux manches droits accolés parallèlement sous un grand nombre de cordes. Le premier de ces manches, et le plus petit, était semblable à celui du, luth ; il portait six rangs de cordes de laiton ; le second manche, qui dépassait de beaucoup le premier, soutenait les huit dernières cordes qui étaient en boyaux et servaient pour les basses. Il y avait des dessus et des basses de théorbes ; ces instruments figuraient à l’Eglise et à l’Opéra pour accompagner le chant. L’ARCHI-LUTH était une variété du théorbe, dont la caisse sonore était moins arrondie et un peu plus allongée.
La GUITARE, qui nous vient des Maures, par les Espagnols, a reçu divers noms : guiterne, guiterre, guigerne, etc. Elle différait du luth en ce que son corps sonore, plat et uni en dessous comme en dessus, est échancré sur les côtés ; son manche, au lieu d’être renversé, n’est que légèrement recourbé à l’endroit où sont fixées les chevilles ; les cordes sont de boyaux et fort peu nombreuses dans le principe : les anciens modèles n’en offrent rarement plus de quatre ; un cinquième, puis un sixième rang furent ajoutés dans la suite. Ces rangs étaient presque toujours doubles, à l’exception du premier, en commençant par en haut. Il y avait la guitare moresque ou morache et la guitare latine.
Le CISTRE on cithre, nommé aussi citole, cuitole, tenait du luth et de la guitare : il avait un corps sonore plat, mais qui imitait ordinairement l’ovale sans courbure du luth ; les cordés étaient de métal ; il y avait toute une famille. de cistres que l’on classait selon le nombre des rangs de cordes. On a appelé également le, cistre guitare allemande, d’abord montée de cinq cordes, mais qui en eut sept par la suite. Il y eut également le DIACORDE, guitare à dix cordes ; le BISSEX, guitare inventée à Paris, en 1770, par un nommé Vanheske, et montée de douze cordes.
La PANDORE était le nom donné à un luth à dos plat, ayant la même quantité de cordes que le luth ; mais ces cordes étaient en laiton et portaient des grandeurs différentes, au moyen d’un chevalet posé obliquement sur la table de résonnance. La forme était un ovale, les bords de la table et les côtés de l’instrument étaient tailladés en feston..-L’ORPHEOREON et le PENORION n’étaient que des variétés de la pandore. Ils avaient un dos plat comme celui de la guitare, un encadrement festonné sur les côtés et des cordes de métal.
DEUXIÈME FAMILLE
INSTRUMENTS A CORDES FRAPPÉES.
Nous avons vu que pour diviser la corde du monocorde, il fallait glisser un chevalet mobile sous cette corde. On chercha à remplacer ce déplacement du chevalet par un moyen moins fatigant ; on commença par établir, au-dessous de la corde, un levier eu bascule à son extrémité ; on adapta perpendiculairement, à ce levier, une lame ou de bois, ou de métal et, par le jeu de la bascule, cette lame, venant presser la corde, coupait la vibration, comme le faisait le chevalet. On voulut davantage encore ; on chercha à faire résonner la corde sans l’intermédiaire des doigts et, pour y parvenir, on garnit une seconde lame d’une épingle ; on l’établit verticalement à l’extrémité d’un levier, mais dans une position longitudinale à la corde et par l’effort fait sur l’extrémité du bras ; la lame passait près de la corde que l’épingle accrochait et faisait vibrer, voilà le type d’instruments à clavier et à cordes ; on le nomma MANICORDE. Il était portatif et pouvait se mettre sur une table, ou se porter devant soi pour en jouer en marchant.
Le clavier ne fut, dans son origine, qu’un moyen pour aider à calculer les quantités et les proportions de l’échelle sonore ; on ne se servit, pendant de longues années, pour faire résonner les cordes, que des doigts, de plumes taillées ou de petits bâtons ayant, à leur extrémité, des boules garnies de drap ou d’étoupe.
Le TYMPANUM était une espèce de manicorde dont les cordes étaient mises en vibration par ce genre de percussion. Hébersteit inventa, en 1705, un instrument nommé PENTALON, et le fit entendre chez Ninon de l’Enclos ; c’était un tympanum dont les proportions étaient quatre fois plus grandes, et monté de deux rangs de cordes pour chaque note, l’un de cordes à boyaux, l’autre de cordes métalliques ; l’on frappait les cordes avec deux baguettes. On donna, par la suite, une meilleure construction au manicorde ; ses leviers se régularisèrent, et on l’appela CLAVICORDE. On garnit ensuite les lames d’un petit morceau de plume taillé en épine, et de là vint L’ÉPINETTE qui avait, dans le commencement, vingt-cinq touches, conformément à l’échelle de Guide ; sa forme était carrée ou trapézoïde. Le clavicorde, lui, était plutôt triangulaire, et il était fort en usage en Allemagne, et même il lutta, dans ce pays, contre le clavecin, et conserva longtemps la préférence. Si le son de l’épinette était devenu plus fort que celui du clavicorde, il était bien inférieur encore à celui des autres instruments ; pour l’augmenter, on agrandit le volume de la caisse ; on la construisit en forme triangulaire ressemblant à celle des pianos à queues de nos jours. Cet instrument fut appelé CLAVECIN. En Allemagne, il reçut le nom de clavicymbalun.
Le CLAVECIN Se composait d’une table de résonnance sur laquelle les cordes se trouvaient tendues ; les plaques des touches étaient ordinairement d’os de bœuf pour les touches du genre diatonique et d’ébène pour les touches chromatiques. La barre, qui réglait l’élévation des sautereaux et, par conséquent, l’abaissement des touches, était une planche étroite et massive en bois de tilleul, dont le dessous était garni de deux ou trois lisses de drap pour empêcher d’entendre le choc des sautereaux contre la barre. Le son dépendait de la table et de la justesse du chevalet, du diapason et de la manière d’adapter les barres qui se trouvaient collées contre la table d’harmonie. Le squelette intérieur était en bois de sapin ou de tilleul. Les deux chevalets du diapason, ainsi que ceux placés auprès des leviers, furent presque toujours en bois de chêne, avec la seule différence que le chevalet de l’octave était beaucoup plus bas et plus près des leviers que l’autre ; le sommier, qui est l’endroit où les leviers sont adaptés, fut fait de bois dur, tel que du chêne, et il se trouva solidement fixé des deux côtés pour soutenir la tension des cordes : les guides et les registres intérieurs, en bois de tilleul également garnis de peau pour empêcher le bruit des sautereaux.
Richard, facteur à Paris, substitua, en 1758, de petits morceaux de cuir à la plume pour faire résonner les cordes. Pascal Taskin, de Liège, appliqua, au clavecin, le jeu de buffle et le mécanisme du piano et le perfectionna en 1776. Ruckers, d’Anvers, était renommé comme facteur de clavecin en 1590. Il existe, au château de Pau, un de ses instruments portant cette date ; il est en laque de Chine, avec double clavier et cinq genouillères ; pour changer de ton. A cette époque, ce facteur avait déjà joint, aux deux rangs de cordes de l’unisson, un troisième rang de cordes plus courtes et plus fines, accordées à l’octave supérieur des autres et qu’on pouvait faire entrer en vibration en même temps on séparément ; il imagina également un second clavier, dont l’objet était de faire entendre trois cordes à la fois.
Le clavecin fut, pendant longtemps, le roi des instruments à touches, et ce ne fut que dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, après avoir lutté contre son successeur le FORTE-PiANO, qu’il fut obligé de déposer son sceptre. Il donna naissances au CLAVECIN D’AMOUR, dont les cordes étaient de moitié plus longues que celles du clavecin ordinaire. Au commencement du dix-septième siècle, on fit l’essai d’un CLAVECIN VERTICAL dans lequel des baguettes à têtes recourbées et ajustées à la touche, par une fourchette, allaient frapper les cordes dans le sens de leur position, sur la table d’harmonie, lorsque les touches s’abaissaient et étaient ramenées à leurs position, et que celles-ci se relevaient. La supériorité de cet instrument consistait en ce qu’il produisait un son plus fort et plus durable et même modifiait son degré de force et de faiblesse.
Le CLAVECIN ANCÉLIQIJE se distinguait du clavecin à queue en ce que les cordes, au lieu d’être attaquées par des plumes de corbeau, étaient ébranlées par de petits morceaux de cuir couverts de velours, ce qui donnait au son de la douceur. Il y avait également le CLAVECIN DOUBLE, qui avait la forme de deux clavecins rapprochés l’un de l’autre, ayant, à chaque extrémité, un ou deux claviers au-dessus l’un de l’autre, de façon que deux personnes pouvaient jouer en même temps.
Le grand défaut du clavecin était d’être dépourvu de moyens de nuancer le son, car il n’en rendait que d’uniformes, et le jeu de cet instrument, malgré tous ses différents registres et d’autres améliorations qu’on y introduisit, resta sec et monotone.
Un nommé Gottlob Schrœter, qui vivait en Saxe en 1717, et qui fut toute sa vie dans un état de gêne tel, qu’il ne put jamais exécuter ses projets, conçut, dans ce temps-là, l’idée du piano, et il en construisit deux modèles qu’il présenta inachevés, en 1721, à l’électeur de Saxe, dans l’espoir que ce prince lui fournirait les moyens d’achever son œuvre ; mais il attendit vainement et n’eut en réalité que des promesses. Pendant son séjour à Dresde, il parler de ses instruments à différentes personnes et montra ses essais de telle façon, que peu de temps après, plusieurs facteurs essayèrent de construire cet instrument, dont chacun alors se disait l’inventeur ; on a, à ce sujet, des détails très-étendus dans une longue lettre que Schrœter publia, en 1763, pour revendiquer l’honneur de sa découverte. Cette lettre, très-curieuse sous tous les rapports, contient le dessin d’un de ses modèles. La mécanique était fort simple : le marteau, se mouvant sur une espèce de goupille, était poussé vers la corde par un pilote perpendiculaire à la touche ; l’autre modèle était remarquable en ce que son système de construction consistait à placer les marteaux au-dessus des cordes ; l’auteur n’en donne pas le dessin, disant qu’il avait depuis longtemps abandonné cette idée à cause des imperfections résultant du peu de solidité des ressorts destinés à relever les marteaux de cordes et à cause de la difficulté de remonter les cordes cassées et d’accorder l’instrument.
Les imitateurs de Schrœter s’en tinrent au système des marteaux placés en dessous, système qui a prévalu. Quelques facteurs ont mis, de nos jours, les marteaux en dessus ; le premier qui l’essaya fut Hillebrand, à Paris, en 1783.
Déjà, en 1711, Bartolomeo Cristofali, de Padoue, avait imaginé de substituer des marteaux aux sautereaux du clavecin ; il publia une description de, sa nouvelle invention, sous le titre de : Gravicembalo col piano e forte, avec un système de marteaux suspendus au-dessus des cordes et poussés vers celles-ci par un pilote ; mais il eut alors, comme l’éprouvent encore de nos jours les inventeurs d’instruments nouveaux, à subir l’opposition des professeurs italiens, et son invention resta tout à fait oubliée. Cinquante ans plus tard, cette idée fut reprise, et l’on vit des piano-forte d’Allemagne s’introduire en Italie, et s’y répandre, de même qu’en France et en Angleterre. La priorité des marteaux peut être revendiquée aussi par la France, car un nommé Marius présenta, en 1716, à l’Académie Royale des Sciences, les plans de deux. instruments horizontaux qu’il appelait clavecins à maillet. Le mécanisme de l’un de ces instruments consistait en un marteau suspendu par une goupille et poussé par un levier incliné vers la corde, puis retombant de son propre poids ; l’autre instrument avait les marteaux placés au-dessus des cordes ; les touches, en s’abaissant, les poussaient sur les cordes par un mouvement de levier à bascule, et les marteaux se relevaient par l’effet d’un contrepoids ; il ne mit pas ses projets à exécution.
Godefroy Silbermann, demeurant à Freiberg, en Saxe, fut un des premiers qui construisit régulièrement des pianos ; mais, nous l’avons dit plus haut, il n’en fut point l’inventeur, quoiqu’il y travaillât dès l’année 1740 ; ses instruments avaient, dès l’origine la forme sous laquelle nous désignons aujourd’hui les pianos à queue. Ce fut Frédéric, facteur d’orgues à Géra, qui, en 1758, fabriqua le premier piano carré ; pour le distinguer du précédent appelé, dès son origine, forte-piano, on lui donna le nom de FORT-BIEN, nom qui se confondit bientôt dans celui de PIANO. Ce facteur eut tout de suite beaucoup d’imitateurs, et le piano carré surpassa tout à coup en nombre les pianos à queue.
En 1770, Virbes appliqua, en France, sur un clavecin, un système de marteaux, et, en 1772, un nommé L’Épine, facteur d’orgues, joignit à un forte-piano un jeu d’orgues. Mais la France va bientôt entrer dans la voie du progrès, car voici Sébastien Érard, qui, simple ouvrier, quitte Strasbourg, qui l’a vu naître, pour venir s’établir à Paris, en 1775 ; son premier instrument portait la date de 1778.
Dans l’origine, les pianos à queue coûtaient 450 francs à Ratisbonne ; mais, par suite des améliorations qu’y introduisit Silbermann, tant dans les matières premières employées que dans le finissage, le prix augmenta, et ce facteur, qui mourut en 1783, vendait ces instruments 300 écus, environ 1,000 francs. Sébastien Érard fut le premier qui ait apporté des perfectionnements remarquables à la construction des pianos, et il a puissamment contribué à affranchir sa patrie adoptive du tribut qu ‘elle payait à l’étranger. Avant lui, le petit nombre des pianos fabriqués en France ne pouvait suffire à la consommation, une très-grande quantité de ces instruments, venant d’Angleterre et d’Allemagne, étaient annuellement importés dans le royaume. les pianos anglais l’emportaient déjà, à cette époque, pour la force du son et la solidité de la construction ; mais les pianos allemands avaient, comme ils l’ont toujours conservé, plus de douceur dans le son et plus de facilité dans le. toucher. Sébastien Érard résolut de réunir dans le même instrument ces qualités si diverses ; nous verrons, dans la seconde partie de cet ouvrage, quel fut le résultat de ses travaux.
Pour parvenir à l’état où nous les voyons aujourd’hui, les pianos ont eu a subir trop de changements pour pouvoir les signaler tous : ce serait trop long ; nous nous contenterons d’indiquer les principaux ; mais comme la réunion de ces modifications est curieuse et souvent utile, nous renvoyons les facteurs qui voudront les étudier à notre grand ouvrage sur les instruments de musique anciens et modernes, qui est sous presse et paraîtra très-prochainement ; ils y trouveront peut-être leurs nouvelles découvertes indiquées à des époques déjà reculées. Combien de choses tentées et abandonnée il y a longtemps, puis reprises pour être abandonnées de nouveau ! Nous sommes persuadé, cependant, que, dans le nombre de ces essais, il y en avait de praticables ; le manque de connaissances et l’insuffisance des moyens mécaniques du temps les ont seuls empêchés d’être menés à bien. On a imaginé, en 1839, de plaquer les tables d’harmonie en bois dur, et même on a pris un brevet pour ce procédé. Était-ce là une idée nouvelle ? Non, car, en 1771, un nommé Lemme, facteur à Brunswick, ayant à faire parvenir des instruments à Batavia et craignant que, pendant le voyage, les tables d’harmonie ne se détériorassent, il les plaqua avec un bois à fibres serrées et résistantes.
Il ne faut pas croire que le piano supplanta son prédécesseur sans combat,. à cette époque, on était habitué au son du clavecin. Figurez-vous une armée, de sautereaux armés chacun d’une pointe de plume et égratignant en passant une corde harmonique. ; jugez combien la mélodie devait être maigre et sèche, ce qui n’empêcha pas Balbâtre, organiste de Louis XVI, de dire à Pascal Taskin, qui venait de toucher le premier piano introduit aux Tuileries : « Vous aurez beau faire, mon ami, jamais ce nouveau venu ne détrônera le majestueux clavecin. » On assure que ce fut Balbâtre qui conseilla, dit-on, à P. Taskin, l’ingénieuse idée d’appliquer au clavecin le jeu de buffle.
Un ouvrier nommé Zumpe, qui avait travaillé avec Silbermann en 1745, et qui avait construit ou aidé à construire les premiers pianos, abandonna son patron et s’en fut s’établir à Londres vers 1760, où il y fabriqua des pianos carrés ; il avait boutique dans Hanover-Square. Si l’apparition des clarinettes à l’orchestre de l’Académie Royale de Paris fut annoncée par une affiche, il en fut de même, à Londres, pour le forte-piano, et M. Fétis rapporte le texte de celle qui fut placardée à cette occasion en 1767 ; on y lisait : « Après le premier acte de la pièce, mademoiselle « Brickler chantera un air favori de Judith, accompagné par «M. Dibdin, sur un instrument nouveau appelé PIANO-FORTE. »
Il paraît que si le piano eut à soutenir en France une opposition vigoureuse, cette opposition ne fut pas moins forte en Angleterre ; le goût du clavecin prévalait toujours, ce qui détermina Améric Backers, facteur allemand établi à Londres, d’appliquer le mécanisme des petits pianos à de grands instruments en forme de clavecin, et ce fut, avec John Broadwoord, le Sébastien Érard de l’Angleterre, et avec Stodart, qu’il fit les nombreux essais nécessaires pour réaliser son projet. Ils rejetèrent le mécanisme en usage alors en France comme en Allemagne, qui ne fut d’abord qu’un pilote attaché verticalement à la touche, laquelle poussait à la corde un marteau court et léger suspendu par une charnière en peau et guidé par une tige mince passant par son centre. Stein imagina plus tard l’échappement simple, qui a conservé le nom de mécanisme allemand. Dans ce mécanisme, le marteau retombe aussitôt que le pilote de la touche, a décrit sa courbe éleptique et laissé les cordes vibrer en liberté, bien que le doigt reste sur la touche. Ils rejetèrent alors également, d’un commun accord, l’échappement irlandais imaginé par un ouvrier de cette nation, qui travaillait chez Longmann, prédécesseur de Clémenti et Collard, facteurs habiles dont la descendance occupe aujourd’hui une principale place dans la facture anglaise, et, après bien des tâtonnements, ils trouvèrent enfin un mécanisme nouveau. C’est ce mécanisme, appelé depuis mécanisme anglais ou mécanisme à action directe, dont presque tous les facteurs firent usage en France, concurremment avec le système Petzold, jusqu’à ce que le mécanisme d’Érard fût tombé dans le domaine public.
Érard frères, simples et modestes ouvriers, travaillaient leurs instruments, de leurs propres mains, dans l’atelier qu’ils avaient établi dans l’hôtel de la marquise de Villeroy. Ils ne construisirent d’abord que les petits pianos à deux cordes et à cinq octaves, et remplacèrent la baleine, jusqu’alors employée en Angleterre comme ressorts sur des étouffoirs, par des fils de cuivre. Leur succès tourments les autres facteurs ; il y eut alors, comme aujourd’hui contre Adolphe Sax, coalition. On chercha à faire fermer les ateliers des frères Érard, sous le prétexte qu’ils n’avaient pas de lettres de maîtrise : les maîtres facteurs leur reprochaient quelques infractions à leurs règlements ; mais le roi Louis XVI, juste appréciateur du mérite, après s’être fait rendre compte des travaux de Sébastien et de son frère, leur accorda, de proprio motu, en 1785, des lettres de maîtrise.
Malgré les mouvements politiques qui anéantissaient bien des fortunes, les frères Érard, en 1789, restèrent à leurs ateliers et préparèrent de nouvelles améliorations, car les deux frères marchèrent toujours vers ce but. A cette époque, on vit paraître quelques pianos carrés, à trois cordes, sortant de leurs le mécanisme était déjà modifié par un faux marteau ou double pilote placé en intermédiaire entre la touche et le marteau, ayant pour objet de rectifier, autant que possible, l’action du marteau. À cette époque, également, Sébastien (car, dans la famille Érard, c’est toujours Sébastien qui conçoit et son frère qui exécute) modifie la grosseur des cordes, auxquelles on avait conservé celle des clavecins, quoique la différence des moyens d’attaque dût faire apercevoir que, s’il fallait des cordes fines qui pussent être mises facilement en vibration par le mouvement d’un petit sautereau armé d’un bec de plume, il devait en être autrement quand ces cordes étaient percutées violemment pur le choc répété d’un marteau ; mais en donnant plus de volume aux cordes, il fallut également donner plus d’énergie, plus de force au moyen d’attaque en augmentant la force des leviers.
« Depuis son enfantement, le piano, dit M. Fétis, si chétif à ses premiers jours, a bien grandi et s’est bien fortifié. Ceci, ajoute-t-il, me rappelle :une anecdote qui démontre combien il est difficile d’arriver à des idées justes et à des principes vrais concernant la construction des instruments. Voici mon anecdote ; je la tiens d’un ami, qui parlait en témoin oculaire. Mozart était à Augsbourg en 1777 ; de cette ville il écrivit à son père une lettre dans laquelle il exprimait une grande admiration pour les pianos de Stein qu’il venait de jouer. Stein, d’Augsbourg, et Spaeth, de Ratisbonne, étaient alors les deux meilleurs facteurs de pianos d’Allemagne. Dans cette lettre, Mozart s’exprime ainsi : « Il est vrai que Stein ne donne pas ses pianos à moins de 30 florins (600 francs environ) ; c’est beaucoup d’argent ; mais on ne peut trop payer la peine et le zèle qu’il y met ;..... ses pianos sont de longue durée. Il garantit la solidité de la table d’harmonie. Lorsqu’il en termine une, il l’expose à l’air, au soleil, à la pluie, à la. neige, en un mot, à toutes les intempéries de l’air, afin qu’elle se fende ; alors, au moyen de languettes qu’il colle solidement, il remplit les crevasses. Lorsqu’une, table d’harmonie est ainsi préparée, on peut affirmer qu’il ne lui arrivera aucun accidents » Que diraient nos facteurs modernes d’un semblable procédé ? En 1786, le comte de Bruhl, ambassadeur de Saxe à Londres, fort bon mécanicien et joueur d’échecs renommé, essaya d’obtenir un son meilleur dans les. pianos en substituant aux cordes en fil de fer des cordes d’acier chauffées au bleu ; dans ce temps, la moindre tension était de 10 livres par corde, ce qui faisait 2.,400 livres de tension pour les deux cent quarante cordes dont étaient montés les premiers pianos.
TROISIÈME FAMILLE.
INSTRUMENTS A CORDES FROLLÉES ET FROTTÉES.
L’idée de tendre une corde sur un corps sonore, dit M. Kastner dans sa dissertation sur la DANSE DES MORTS, et celle de faire vibrer cette corde au moyen de la Percussion ou du frottement, parait avoir été aussi naturelle à l’homme que l’action de percer un roseau, une corne ou un coquillage et de souffler dedans pour en tirer des sons.
Le MONOCORDE est le type primitif de tous les instruments à cordes. Il y avait deux espèces de monocordes, l’un qui était employé par les savants du moyen âge pour leurs études spéculatives sur la théorie des sons ; il servait également, comme de diapason, pour l’enseignement de la musique vocale dans les écoles ; on le nommait canon, qui signifie règle. La structure du monocorde scolastique subit certaines modifications partielles, selon le caprice ou le besoin des théoriciens. On ne se contenta pas toujours de la corde unique dont il était monté pour les premières expériences, on en employa une seconde, puis une troisième, et il arriva insensiblement à posséder douze à quinze cordes. Dès ce moment, le monocorde ne représenta plus l’idée de cet instrument, car il n’était plus monocorde, c’est-à-dire à une corde. Le second monocorde était à archet et on le nommait aussi tympanischiza, On donna également le nom de TROMPETTE MARINE à Cet instrument que les Allemands appelèrent trumschect et plus tard Trumpeten-Geige, violon-trompette.
On lit dans Prætorius : « Les Allemands, les Français et les habitants des Pays-Bas emploient un instrument qu’ils appellent tympainschiza, et qui se compose de trois petites planches très-minces jointes grossièrement, sous la forme d’une pyramide triangulaire très-allongée. Sur la planchette supérieure, autrement dit sur la table de résonnance, est tendue une longue corde de boyau, que l’on fait vibrer par le moyen d’un archet fait avec du crin de cheval, enduite de colophane.
« Quelques-uns ajoutent une seconde corde plus courte de « moitié que la première, afin de renforcer celle-ci par l’octave « aiguë. Cet instrument doit être fort ancien. Les musiciens ambulants eu jouent dans les rues. L’extrémité pointue où « étaient fixées les chevilles, était appuyée contre la poitrine de « l’exécutant ; l’extrémité triangulaire opposée était placée en « avant du musicien. On soutenait l’instrument avec la main « gauche et l’on en effleurait légèrement les cordes avec le pouce « de la même main ; la main droite faisait manœuvrer l’archet.» On peut regarder comme un dérivé de la trompette marine le BEDON, il en avait la forme ; c’était une caisse carrée, longue, étroite et percée, à chaque bout, d’une ouïe ou rosace. La table était surmontée de six cordes, dont une grosse et une fine alternativement.
La BASSE DE FLANDRE était également une sorte de trompette marine ; elle se composait d’un simple bâton sur lequel on tendait une ou deux cordes. Sous ces cordes on plaçait une vessie de cochon pour faire le bourdon ; les aveugles et les mendiants joignaient cet instrument à leur orchestre. Les nègres de l’île Maurice ont un instrument de semblable nature..
La HARPE D’EOLE fait exception à toutes les données que nous avons posées ; elle est le seul instrument qui produise des sous sans le secours d’un joueur ou d’un mécanisme ; les cordes de la harpe éolienne sont mises en vibration au moyen d’un courant d’air. C’est une espèce de photographie musicale : l’homme n’est pour rien dans l’exécution. Cet instrument, consiste en une espèce de caisse longue d’à peu près deux mètres et d’environ vingt-un centimètres de hauteur et de largeur, confectionnée avec de petites planchettes en sapin de six millimètres d’épaisseur ; la partie supérieure, ou couvercle, est faite également d’un bois léger et vibrant ; la face postérieure reste ouverte, à chaque extrémité du couvercle est adapté un chevalet en bois dur, haut de treize millimètres ; en dehors d’un de, ces chevalets sont plantées de petites pointes métalliques où les cordes, fixées à demeure, vont aboutir à l’autre extrémité de l’instrument et derrière l’autre chevalet, à des chevilles ajustées à travers la table dans un petit écrou en bois dur, qui sert à les maintenir dans la position qu’on leur imprime pour l’accord, et qui empêche en même temps que la tension des cordes ne fasse rompre le couvercle. On applique ordinairement huit à douze cordes à boyau, de force égale, que l’on tend tout à fait lâches, non pas pourtant assez pour qu’elles branlent, mais de manière à donner un ton appréciable et déterminé, puis on les accorde toutes à l’unisson. On place ensuite l’instrument dans un courant d’air, de façon que le vent puisse se glisser sur les cordes., Nous renvoyons le lecteur, pour de plus longs détails, au bel ouvrage que M. Kastner a consacré à la HARPE D’EOLE.
La VIELLE est un instrument fort ancien ; mais, malgré son antiquité, nous ne croyons pas Jean de Meung, quand il dit dans son Roman de la Rose, en parlant d’Orphée, qu’il faisait après soi aller les bois par son beau VIELLER. Nous suspectons même Alexandre de Bernai, dit de Paris, qui vivait sous Philippe-Auguste, et qui, dans son roman d’Alexandre le Grand, faisant la description d’un palais occupé par son héros, parle de deux statues, dont une représentait un joueur de vielle.
Pour constater l’antiquité d’un instrument, il faut le débarrasser de tous les accessoires qui ont pu servir à le perfectionner, lui rendre sa simplicité primitive, et chercher alors si sa forme ne rappelle pas un instrument connu anciennement. Ainsi, si vous dépouillez le piano de ses marteaux en peau, vous arrivez au clavecin et aux sautereaux armés de plume et de drap. Enlevez ces sautereaux et les touches, que reste-t-il ? le tympanon, que l’on frappait avec des bâtons comme ceux employés par les cymballiers ; privez encore cet instrument et des bâtons et de la caisse, que trouvez-vous ? la harpe, connue de toute antiquité.
La vielle est un instrument trop compliqué pour qu’il n’ait pas subi bien des perfectionnements ; enlevons-lui ses différentes parties, et nous la réduisons à un corps concave armé d’un manche, sur lequel des cordes sont tendues. Retrouvons-nous dans l’antiquité quelque chose de semblable ? Oui, le canon ou le chelys, monocorde que l’on voit figurer sur une foule de monuments de la plus haute antiquité ; le chelys antique est donc la souche de la cythare ou la guitare, de la rubeblée, de la vielle, et l’on voit que le chelys est le père de tous les instruments de musique à corps concave et à manche, soit qu’on mette leurs cordes en vibration en les frappant, en les pinçant ou en les frottant.
Les monuments anciens, surtout ceux de l’ordre gothique, présentent dans les sculptures dont ils sont ornés une foule de faits intéressants pour l’histoire de la vielle. Mais ce qui donne à ces faits un caractère de véracité de plus, c’est qu’ils se trouvent confirmés par les récits des historiens, par les poésies, par les fabliaux, par les chansons des troubadours, des trouvères, des ménestrels, des jongleurs, etc. Tous ces monuments de l’art musical et littéraire, conservés dans les principales bibliothèques, font connaître et expliquent toutes les phases de la vielle.
De quelque manière que la vielle se soit formée par degrés, il paraîtrait, selon M. Burette, membre de l’Académie des Belles-Lettres, dans le tome 8 du recueil des Mémoires, que les anciens ont connu la vielle ; car il dit que « les anciens avaient sur quelques instruments une espèce de bourdon qui soutenait le chant en faisait sonner l’octave quinte, bourdon où se trouvait aussi la quarte, par la situation de la corde du milieu. » Puis il ajoute : « Les anciens, à la vérité, ne nous ont rien laissé par écrit, touchant ces sortes de bourdons ; mais nos vielles et nos musettes, qui, vraisemblablement, nous viennent d’eux, suffisent pour appuyer une telle conjecture. » Si nous consultons le Dictionnaire de Feuretière, à l’article Vielle, il est dit que les anciens la nommaient par excellence symphonie. La vielle était encore nommée, au treizième siècle, syphonie, chifonie et cyfoine, par corruption du nom primitif. On croyait qu’elle venait de la Grèce, comme l’indique son nom, sarbuckê, dont les Latins ont fait sambuca, et le père Joubert, dans son Dictionnaire, définit la vielle par le nom de sambuca rotata ce qui nous prouve qu’il y avait. des vielles avec et sans roues.
Le goût de la vielle nous fut sans doute importé d’Italie, car un auteur, Constantinus Africanus, moine du mont Cassin, dans un traité de médecine, conseille de faire entendre aux malades le son de divers instruments, parmi lesquels il dite la vielle. Ante infirmum dulcis sonitus fiat de musicorum generibus ; sicut campanula, vidula rota et similibus. (De Morbor. curat., chap. 16).
La vielle n’eut pas toujours la forme que nous lui voyons aujourd’hui ; elle ne fut d’abord qu’une sorte de guitare, assez semblable à la mandoline, et ses cordes étaient mises en vibration au moyen d’un morceau de plume, espèce de plectrum ; plus tard on lui substitua une sorte d’archet, composé d’un morceau de bois denté, dont les dentelures étaient recouvertes en peau. Mais, jusqu’à ce moment, les doigts seuls appuyaient sur les cordes, le long du manche, pour marquer les différentes notes ; le clavier ne fut adapté que postérieurement ; car, dans les temps primitifs, la vielle avait la forme d’une viole, et c’est ainsi qu’elle est représentée sur les manuscrits anciens. Comme l’archet employé alors ne permettait pas de filer des sons, de leur donner plus ou moins d’ampleur, on lui substitua une roue, sur laquelle les cordes vinrent s’appuyer plus ou moins fortement ; et une petite manivelle servit à faire mouvoir cette roue. Cet instrument était fort en faveur en France, vers l’an 1085. Dans ce siècle, elle animait les meilleurs concerts. Nicolas de Bray, dans sa Vie de Louis VIII, en parlant d’une fête qui se donna sous le règne de ce roi, dit que les comédiens firent leur entrée sur le théâtre au doux son de la vielle et de plusieurs autres instruments.
Sous saint-Louis, la vielle faisait le charme de toutes les réunions ; la reine Blanche s’en servait pour amuser le monarque.
La vielle était l’instrument dont se servait Thibaut, comte de Champagne, pour accompagner les vers qu’il adressait à la reine Blanche, sa blonde couronnée.
La vielle continua d’être très-cultivée sous les règnes suivants ; car, sous Philippe le Hardi, nous voyons apparaître le poëte Adenez, ménestrel de Henri, duc de Brabant, père de la reine Marie, seconde femme du roi de France. Ce ménestrel employait la vielle pour accompagner ses chants. Il est prouvé, par un compte de l’hôtel de Jean, duc de Normandie, depuis roi, de l’année 1349, que l’on désignait sous le titre de menestreux tous ceux qui jouaient de la vielle, sans indiquer leur genre d’instrument ; mais, quand ils faisaient usage d’autres instruments, on ajoutait à la suite l’instrument ainsi menestreux tout seul indique un joueur de vielle ; les autres sont dits ménestrel du cor sarrasinois, ménestrel de naquaires, menestrel de trompettes (Ducange, Mémoire de Joinville).
On l’appelait parfois chifonie. En effet, on lit dans la Chronique manuscrite de Bertrand du Guesclin, que deux ménétriers d’un roi de Portugal jouaient d’un instrument nommé chifonie, instrument qui était pendu au col avec une sangle ; instrument dont, suivant ce manuscrit, on jouait alors en France et en Normandie.
Ce fut vers le quatorzième siècle que les aveugles et les pauvres s’emparèrent de cet instrument pour gagner leur vie. Les aveugles se sont appropriés la vielle en France, comme en Espagne ils ont adopté la guitare ; et chose assez remarquable, c’est que, dans ce dernier pays, ils ont donné leur nom d’aveugle (ciegos) à tous les musiciens ambulants, qu’ils y voient ou qu’ils n’y voient pas, ainsi qu’à leurs romances ; et à la fin du dix-huitième siècle, on envoyait les ciegos (ménétriers très-voyants) pour jouer dans tous les bals de société.
Etant devenu l’instrument de l’indigence, il arriva à la vielle ce qui arrive à la plupart des choses dont l’usage est arbitraire et qui dépend du goût. Il y a cent ans, une personne d’un certain rang n’aurait pas osé jouer du violon ; depuis, cet instrument a reconquis ses parchemins, et l’espèce de mépris où il était tombé n’a jamais pu porter la moindre atteinte à son mérite. Il eût dû en être de même de la vielle ; cependant elle fut négligée par la cour.
Au seizième siècle, nous revoyons la vielle reprendre ses anciens droits et occuper place à la cour. En 1515, les vielleux font partie du corps de musique qui assiste au cortège de François 1er à son entrée dans Paris ; ils étaient vêtus de damas blanc et marchaient après le chancelier. Durant ce siècle, les ménétriers chantaient les chansons de geste en s’accompagnant de la vielle que l’on nommait alors symphonie, ainsi que nous l’apprend le Propriétaire en françoys, cité par Francisque Michel dans la préface de la chanson de Roland ou de Roncevaux.
Le commencement du dix-septième siècle ne fut pas favorable au progrès de l’instrument dont nous parlons. La musique ne fleurit pas beaucoup sous le règne de Louis XIII ; mais on vit, sous le règne de Louis XIV, la vielle reprendre sa première popularité. La voici qui figure dans les chansons de Gautier Garguille, en 1640. Dans la Vraye Histoire comique de Francion, qui date du commencement du dix-huitième siècle, Ch. Sorel introduit au quatrième livre un joueur de vielle, qui fait danser le pédant Hortensius et ses convives. l’exécution de la vielle était lente, d’où est venu le proverbe long comme une vielle, long dans tout ce que l’on fait. On disait également pour désigner un homme dont l’humeur est aisée, accommodante, faisant tout ce qu’on désire Il est du bois dont on fait des vielles, comme aujourd’hui on dit : Il est du bois dont on fait des flûtes.
Si la vielle était alors l’instrument des pauvres, nous la verrons devenir bientôt aussi celui de la cour entre les mains de deux exécutants. L’un se nomme La Roze. Quoique faible musicien, son talent consistait à jouer les menuets, les entrées, contredanses et vaudevilles de ce temps-là ; il les exécutait délicieusement : c’était à qui pourrait le posséder. Il joignait à son talent d’exécution une jolie voix qu’il conduisait avec goût. Toute la cour voulut entendre La Roze. Peu de temps après, on vit paraître un autre joueur de vielle, qui acquit encore plus de réputation : son nom était Janot. Il jouait avec perfection les contredanses et autres airs de l’époque où il vivait ; il chantait aussi fort bien les vaudevilles, en s’accompagnant avec sa vielle. On doit à La Roze et à Janot deux chansons qui nous sont parvenues ; l’une commence par ces mots : Je vis content avec ma vielle ; et l’autre, Dieu qui fait tout pour le mieux.
En 1701, la vielle était encore telle qu’elle avait été sous la fin du siècle précédent ; sa forme était à peu près carrée, comme sont encore les anciennes vielles de Normandie ; il n’y avait que trois cordes, dont deux étaient des chanterelles ; la troisième était beaucoup plus grosse, on la nommait voix humaine ; de loin, elle faisait assez bon effet, mais, de près, elle n’était pas supportable. L’étendue de l’instrument était toujours la même ; le son était fort mince et presque entièrement absorbé par le tassement de la trompettes On chercha à en corriger les défauts. Le sieur Bâton, luthier à Versailles, fut le premier qui travailla à perfectionner la. vielle : ayant chez lui plusieurs anciennes guitares dont on ne se servait plus depuis longtemps, il imagina, en l’année 1716., d’en faire des vielles. Le sieur Bâton ajouta aussi au clavier de cet instrument le mi plein et le fa d’en haut ; il orna ses vielles avec des filets d’ivoire, il donna au manche une forme plus agréable et à peu près semblable aux manches de basses de viole. Le sieur Bâton se dit : Puisque les vielles montées sur des corps de guitare ont eu tant de réussite, cet instrument doit prendre encore des sons plus moelleux en le montant sur des corps de luth et de théorbes. Il exécuta donc cette nouvelle idée en l’année 1720, et les vielles en luth eurent encore un plus grand succès que les autres. Ce fut alors que la vielle fut admise dans les concerts ; les sieurs Baptiste et Boismortier composèrent des duo et des trio pour cet instrument.
Le sieur Denguy fut le premier qui sortit la vielle de son ancienne sphère, sous le rapport de l’exécution de la musique, et la réputation qu’il s’acquit dans l’art de jouer de la vielle se soutint pendant longtemps. Bâton, fils de celui qui avait réformé la vielle, a composé plusieurs livres d’airs pour la vielle ; le premier est dédié à mademoiselle Louise-Anne de Bourbon-Condé-Charolais ; le second à madame la duchesse Caroline de Hesse-Rhisfeld.
Louvet, luthier à Paris, ajouta le sol d’en haut à cet instrument.
Les instruments à cordes, à manche et à archet, composent aujourd’hui une famille spéciale ; leur auteur nous vient de l’Occident, disent les uns, et de l’Orient, disent les autres. Les manuscrits, écrits ou figurés, qui nous restent des peuples qui ont habité l’Orient, n’ont pu fournir, jusqu’à présent, aux savants et aux archéologues, la moindre trace authentique de l’usage de l’archet parmi les Egyptiens, les Grecs et les Latins. D’autres monuments établissent, au contraire, que cet usage remonte, en Europe, à une haute antiquité. Ni. Fétis croit l’instrument à archet originaire de l’Inde, et il pense que, de ce pays, il s’est répandu d’abord en Asie, ensuite en Europe. Dans l’Inde, dit cet écrivain, il n’y a pas de conjectures à faire, car le-, instruments existent : ils conservent encore les caractères de leur originalité native. Si l’on veut trouver l’instrument à archet dans son origine, il faut le prendre dans sa forme la plus simple et dans ce qui n’a pas exigé le secours d’un art perfectionné.
« Nous le trouvons dans le ravanastron, composé d’un cylindre de bois de sycomore creusé de part en part, continue M. Fétis, dans un travail fort remarquable que cet éminent musicologue a consacré, sur l’invitation de M. Vuillaume et d’après ses recherches, à la mémoire de Stradivarius. Ce cylindre est long de 11 centimètres, et son diamètre est de 5 centimètres. Sur un de ses côtés est tendue une peau de serpent boa à écailles larges, qui est la table d’harmonie. Le cylindre est traversé de part en part, au tiers de sa longueur vers la table, par une tige qui sert de manche, longue de 55 centimètres, arrondie dans sa partie inférieure, plate dans le haut et légèrement renversées. Cette tige est en bois de sapan. La tête de ce manche est percée de deux trous de 12 millimètres de diamètre pour les chevilles, non sur le côté, mais sur le plan même de la table. Deux grandes chevilles, longues de 10 centimètres, taillées en hexagone vers la tête et arrondies à l’extrémité fixée dans les trous, servent à tendre deux cordes d’intestins de gazelles, lesquelles sont fixées à une lanière de peau de serpent attachée au bout inférieur de la tige. Un petit chevalet, long de 18 millimètres, taillé en biseau dans le haut, plat dans la partie qui pose sur la table, évidé rectangulairement dans cette partie, de manière à former deux pieds séparés : tel est le support des cordes. A l’égard de l’archet, il est formé d’un bambou mince, légèrement courbé en arc dans sa partie supérieure et droit dans l’inférieure. Un creux, taillé dans la tète jusqu’au premier nœud, sert à fixer une mèche de crins, qui est tendue et fixée à l’autre extrémité par vingt tours d’une tresse de joncs très-flexibles. »
Nous ne voulions prendre à l’ouvrage que vient de publier M. Fétis sur Stradivarius qu’une courte citation, mais, il nous est impossible de nous arrêter, et nous nous voyons forcé, de lui faire un emprunt plus considérable. Nos lecteurs y auront bénéfice, car tout ce qui sort de la plume de cet écrivain érudit est empreint d’un grand esprit de recherche et d’un savoir fort étendu.
« A une époque sans doute postérieure à l’invention de l’instrument dont il vient d’être parlé, appartient l’omerti, autre instrument à archet, monté de deux cordes, dans lequel on aperçoit quelques progrès de fabrication. Le corps est formé d’une, noix de coco dont on a enlevé le tiers, dont on a aminci les parois jusqu’à l’épaisseur de 2 millimètres, et qu’on a polie intérieurement et extérieurement. Quatre ouvertures elliptiques et une autre dans la forme d’un losange sont pratiquées à la partie antérieure du corps pour servir d’ouïes. Je possède deux de ces instruments ; dans l’un d’eux, la table est formée d’une peau de gazelle bien préparée et très-unie ; dans l’autre, cette table est une planchette de bois satiné à maille très-fine, de 1 millimètres d’épaisseur. Dans les deux instruments, la largeur de cette table, au plus grand diamètre, est de 0m,5,15. Comme dans le ravanastron et le rouana, le manche est formé d’une tige en sapan (bois rouge de l’Inde) qui traverse le corps de l’instrument. La, partie inférieure est arrondies, forée longitudinalement à sa base pour y introduire un cylindre termine par un bouton, comme dans le rouana. Ce bouton est un petit cube percé d’un trou, où, les cordes sont attachées. Le manche est aplati dans sa partie supérieure et se termine par une tête renversée, coupée à angles droits. Les chevilles ne sont pas placées sur sa tête, mais toutes deux à gauche du manche, et la tête est percée de part en part par une ouverture longitudinale de 6 centimètres de longueur et de 12 millimètres de largeur, pour introduire les cordes dans les trous des chevilles. c’est un commencement de la volute. Enfin, au bas de l’ouverture, est un petit sillet en ivoire, haut de 1 millimètre, sur lequel les cordes sont appuyées. Le chevalet, sur lequel elles passent à l’autre extrémité, est exactement semblable à celui du ravanastron. L’archet, plus long que celui de ce dernier instrument, est fait aussi d’un léger bambou qui forme l’arc. A son extrémité supérieure est une fente dans laquelle la mèche de crins est fixée. mais. au lieu d’être attachée par un lien en jonc à l’autre extrémité, cette mèche traverse le bambou et y est arrêtée par un nœud.
« Il est impossible de méconnaître l’omerti dans la kemângch à gouz des Arabes ; il suffit en effet de jeter les yeux sur celle-ci pour reconnaître leur identité. Le corps de l’instrument, dans l’un comme dans l’autre, est une noix de coco dont on a retranché le tiers ; des ouvertures sont percées dans le corps de la kemângch, comme dans l’omerti, pour mettre en communication l’air extérieur avec celui qui est contenu dans l’instrument ; la seule différence est que ces ouvertures sont petites, en très-grand nombre et rangées symétriquement dans l’instrument arabe. Dans celui-ci, comme dans l’autre, la table d’harmonie est une peau fine collé sur les bords de la noix de coco. Le manche est une tige cylindrique en bois de courbary, terminée, dans sa partie inférieure, par une large virole d’ivoire. Cette tige, depuis le corps de l’instrument jusqu’à la naissance de la tête, est longue de 66 centimètres. La tête, creusée comme celle de l’omerti peur y placer deux chevilles, est faite d’un seul morceau d’ivoire haut de 20 centimètres. Au lieu d’être toutes deux sur le côté -gauche, comme dans l’instrument de l’Inde, une des chevilles est à droite de la tête, l’autre à gauche. La tige du manche, forée longitudinalement, reçoit un cylindre de fer qui traverse le corps de l’instrument, et qui, au lieu d’être terminé par un bouton, comme dans l’omerti, se prolonge extérieurement pour former un pied de 25 centimètres de longueur. A ce pied est un crochet auquel s’arrête l’anneau qui sert de cordier. Les cordes sont la partie la plus curieuse de cet instrument, car elles sont formées chacune d’une mèche de crins noirs fortement tendue. L’archet est composé d’une baguette de figuier-sycomore, façonnée au tour et courbée en arc, à laquelle est attachée et tendue une mèche des mêmes crins.
« Les instruments dont on vient de voir la description ne sont pas, à proprement parler, dans le domaine de l’art ; ils appartiennent à la musique primitive et populaire, expression instinctive d’un sentiment qui, partout, a précédé l’art véritable. On doit ranger dans la même catégorie, et comme des variétés, certains autres instruments faits d’après le même principe, et dont la diversité des formes paraît n’avoir eu d’autres causes que la fantaisie. Tel est le REBAB des Arabes, qui n’entre dans aucune combinaison d’instruments dont se forment les concerts dans les contrées orientales, et qui n’a d’autre destination que de guider les voix des poëtes et des conteurs dans leurs récitations chantées. Le corps du rebab est formé de quatre éclisses sur lesquelles sont tendus deux parchemins qui forment la table et le dos. Cet ensemble présente l’aspect d’un trapézoïde dont le sommet est parallèle à la base, et dont les côtés sont à peu près égaux . Le manche est cylindrique et ne fait qu’une seule pièce avec la tête. Le pied est une tige de fer fixée dans le manche, laquelle traverse l’instrument. Le rebâb se pose sur ce pied, comme le kemângch à gouz. Il y a deux sortes de rebâb, qui ont tous deux la même forme : le premier, appelé rebâb de poëte, n’a qu’une corde ; l’autre, qui en a deux, est nommé rebâb de chanteur. A vrai dire, le rebâb n’est qu’une modification du rouana de l’Inde, modification qui ne consiste que dans la forme du corps de l’instrument. Le rebâb n’appartient pas à la musique proprement dite ; ce n’est que l’usage originaire de la corde frottée par l’archet pour le soutien de la voix chantante.
« Transportons-nous maintenant en Europe ; examinons-y les plus anciens monuments et les premiers renseignements recueillis sur les instruments à archet ; nous y retrouverons les mêmes rudiments de ce genre d’instruments : Rien dans l’Occident qui ne vienne de l’Orient. En plusieurs endroits de mes écrits, j’ai dit et répété cette vérité.... Aujourd’hui, sans aucune restriction, je répète encore : Rien dans l’Occident qui ne vienne de l’Orient. Le goudok des Russes, avec ses trois cordes, sa volute, sa touche placée sur le manche, sa caisse sonore régulièrement construite, ses ouïes dans la table d’harmonie, son chevalet proportionné à la longueur des cordes, son cordier semblable à celui de nos violons, est une viole déjà perfectionnée et ne ressemble pas à un essai primitif. Le goudok tire aussi son origine de l’Orient.
« Aucunes traces de l’existence des instruments à archet n’apparaissent sur le continent européen avant la fin du huitième siècle ou le commencement du neuvième. » (FÉTIS, Recherches historiques et critiques sur l’origine des instruments à archet.)
Il y aurait beaucoup à dire pour et contre les opinions émises par MM. Kastner et Fétis sur l’origine des instruments à archet. Nous consacrons, dans l’ouvrage que nous avons déjà indiqué, un long chapitre à ce sujet si controversé, et nous cherchons l’origine de l’instrument, non dans la forme du corps sonore, mais dans le moyen employé pour obtenir la vibration des cordes, c’est-à-dire que nous n’avons pas porté nos recherches sur l’instrument, mais sur l’archet ; et, remontant avec les manuscrits, les médailles et les sculptures des monuments, nous arrivons à les découvrir dans des pays où l’esprit indien n’a jamais pu parvenir. Mais, quoi qu’il en soit de cette origine, nous allons décrire les instruments de cette espèce qui furent en usage en Europe et dont il nous reste des vestiges.
Le premier de ces instruments est le CROUTH, traduction littérale du criut des Gallois, du crwt des Cambrésions, du crudh des Anglais-Saxons, du crowd des Anglais. On avait donné, dans le vieux langage, à cet instrument, le nom de rotte, rote, rocte ou rothe, corruption du bas latin chrotta, rotta, rocta, comme on peut le voir dans Fortunatus.
Il y avait deux sortes de crouth appartenant à des époques différentes ; le plus ancien est le crouth trihant ou à trois cordes, réputé moins noble que celui qui lui succéda, lequel avait six cordes. Nous avons déjà dit que le barde du quatrième ordre ne pouvait jouer que du crouth trihant. On ne saurait déterminer à quelle époque le crouth à six cordes a succédé à son devancier ; tout ce que l’on est parvenu à savoir, c’est que, au temps du barde Edouard Jones, ils existaient tous les deux. Voici la description que ce barde donne de cet instrument ; « Un joli coffre (sonore) avec un archet, un lien une touche, un chevalet ; sa valeur est d’une livre, Il a la tête arrondie comme la courbe d’une roue et perpendiculaire à l’archet au petit crochet, et de son centre sortent les accents plaintifs du son, et le renflement de son dos est semblable à celui d’un vieillard, et sur sa poitrine règne l’harmonie. Dans le sycomore nous trouvons la musique. Six chevilles, lorsque nous les vissons, tendent les cordes, et ces six cordes sont ingénieusement imaginées pour produire cent sons sous l’action de la main, une corde pour chaque doigt est vue distinctement, et les deux autres sont pour le pouce. »
Les crouth, dit M. Fétis dans l’ouvrage déjà cité, avaient la forme d’un trapézoïde allongé, dont la longueur, du sommet à la base, était de 57 centimètres ; la plus grande largeur, près du cordier, avait 27 centimètres, et la plus petite, au sommet du trapèze, 23 centimètres. L’épaisseur de la caisse sonore, composée de deux tables de sycomore et d’éclisses, était de 5 centimètres, et la longueur de la touche, de 28 centimètres. Des six cordes dont l’instrument était monté, deux étaient en dehors de la touche et étaient pincées à vide par le pouce de la main gauche ; les quatre autres, placées sur la touche, se jouaient avec l’archet. Ces corde étaient attachées par leur extrémité inférieure au cordier, fixé de la même manière que dans les anciennes violes ou quintons. Dans certains instruments, ce cordier offrait, au point d’attache des cordes, une ligne droite et parallèle à la base du crouth ; mais, dans d’autres, ce cordier avait la direction oblique. L’extrémité supérieure des cordes passait par des trous percés dans le massif du haut de l’instrument, s’appuyant sur des sillets, et était attachée au revers de la tête par des chevilles, lesquelles se tournaient avec une clef ou levier, à la manière de la guitare.
La table était percée par deux ouïes, du diamètre de trois centimètres ; le chevalet était la partie la plus singulière de l’instrument. Le chevalet du crouth était exactement plat, moins convexe que celui du violon à sa partie supérieure. Il résulte de cette circonstance, de ce que le corps de l’instrument n’avait. bas d’échancrures pour le passage de l’archet, que celui-ci devait toucher plusieurs cordes à la fois, et conséquemment produire une harmonie quelconque, en raison du doigté. Une autre particularité du chevalet du crouth lui donne beaucoup d’intérêt pour un observateur : elle, consiste dans l’inégalité de hauteur de ses pieds et dans sa position. Placé obliquement, en inclinant vers la droite, il a le pied gauche long d’environ sept centimètres. Ce pied entre dans l’intérieur de l’instrument par l’ouïe gauche, s’appuie sur le fond, et le pied droit, dont la hauteur est d’environ deux centimètres, est appuyé sur la table, prés de l’ouïe droite. Il résulte de cette disposition que le pied gauche remplit les fonctions de l’âme dans le violon, et qu’il ébranle à la fois la table, le fond et la masse d’air contenue dans l’instrument,
« Le chevalet n’est pas placé, dit le barde Ed. Jones, à angles droits avec les côtés du crouth, mais dans une direction oblique ; et, ce qui est à remarquer en outre, un des pieds du chevalet sert aussi d’âme. Il passe par une des ouïes, lesquelles sont circulaires, et s’appuie sur la table inférieure ; l’autre pied, plus court, est posé sur la table, près l’autre ouïe. »
Cet instrument, par sa forme et la manière de le tenir pour en jouer, a plus de rapport avec les violes de grande dimension qu’avec le violon. Le musicien plaçait ou appuyait le crouth sur les genoux ou entre les jambes ; telle est évidemment l’origine de la viole moderne, du pardessus de viole et de la viola di gamba.
La LYRA, comme instrument à archet, est-elle plus ancienne que le crouth ? C’est une question qui n’a pas encore été suffisamment approfondie pour pouvoir fixer une saine opinion à cet égard. On. sait, d’après les dessins qui en ont été donnés, que la lyra avait une forme conique a peu près semblable à celle de la mandoline ; elle était montée, dans son principe, d’une seule corde, que l’on faisait vibrer avec un archet : c’était encore un monocorde sous une autre forme ; mais, plus tard, elle en eut jusqu’à sept. Des ouïes semi-circulaires sont placées dans la table, et la corde est posée sur le chevalet ; une partie du manche paraît plus élevée que la table.
Cet instrument, du reste, ne rappelait aucunement la lyre antique. On rencontre, jusqu’à la fin du onzième siècle, sur les monuments et dans les manuscrits, des instruments qui se rapportent à ce type, mais qui ont souvent plusieurs corde. Plus tard, on confondit ensemble deux noms, lyra et viole, pour désigner tous les instruments à cordes.
On ne saurait dire combien ces dénominations génériques causent parfois d’embarras. «Embrassant beaucoup de choses à la fois, écrit M. Kastner, elles ne s’appliquent jamais bien à une seule, ou du moins, pour peu qu’on oublie d’en fixer la signification dans les cas particuliers par des détails précis, elles se confondent à des points de vue différents, en brouillant les idées attachées à leurs diverses acceptions. On a pourtant distingué lyra d’avec viola, soit qu’on ait entendu par lyra un instrument à cordes pincées, et par viola un instrument à archet, soit qu’on ait regardé l’un et l’autre de ces termes comme exprimant deux variétés de la famille de la viole ou du violon. C’est à ces deux points de vue qu’on a également fait la différence de rote d’avec vielle ou viole. Les auteurs latins, dès le onzième siècle, disaient et écrivaient aussi vistula, vidula ou vitula, et désignaient de la sorte l’instrument à archet que d’autres appelaient Lyra, Viella et viola, fiala et fiola étaient des formes équivalentes. On n’a pas besoin d’insister sur le rapport qui existe entre ces expressions et le flamand vioel, l’allemand fiedel et l’anglais fiddle, termes qui reviennent notre mot français viole ou violon, de même qu’à l’ancienne forme latine vidula ou vitula. Lyra, dans la langue allemande, a d’abord fait lîr, et a été distingué quelquefois de Gîge ou Geige. Lira mendicorum ou lyra rustica s’est dit de la vielle à roue des aveugles, parce que cet instrument, que les Français appelaient dans les commencements chifonie, était regardé comme une sorte de lyra commune ou de violon rustique. Lîren, et plus tard leieren, est le verbe qui exprimait l’action de jouer de la vielle en général : il répondait à notre vieux mot vieller. Dans la suite, il s’est plus particulièrement appliqué au jeu de la lyre commune ou lyre à roue, que les Allemands appellent encore maintenant drehleier. La lyre était très-usitée en Italie, et les Français en faisaient pareillement usage. Le manche et la touche de la lyre étaient beaucoup plus larges que ceux des violes ordinaires. D’après Mersenne, le son de cet instrument était languissant et propre à exciter la dévotion. Il y avait encore une autre lyre de la même espèce que la précédente, mais plus petite, et que l’on nommait lyra da braccio.
VIELLE OU VIOLE, employée comme acception commune, expressive des instruments, est la même chose que les mots viella et viola. Le nombre des différents modèles de vielle ou de viole qui ont paru du onzième au quinzième siècle est incalculable. Le nombre des cordes, dans les cas très-rares où elles peuvent être comptées, n’est presque jamais le même. De plus, ce nombre ne répond pas toujours aux instructions données par les anciens théoriciens. Le caprice et la légèreté des artistes peintres, sculpteurs ou imagiers, ne sont sans doute pas une des moindres causes de la diversité qu’on remarque dans les représentations de la viole. Toutefois, il faut reconnaître que cette diversité existait en effet. Ainsi, les miniatures, les verrières, les sculptures des treizième et, quatorzième siècles nous donnent des violes en forme de mandoline d’après le type de la lyra, d’autres tout à fait ovales avec un manche indépendant du corps de l’instrument, d’autres à boite carrée rappelant l’un des anciens aspects du crouth, d’autres faites en battoir, en cœur, en soufflet, en guitare, celles-ci avec une légère échancrure sur les côtés pour faciliter le passage de l’archet. Dans quelques-uns de ces modèles le dessous de l’instrument est bombé, dans d’autres il est plat. Le manche des violes en formé de guitare est souvent renversé vers le haut, comme un manche de luth.
A une certaine époque, le nom de viole remplaça définitivement celui de vielle. On croit que ce changement eut lieu au quinzième siècle, dans le temps où l’on commençait à désigner sous le nom de vielle l’instrument que l’on appelait auparavant chifonie. Cependant d’autres instruments à archet de la famille des vielles conservent une forme et une dénomination propre. La vielle, suivant le traité de Musique de Jérôme de Moravie, que possède la Bibliothèque impériale, avait cinq cordes. Parmi ces cordes, on comptait deux bourdons, lesquels, résonnant à vide, formaient une basse d’accompagnement à la mélodie que les autres cordes faisaient entendre. On remarquait quelque chose d’analogue dans l’ancien crouth.
Le même écrivain nous apprend que la RUBEBE n’avait que deux cordes accordées en quinte. D’après les monuments figurés, que l’on peut consulter sur cet objet, le nombre des cordes dans la vielle parait avoir varié de trois à six, et dans la rubèbe de deux à quatre. Ces instruments étaient généralement de forme ovale, selon le type qui était le plus répandu ; on en trouve de légèrement cintrés sur les côtés. Il y en avait sans ouïe, anomalie que présentent la plupart des sculptures. Des degrés sont placés de distance en distance sur le manche de, l’instrument. C’est cette particularité du manche à touches qui à fini par distinguer les violes des vielles.
RUBÈBE ou REBEC, rubebbe, rubelle, rebelle, reberbe, rebesbe, ribible, rebèbe, rabel, était un instrument d’une nature plus grave que la vielle, et n’ayant que deux cordes. Aymeric de Peyrac donne ; au contraire le nom de rebec à une espèce de vielle qui rendait des sons aigus imitant la voix de femme :
Quidam REBECAM arcuabant,
Quasi mulierem vocem confingentes.
D’autres auteurs disent que le rebec rendait des sons tellement criards et aigus que de là est venu, chez le peuple, l’usage d’appeler madame Rebecca une femme accariâtre.
La différence de ces témoignages ferait supposer que le rebec, et la rubèbe étaient deux variétés de la même espèce. Gerson dit aussi que le rebec était plus petit que la vielle.
La rebèbe ou rebec avait une forme variable : tantôt cet instrument est trapézoïde ; d’autres fois, il est oblong et rectangulaire, en manière de battoir échancré par les quatre angles. Le nombre des cordes n’était pas toujours de deux. L’instrument en eut plus souvent trois ; on faisait principalement usage de la rubèbe pour faire danser : telle était la principale destination des vielles en général ; seulement la rubèbe parait avoir plus particulièrement joué son rôle dans les fêtes bourgeoises, populaires et champêtres, et dans les mains des ménétriers de second ordre, au service du premier venu, On n’a pas oublié que le Crwth trithant, qui est l’origine, présumée du rebec, était exclusivement réservé aux bardes du second ordre ou ménestrels du pays de Galles. On retrouve ce crouth à trois cordes, dans sa simplicité originelle, en Bretagne ; il est joué par les barz de village, qui passent pour les descendants directs des anciens ménestrels ou bardes gallois et bretons. En d’autres pays de la Grande-Bretagne, on faisait aussi usage du rebec. Brantôme parle avec dédain de ceux qui venaient d’Ecosse. Milton témoigne de la faveur accordée au rebec comme instrument servant pour accompagner les danses ; il vante le son joyeux de cet instrument. En France, la vogue du rebec, durant, le moyen âge, égala celle de la vielle à roue, du monocorde à archet, de la flûte, du chalumeau, de la cornemuse, du tambourin et du tambour. On l’employait dans les noces, les bals, les festins ; dans les mascarades, les cortèges, les sérénades, et, en général, dans tous les divertissements du peuple et de la bourgeoisie.
En Espagne, les habitants des campagnes s’égaient au son du RABBEL on arrabel, violon commun que l’on croit être le même que le rebec, et qui se nomme en portugais rabeca. Les paysans russes de l’intérieur des terres emploient aussi un violon rustique fort ancien dans leurs contrées ; il est en forme de mandoline, il a trois cordes et se nomme GOUDOK. L’emploi vulgaire des vielles à deux et à trois cordes, qui a été général, a fait regarder celle que l’on nommait en France rubèbe ou rebec comme une sorte de mauvais violon. Cette opinion est venue de ce que le violon à trois cordes appelé rebec fut, à une époque, exclusivement attribué, comme nous l’avons vu dans le chapitre consacré à l’histoire des musiciens, aux apprentis ménétriers, aux musiciens de guinguette, de foire et de village, auxquels des ordonnances de police, rendues dans le dix-septième siècle, avaient interdit l’usage des basses, dessus et autres parties de violons dont les maîtres de la corporation avaient seuls le droit de se servir pour former des concerts et faire danser le public. Peu à peu le nom de rebec fut généralement appliqué à toute vielle ou viole propre à faire danser. Dès la fin du seizième siècle, le rebec se confondait avec l’instrument de la famille de violes qui faisait le dessus, et qui se nommait aussi violon, en allemand Discant Geige, et en italien rebecchino. La viole composait une famille entière et fort nombreuse dans la plupart de ses variétés. Elle comprenait entre autres la viola alta ou viola da braccio, nommée aussi violetta, la viola bastarda (bastar geige), la viola d’amore, la viola bardone ou baryton, la viola da gamba, en allemand kniegeige, en français basse de viole, la viola da spalla, etc. Le violone, la lyra et le lirone étaient, comme la viola da gamba, des instruments graves du système des violes. Le premier avait sept cordes, le second douze et quelquefois quinze. La viola bardone en avait un nombre considérable, les unes en boyau, les autres de métal.. Le dessus de viole, converti en violon, devint le chef de famille du violon moderne. Il continua donc dans les fêtes le rôle du rebec avec lequel on l’identifiait, bien qu’il eût quatre cordes et que le rebec, dans le modèle le plus usité., n’en eût que trois. Cependant, à l’époque de la transformation des dessus de viole en violons, il existait encore un instrument à archet d’une très-petite dimension, monté de trois cordes, lequel était, par sa forme, une espèce de vielle à archet différente du rebec. Cet instrument est celui qu’employaient les maîtres de danse. Comme il était d’un petit volume et très-portatif, en sorte qu’il pouvait facilement tenir dans la poche d’un habit, on lui avait donné le nom de poche ou POCHETTE.
Le VIOLON fut en usage en même temps que la viole, pendant les seizième, dix-septième et dix-huitième siècles ; mais ils formaient deux familles d’instruments différentes. Dès le quinzième siècle, on remarque sur le manche de la viole des touches fixant les divisions des cordes, comme dans le luth et la guitare ; ces touches étaient au nombre de sept ; il n’y en avait point à celui d u violon proprement dit ; la viole était généralement garnie de cinq à six cordes ; le violon n’en avait que quatre Enfin, ces deux instruments différaient essentiellement sous le rapport des proportions du corps sonore, et par conséquent de la qualité des sons, plus brillants et plus énergiques dans le violon, plus doux et plus étouffés dans la viole.
Longtemps il fut de mode de mettre des têtes sculptées à l’extrémité du manche d’un grand nombre d’instruments, mais principalement aux instruments à cordes dont le manche, au lieu d’être courbé en arrière comme celui des luths, était recourbé eu dedans. Ces figures, quelquefois ridicules et grotesques, représentaient souvent de jolies tètes de femmes, d’un travail extrêmement remarquable.
GIGUE, gighe, guige, gige, gygue, gingue. Il est bien peu de passages relatifs aux anciens instruments dans les écrits des vieux poëtes où la gigue ne soit pas mentionnés eu même temps que la vielle, la harpe et la rote.
Mais quel était cet instrument appelé gigue ? Un instrument à cordes ou un instrument à vent ? Les auteurs sont divisés d’opinion à cet égard. La gigue tirait son nom du mot allemand geige, expression générique sous laquelle on comprit d’abord les instruments à cordes de la famille des violes, et plus tard ceux de l’espèce des violons. Cet instrument conserva cette dénomination en divers pays, parce qu’il tirait son origine d’un modèle de vielle principalement en usage chez les Allemands. Tout ce qu’on peut dire de plus précis à cet égard, c’est qu’un grand nombre de monuments prouvent qu’il a existé en France et en Allemagne, un instrument à archet de petite dimension, monté de trois cordes et d’une forme qui le distinguait de la rubèbe ou rebec et des violes, surtout à partir de l’époque où celles-ci s’écartèrent de plus en plus du type de l’ancienne lyra. Cette forme avait beaucoup de rapport avec celle de la mandoline moderne. Le corps de l’instrument était bombé et sans échancrure sur les côtés. Il se prolongeait, en diminuant insensiblement, jusqu’à la partie supérieure où les cordes étaient fixées. Cette partie se détachait de l’extrémité du cône et se renversait tout droit en arrière, ou bien elle décrivait une courbe gracieuse eu revenant sur elle-même. D’après cette disposition, le manche n’était que le prolongement du corps principal, comme dans l’ancienne lyra et dans la plupart des vielles du onzième siècle. Ce fut là principalement ce qui introduisit une différence d’aspect entre la gigue et la vielle à une époque où celle-ci avait un manche dégagé et indépendant. Mais ce trait ne fut pas le seul qui différenciât les deux instruments, et il est à présumer que les proportions du corps sonore, l’accord et le diapason offraient des dissemblances qui, à un autre point de vue, empêchaient de les confondre. La table était légèrement échancrée en cœur à sa base ; elle était percée, près du chevalet, de plusieurs trous qui formaient un dessin à peu près semblable à la rose de la guitare. Le manche, dont le bout était renversé, se confondait avec le corps de l’intérieur. (KASTNER, Danse des morts.)
Dès la fin du onzième siècle, on aperçoit les vielles ou violes sur les monuments. Les plus anciennes représentations font voir ces instruments montés de quatre cordes.
Au treizième siècle, beaucoup de violes ont cinq cordes dans les, monuments qui les représentent ; telles sont celles aussi dont Jérôme de Moravie parle dans l’ouvrage cité précédemment. La forme de ces instruments est toujours celle de la guitare, et c’est cette même forme qu’on retrouve pendant tout le quatorzième siècle. L’absence du chevalet est la particularité la plus remarquable de ces figures.
Dans le grand nombre de violes ou vielles que l’on voit figurer sur les monuments ou dans les manuscrits, on remarque que les unes ont des chevalets et les autres en sont dépourvues. Dans les ouvrages d’Othmar Nachtgall et de Martin Agricola, les violes ont les cordes attachées à un cordier semblable à celui de la guitare, cette absence de chevalet doit provenir, dit M. Fétis de l’inadvertance des dessinateurs, car il eût été absolument impossible que l’archet ne touchât pas à la fois toutes les cordes d’un instrument fait ainsi ; d’autre part, les sons en peuvent être d’une faiblesse extrême, car c’est le chevalet qui fait faire aux cordes l’angle nécessaire pour qu’elles vibrent avec éclat ; c’est, enfin, le chevalet qui, vibrant lui-même avec énergie, communique à la table, par ses battements précipités, les oscillations vibratoires d’où résulte l’ensemble du son.
Deux faits nouveaux de grande importance se revêtent dans les figures publiées par Agricola, Nachtgall et Ganassi del Fontego, à savoir, les échancrures qui ont remplacés les. dépressions d’une courbe peu prononcée sur les côtés d’un instrument, et les cases que nous voyons sur les manches de violes, comme ou les voit encore aux guitares. Les figures représentent ces échancrures d’une manière inexacte, car elles ont une étendue trop grande, et les parties supérieure et inférieure des instruments se trouvent ainsi réduites à des proportions trop petites. Quelques violes et basses de viole du seizième siècle, qui existent encore dans les cabinets de curiosités, démontrent que les échancrures étaient moins étendues, quoiqu’elles fussent proportionnellement plus grandes que dans les violons, altos et violoncelles.
L’inhabileté des exécutants fit imaginer de placer des cases sur le manche des instruments, afin de leur indiquer les endroits où ils devaient poser les doigts pour former les intonations ; en sorte qu’au lieu d’être des instruments à sons variables pour la justesse absolue. les violes devinrent des instruments à sons fixes et tempérés. Cet usage a été conservé jusque dans la première moitié du dix-huitième siècle, bien que le violon se fût débarrassé de cette entrave depuis près de cent cinquante ans.
Il y eut évidemment une grande variété dans la construction des violes au moment où la musique véritable commença à se former et lorsque l’harmonie s’épura. Cette transformation s’opéra vers la fin du quatorzième siècle, par les efforts heureux de trois musiciens supérieurs à leur temps, qui furent Dufay, Binchois et Dunstaple. Alors, l’art tout entier fut considéré dans l’harmonie que formaient les voix d’espèces différentes par leur réunion. Ce qui avait lieu pour les voix on voulut le faire pour les instruments ; et, comme il y a des voix aiguës, appelées soprano, moins élevées, qu’on désigne sous le nom de contralto, moyennes, qui sont les ténors, et graves, appelées basses, on imagina de faire dans chaque genre d’instruments des familles complètes qui représentaient ces quatre espèces de voix.
La VIOLA DI SPALA, ou viole d’épaule, se suspendait à l’épaule droite au moyen d’un ruban, ce qui lui a fait donner ce nom. On croit que la viola di spala tenait le milieu entre la viole et le violoncelle actuel.
La VIOLA DI DORDONE, ou baryton, instrument de basse, avait un son agréable et se prêtait surtout à une expression douce et mélancolique ; il avait la forme d’une viola di gamba, et portait sept cordes à boyaux, que l’on touchait avec un archet. En dessous du chevalet se trouvaient seize ou vingt cordes d’acier fixées à des chevilles de cuivre jaune, que l’on accordait, comme la harpe, avec une clef. Le manche ne touchait pas immédiatement aux cordes, comme dans les autres instruments de la même famille ; il en était à une certaine distance qui permettait au pouce gauche d’appuyer en même temps sur les cordes d’acier. Au côté droit supérieur du couvercle se trouvaient encore quelques cordes métalliques de luth, que l’on pinçait avec le petit doigt de la main droite, qui conduisait en même temps l’archet. On donnait également à cet instrument le nom de viola di fagotto.
La VIOLA DI GAMBA se nommait ainsi parce qu’on la tenait entre les jambes, comme le violoncelle qui lui a succédé ; mais son timbre était moins perçant et se distinguait par une extrême aigreur. Son manche portait des sillets comme celui de la guitare. Cet instrument n’eut d’abord que cinq cordes, plus tard six, et, vers la fin du dix-septième siècle, Marois, musicien de la chambre du roi, en ajouta une septième.
On nommait VIOLA BASTARDA une espèce de viola di gamba, plus ancienne que la précédente, et qui était garnie de six cordes. Le corps de l’instrument était plus long et moins large que celui de la viola di gamba. On lui donna sans doute l’épithète de bastarda parce qu’on pouvait y exécuter les quatre espèces de voix, et que, par conséquent, elle n’appartenait à aucune voix en particulier.
La VIOLA POMPOSA fut inventée par le célèbre Sébastan Bach. Cet instrument était plus grand et plus haut que la viole ordinaire, et pourtant on le tenait dans la même position. Il avait cinq cordes, dont la cinquième, accordée en mi, était appelée la quinte.
La VIOLE D’AMOUR, instrument qui doit son nom au ton doux et, agréable que l’on en peut tirer, ne s’emploie que pour exécuter des solos, cantabile. La viole d’amour est plus longue et plus large que l’alto ; elle avait, sur un manche, sept cordes en boyaux, dont quatre ou cinq plus graves, étaient recouvertes d’un fil métallique, et, en dessous du chevalet et du manche, était placé un pareil nombre de cordes en acier et en cuivre jaune, afin de donner au son plus de force et d’intensité ; ces cordes inférieures étaient ordinairement accordées à l’unisson des cordes à boyaux, et quelquefois à l’octave. - Le dernier emploi de la viole d’amour a été fait par Meyerbeer dans les Huguenots ; l’instrument était joué par, M. Urhan, qui était le CASIMIR NEY de son époque.
Le VIOLET ANGLAIS est de la famille de la viole d’amour, mais il ne porte que six cordes au lieu de sept.
Le VIOLONE et l’ACCORDO, qui servaient dans les orchestres pour jouer la basse de l’harmonie, avaient le défaut de toutes les espèces de violes, celui de ne produire que des sons sourds et dépourvus d’énergie. On voulut plus de force, plus d’éclat dans les basses, et c’est pour arriver à ce but qu’on construisit, en Italie, des contrebasses au commencement du dix-huitième siècle.
Plus tard, les violes ou vielles subirent des changements et des améliorations qui donnèrent naissance sans doute à là famille du violon, qui se composa du violon, de l’alto, du violoncelle, de la contrebasse et même du pardessus de violon, nommé improprement pochette, parce que les maîtres à danser se servaient de cet instrument et le mettaient ordinairement dans leur poche.
Ce fut, assurent quelques écrivains, TESTATOR (il Vecchio), luthier milanais, qui eut le premier l’idée de diminuer le volume de la viola, à laquelle il donna le nom de violino. Cependant, je crois que cette idée de diminution de forme prit d’abord naissance en France, et que ce fut dans ce pays quelle y fut mise à exécution car nous voyons dans les plus anciennes partitions italiennes, même dans celles de Monteverde, des parties écrites pour des petits violons à la française, et même le plus ancien violon connu est l’ouvrage de Jean Kerlin, luthier breton, vivant en 1449. Les violes sont donc la souche du violon, dont la famille se borne à quatre instruments, le violon, l’alto, le violoncelle et la contrebasse.
Le VIOLON est, de tous les instruments, le plus beau, le plus harmonieux, le plus flexible, le plus riche en modulations. Le violon est monté sur quatre cordes de boyau, dont la plus grave sonne le sol. Les trois autres portent ré, la, mi, par quinte, du grave à l’aigu., La corde sol est filée en laiton. Le diapason du violon est de trois octaves, et une sixte. Il commence au troisième sol du piano. Ses quatre cordes suffisent pour donner plus de quatre octaves, plus de trente-deux notes du grave à l’aigu. Elles se prêtent à toutes les exigences du chant, à toutes les variétés de la modulation. Au moyen de l’archet, qui met les cordes en vibration et peut en faire parler plusieurs à la fois, il unit aux séductions de la mélodie le charme des accords et l’avantage si grand de prolonger le son, d’en doubler la puissance et l’énergie, la grâce et la suavité. Plus la forme du violon est régulière, plus les vibrations s’y font avec facilité ; plus le corps est susceptible de vibrer régulièrement et symétriquement, plus les sons qu’il produit sont beaux. Il est donc nécessaire que toutes les parties qui composent un violon soient parfaitement symétriques, et l’on cesse d’être étonné de la difficulté de rencontrer des violons et des basses dont l’intensité de son soit la même pour toutes les notes, quand on considère que la barre d’harmonie, placée sous le pied gauche du chevalet, est une cause plus que suffisante pour produire cet effet, puisqu’elle détruit la symétrie. elle doit être placée au milieu, dans la direction de l’axe de la table, en manière de couvre-joint. Le manque de symétrie dans le violon ordinaire, non-seulement celui qui provient de la position de la barre, mais encore celui qui naît de la difficulté de bien exécuter une forme si composée, en occasionnant de l’irrégularité dans les vibrations, est cause que le son est, mêlé. d’un peu de bruit ! ce qui le rend éclatant, dur et quelquefois criard. Souvent un violon, qui paraît très-fort de son quand on l’entend de près, ne parait pas en avoir quand on l’entend de plus loin ; ce qui dépend de la production simultanée du bruit, dont les vibrations irrégulières ne se communiquent pas si bien à l’air que celle du son, qui sont régulières.
Le violon se compose de trois parties -. 1° le Manche ; 2° le Corps ou la Caisse ; 3° les Accessoires.
1° Le MANCHE est une espèce de demi-cylindre en bois dur ; on emploie ordinairement pour le faire le platane ou l’érable.
Le manche se compose de l’accordière, de la tiége et de la touche.
L’Accordière est cette partie du manche qui est creusée dans toute sa longueur. Vulgairement cette partie du violon se nomme la tête. Les anciens luthiers, qui excellaient dans l’art de sculpter, savaient donner à la tête une forme bien gracieuse qu’on néglige de lui donner aujourd’hui.. E ciô uno dei segni distintivi di taluni artisti.
La Tiége est la partie du manche qui part du sillié pour se terminer là où commence la tête.
La Touche est une pièce, morceau de bois d’érable, qui recouvre non-seulement le manche, mais qui s’étend encore considérablement vers le chevalet.
2° Le CORPS ou la Caisse du violon comprend la table, le fond, et les éclisses.
La Table est la partie capitale de l’instrument, celle qui exige le plus de soin dans sa construction. Elle se fait ordinairement de sapin ou de cèdre ; tout autre bois résineux serait bon également ; mais comme les parties intégrantes en sont plus variables et que ces parties influent toujours sur le timbres, on s’en tient au sapin et au cèdre dont on connaît sur le timbre l’utile et constante influence. - Le plus ou moins d’épaisseur à donner à la table, dépend du bois qu’on y emploie : s’il est dense, la table doit être mince, et, s’il est poreux, elle doit avoir plus d ‘épaisseur. Les deux ouvertures de la table sous la forme de ss sont faites pour donner à l’instrument plus de, résonnance. C’est ainsi qu’en éloignant les s l’un de l’autre, le son devient plus sourd, et qu’il acquiert plus d’éclat quand on les rapproche et quand. on les fait plus, grands. C’est à cause de cette particularités que tous les violons de l’école des Amati ont un son doux, et que ceux de Stradivarius ont un son plein et éclatant. On donne le nom de filets aux incrustations en bois d’ébène, qui se font autour de la table de résonnance ; ces ornements n’ajoutent rien à la bonté de l’instrument ; mais par la manière dont ils sont placés, ils servent à faire reconnaître les écoles ; ainsi, par exemple, l’école de Brescia se distingue par deux filets qui courent parallèlement, tandis que celle de Crémone se distinguer par une courbe particulières à la jointure des filets.
Le Fond est également une partie du violon très importante, et qui ne demande pas moins de soin que la table elle-même. Il consiste presque toujours en deux planchettes d’érable collées l’une à l’autre. Le fond a plus d’influence sur les vibrations. de l’instrument que les éclisses ; aussi il faut bien faire attention à l’épaisseur du bois employé dans cette partie du violon. Il est évident que lorsque la table est faite de bois mince, le fond, demande une épaisseur plus forte que la table, sinon les vibrations rencontreraient un obstacle, et la voix du violon, en serait ébranlée. Les Eclisses sont les bandes qui unissent la table supérieure au fond de l’instrument. On emploie ordinairement pour les éclisses le bois de noyer ou d’érable.
3° Les ACCESSOIRES de l’instrument sont. : la barre, l’âme et le chevalet.
La Barre doit avoir, à son milieu, 5/16 de pouce de hauteur, et 2/16 à ses extrémités. - On choisit de préférence. le bois, de sapin pour la barre.
Il faut que la longueur de la partie de la barre qui s’étend vers le manche soit, égale aux trois, quarts de la distance qui existe entre le chevalet et l’origine du manche ; il faut également que l’autre partie de la. même barre ait en longueur les trois-quarts de la distance opposée ; or, comme cette dernière distance est plus courte que l’autre, l’on voit clairement que les deux parties de la barre doivent toujours être proportionnelles chacune au côté qui lui correspond.
L’âme est une petite pièce de bois dont l’extrémité inférieure s’appuie contre le fond de l’instrument, et l’extrémité supérieure contre la table : elle est entre ces deux parties du violon ce qu’est le chevalet entre la table et les cordes. On la fait de sapin ordinairement. La longueur de l’âme dépend de la hauteur de la voûte de l’instrument. En règle générale, on l’introduit à un demi-pouce derrière le pied droit du chevalet. Mais cette règle a des exceptions, vu les variations qui existent dans la. forme du violon lui-même. L’oreille seule peut guider pour mettre l’âme à sa meilleure place.
Le chevalet est fait de bois de platane ; c’est sur lui que reposent toutes les quatre cordes de l’instrument.
Ces trois parties accessoires ne constituent certainement pas la beauté du violon, mais elles lui donnent souvent une force, une vigueur qu’il n’aurait pas sans elles.
Le vernis a une très-grande influence sur les qualités de l’instrument ; celui employé par les anciens luthiers d’Italie nous frappe, encore aujourd’hui, par sa beauté, par son éclat dans les violons qui sont arrivés jusqu’à nous. Il parait que le vernis n’embellit pas seulement le violon, mais qu’il lui conserve une qualité de son permanente. Lorsqu’on néglige de le vernir, la table de l’instrument perd de sa force et de son moelleux. Ainsi, les guitares, dont les tables ne sont point vernies, perdent beaucoup en vieillissant ; il en est de même pour les pianos. On estime les violons dont le vernis est à l’huile ; comme il est plus liant que le vernis fait à l’esprit de vin, il convient mieux pour les violons dont les tables sont minces, parce que, en les pénétrant, il leur donne plus de consistance. Pour les violons dont les tables sont épaisses le meilleur vernis est celui de gomme laque dissoute jusqu’à saturation dans l’esprit de vin rectifié à 34 ou 36 degrés ; il sèche très-promptement et n’est pas sujet à s’écailler.
Quelle recette avaient les anciens luthiers pour fabriquer leur vernis ? C’est une question que l’on n’a pas, pu résoudre jusqu’à ce moment : il parait que le secret. de cette préparations été enseveli dans la tombe avec ses inventeurs. D’après les plus récentes suppositions, on, croit que. les anciens luthiers n’employaient pas le vernis à l’huile, contrairement à ce que l’on avait cru d’abord, mais le vernis éthérisé, car le vernis à l’huile, introduit au dix-huitième siècle dans la fabrication du violon, ne peut jamais acquérir l’éclat, la transparence que l’on admire dans les anciens instruments. Baillot affirme que le vernis ajoute toujours à la qualité du son, et que les vibrations suivies et continues, en expulsant un grand nombre de particules sous la forme de poussière, donnent au son. de l’extension et de la vigueur. Cette observation lui a été suggérée par, l’expérience de plusieurs années sur un violon qui, à force d’être joué, se couvrait toujours de plus en plus d’une poussière blanche, qu’il supposait être formée par les parcelles résineuses du bois et par les parcelles du vernis lui-même. À l’appui de cette expérience, on peut ajouter la remarque faite sur les tables des pianos, dont les vibrations harmoniques avec le son principal détruisent peu à peu la contexture du bois employé au point qu’il paraît poreux et comme pourri : lorsqu’on veut l’employer après, à. quelque autre usage. (LUTHOMONOGRAPHIE.)
Quelques artistes célèbres n’ont pas accordé le violon par quinte, ainsi qu’on le fait ordinairement. Pour en obtenir une sonorité plus éclatante, Paganini haussait toutes les cordes d’un demi-ton, et jouait en ré naturel, par exemple, quand l’orchestre était en mi bémol ; en la naturel, quand l’orchestre était en si bémol. Par ce facile artifice, il conservait la plupart de ses cordes à vide ; et l’on sait que la sonorité de ces cordes est bien plus éclatante que celle des cordes où les doigts sont appuyés. De Bériot hausse souvent le sol d’un ton, dans ses concertos. Baillot, au. contraire, baissait quelquefois le sol d’un demi-ton, quand il voulait obtenir des effets doux et graves. Wieter, a, même employé, dans le même but, le fa. naturel au lieu du sol.
Les sourdines sont de petites machines en bois que l’on place sur le chevalet des instruments à cordes pour affaiblir leur sonorité. Elles leur donnent un accent triste et doux qui est d’une application fréquente et souvent heureuse. dans tous les genres de musique.
L’ALTO OU ALTO-VIOLA, violon à quatre cordes, connu sous le nom de viole, est d’une dimension un peu plus grande que celle du violon, et tient, dans un orchestre, le milieu entre cet instrument et le violoncelle ou la basse. Comme le violon, il est composé de deux tables collées sur des éclisses qui forment le tour de l’instrument, et d’un manche dont le sommet est traversé par des chevilles qui servent à tendre les cordes retenues à l’autre bout par une seconde pièce de bois noirci que l’on appelle la queue. Le manche est également couvert par une seconde pièce de bois noirci qu’on nomme la touche, et sur laquelle posent les cordes, légèrement inclinées par le chevalet placé entre lui et la queue. L’alto se joue, comme le violon, avec un archet qui lui fait rendre un son plus grave, mais doux et mélancolique. L’alto nous vient des Italiens, qui excellaient dans la fabrication de cet instrument. Le nom du célèbre Amati donne, de nos jours, un prix très-élevé à ses productions, devenues très-rares. Le timbre de l’alto possède des qualités expressives si saillantes, que dans les occasions où les anciens compositeurs l’ont mis en évidence, il n’a jamais manqué de répondre à leur attente.
Le VIOLON PICCOLO, accordé en do, au-dessous des lignes sol, ré, la, n’est plus en usage.
On nomme QUINTON une espèce de violon d’une forme plus ramassée et plus haute que celle du violon ordinaire, mais cet instrument a été délaissé, et on ne le rencontre plus que dans les cabinets d’amateurs ou chez quelques anciens luthiers.
Le VIOLONCELLE doit son origine à certains changements faits à la basse de viole. il fut inventé, disent les uns, par le P. Tardieu, de Tarascon, au commencement du dernier siècle ; mais d’autres auteurs affirme que, créé par Bonoccini, maître de chapelle du roi de Portugal, il a été apporté en France et mis en vogue par Struck Ratestin. Il avait alors cinq cordes do, sol, ré, la, ré. Aujourd’hui, il n’en a plus que quatre, dont les deux dernières sont revêtues de fil de métal. Elles sont accordées en do, clef de basse au-dessous de la portée : sol, ré, la.
Le premier qui introduisit le violoncelle dans l’orchestre de l’Opéra. fut un nommé Battistini, de Florence, peu de temps avant la mort de Lally-Francisullo, violoncelliste romain, qui se rendit célèbre dans l’exécution des solos ; il vivait vers 1725. Avant cette époque on ne se servait que de la basse de viole montée de sept cordes.
La CONTREBASSE fut longtemps l’instrument le plus grand de la famille des violons. Ses sons résonnent à l’octave basse de ceux du violoncelle. La contrebasse est le fondement des orchestres. Aucun instrument ne saurait le suppléer. La richesse de ses sons, son attaque pleine de franchise et de pompe, et surtout l’ordre admirable qu’elle porte dans les masses harmoniques, signalent partout sa présence.
Il y a deux espèces de contrebasse : l’une à trois cordes et l’autre à quatre. Leur étendue est de deux octaves et une quarte, du mi grave de la voix de basse au la aigu du ténor, en comptant toutefois, pour les contrebasses à trois cordes, deux notes de moins au grave. Mais il faut observer que le son de l’une et de l’autre est plus grave d’une octave que la note écrite.
Nous avons déjà dit que cet instrument fit son apparition à l’orchestre de l’Opéra, en 1700. Jusqu’en 1757, il n’y eut qu’un seul de ces instruments, dont on ne se servait que le vendredi, qui était réputé le beau jour. Gossec en fit ajouter un second et Philidore un troisième.
La contrebasse à quatre cordes est préférable à l’autre. Comme elle est accordée en quartes, on peut exécuter une gamme entière sans démancher. Cet instrument est d’un grand effet dans les mains de GOUFFÉ, qui s’est acquis une si belle réputation par le talent de son exécution, et le mérite de ses compositions.
Un mathématicien anglais, du nom d’Emerson, essaya, vers l’année 1760, de faire subir au violon quelques changements de forme, d’après ses idées sur l’accoustique, mais ses essais n’eurent pas de suite. En 1786, Ficher, luthier à Wurtbourg, fit annoncer l’emploi, dans la confection des violons, d’une invention nouvelle, au moyen de laquelle ses instruments égalaient ceux de Stradivarius et de Steiner. Cette invention consistait à ôter au bois sa verdeur au moyen de la dessiccation au four. Ce moyen fut employé par quelques fabricants ; mais ils y renoncèrent lorsqu’ils s’aperçurent que le dessèchement trop rapide et mal gradués énervait le bois et ôtait au son 1’éclat des vibrations. En 1727, un nommé Gérard Hoffmann imagina une mécanique pour monter et descendre, d’un seul coup, les instruments à archets au ton du chœur ou à celui des concerts, qui alors était différent. Ce même luthier construisit en 1734, un calibre pour mesurer le diamètre des cordes.
Les anciennes violes ne cédèrent pas le pas à la famille des violons sans trouver des défenseurs. Aussi vit-on un nommé Hubert Leblanc, docteur en droit à Paris, publier, en 1740, une brochure intitulée : Défense de la basse de viole contre les entreprises du violon et les prétentions du violoncelle. Le violon y est traité d’orgueilleux, d’arrogant, visant à l’empire universel de la musique ; quant au violoncelle, c’est, dit cet écrivain, un pauvre hère se cachant, tout honteux, derrière le clavecin, et ; dont la condition est de mourir de faim.
CHAPITRE IX
TROISIÈME DIVISION
INSTRUMENTS A PERCUSSION.
Nous écrivions, en commençant cet ouvrage, que la percussion a dû être le premier moyen employé par l’homme pour produire soit un son, soit un bruit : le premier cri, disions-nous, fut son premier chant le battement de ses mains son premier instrument.
On entend par instruments à percussion, en général tous les instruments aptes seulement à rendre un seul son, à quelques exceptions près, et chez lesquels on n’emploie d’autre moyen que celui du battement ou du frottement.
Nous diviserons les instruments à percussion en deux FAMILLES ; dans la. première nous comprendrons tous les instruments bruyants et dans la seconde les instruments sonores.
PREMIÈRE FAMILLE.
INSTRUMENTS A PERCUSSION BRUYANTS.
Au premier rang des instruments à percussion bruyants, il nous faut placer le TAMBOUR.
Tout écrivain, archéologue ou musicologue, a son dada, sur lequel il est toujours grimpé ; c’est-à-dire qu’il. se forme dans son esprit un système, une règle avec laquelle il mesure toute chose. Ce système devient un véritable lit de Procuste ; il faut que toute idée s’agrandisse ou s’amoindrisse pour s’y rattacher. Ainsi le dada de M. Fétis est de vouloir que tout vienne de l’Orient et d’attribuer ce tout à l’Inde. Moi aussi j’ai mon DADA ! J’admets que l’Occident est redevable de beaucoup de choses à l’Orient ; mais, par les études longues et sérieuses que j’ai faites des sculptures des monuments égyptiens, je me suis convaincu que, en fait de facture instrumentale, tous nos types primitifs viennent des Egyptiens. M. Fétis n’apporte à l’appui de son dire que des présomptions basées sur l’existence d’instruments modernes dont l’origine est incertaine, et moi, au contraire, je présente des sculptures de monuments dont rien ne saurait contester ni l’authenticité ni l’ancienneté.
Le tambour, chez les Egyptiens, était au nombre des instruments spécialement destinés à relever les mouvements de la danse, de la pantomime et à marquer le rhythme soit dans les temples soit à la guerre, ou à conjurer Typhon et à l’éloigner du lieu des prières. Il était presque toujours porté par celui qui le frappait ; mais comme celui-ci se trouvait également parmi les acteurs de la danse et de la pantomime, le tambour dut donc être d’une grandeur moyenne et facile à porter : aussi, sur tous les bas-reliefs, on n’en trouve que de petite dimension. Le tambour, chez les Egyptiens, n’était pas seulement un instrument du sacerdoce, il servait encore dans les exercices militaires. On trouve à Thèbes plusieurs sculptures qui donnent la forme du tambour, tympanum, que nous verrons traverser la nuit des temps et arriver jusqu’à nous sans presque aucun changement dans son ensemble.
LE TAMBOUR égyptien avait environ deux pieds et demi de long ; il était frappé avec les mains, comme le tympanum romain.-Tympana tenta sonnant palmis, dit Lucrèce. Horace le nomme sœva tympana. Son coffre était de bois ou de cuivre, couvert aux extrémités par une feuille de parchemin, tendue avec une corde traversée diagonalement sur l’extérieur du cylindre. Il se portait sur le devant de l’exécutant, dans une position horizontale ; en marche, le tambour se mettait verticalement sur les épaules ; il s’y trouvait sans doute assujetti par des bretelles. Cet instrument, ainsi que nous le décrivons, était, selon saint Clément d’Alexandrie, employé par l’armée. Quand la troupe marchait au son du tambour, celui qui le portait était souvent placé au centre ou sur un point élevé ; il se trouvait quelquefois près du porte-étendard. Les tambours n’étaient pas toujours isolés ou relégués au centre de la troupe ; ils marchaient avec les autres musiciens, et étaient placés sur un côté quand la troupe, défilait, et cet usage s’est conservé jusqu’à nous. Les scènes de batailles, représentées à Médéenet-Haboo et à Thèbes, nous montrent les tambours occupant les diverses positions que nous venons d’indiquer.
Outre ce tambour allongé, les Egyptiens en possédaient un qui n’était différent du nôtre ni en grandeur ni en forme ; il était frappé avec deux morceaux de bois. Cependant on ne trouve aucune représentation indiquant de quelle manière on à en servait, et nous ne pouvons pas dire s’il se portait horizontalement, comme nos grosses caisses, ou s’il était suspendu verticalement et s’il était battu d’un seul côté, comme les tambours modernes. Quelquefois les baguettes étaient droite, et divisées en deux parties : la poignée, et le corps de la baguette étaient rondes et minces ; elle portait à son extrémité une bosse si arrondie, qu’en frappant elle ne touchait que la plus petite partie possible de la surface ; les baguettes avaient environ un pied de long, et, si on juge des autres par la poignée de celle qui est conservée au musée de Berlin, on doit supposer qu’elles servaient à frapper des deux côtés. On ignore si les tambours égyptiens possédaient le timbre, c’est-à-dire la corde qui traverse extérieurement le fond inférieur. Chaque extrémité de cet instrument était couverte d’une peau rouge, tendue avec des cordes entrelacées, passant à travers de petits trous pratiqués sur l’extrême bord, et s’étendant en ligne droite sur son coffre en cuivre ; pour unir les cordes et tendre le tambour de manière à ce qu’il ne rendit qu’un son simple, une corde à boyau prenait à chaque extrémité et passait autour de chaque corde, la serrant à angle droit, jusqu’à la condition voulue. Ce tambour ne se trouve représenté sur aucune sculpture, mais son existence est certaine, car il en fut découvert un semblable, en 1823, dans une fouille faite par Jean d’Athanase dans les ruines de Thèbes.
Le tambour était connu des Hébreux, des Grecs, des Romains et des Barbares. Les tambours avaient des formes diverses, tantôt petites, tantôt grandes. Chez les Latins ils reçurent le nom générique de tympanum, emprunté au grec tvmpanon ou topanon.
François Blanchini fait observer que Sponius, aussi bien que Pignorius, établit une distinction entre le petit et le grand tambour des anciens, en se fondant sur des passages de Catulle, d’Ovide, de Suétone, de saint Augustin et de saint Isidore, lesquels montrent, à l’évidence, qu’indépendamment de lourdes timbales d’airain et de grands cylindres en bois, il existait une autre sorte de timbales, c’est-à-dire un petit tambour de forme orbiculaire couvert d’une peau. ou d’un cuir tendu, et frappé soit avec une petite baguette, soit avec la main. De là, par rapport à la dimension, deux types principaux d’instruments de percussion à peau tendue, savoir : le tympanum grave et le tympanum aigu, qui ont fourni des variétés dont l’usage s’est perpétué jusqu’à nous. On les désignait au moyen âge, tantôt par le mot latin tympanum, par les expressions suivantes, dont quelques-unes avaient une signification particulière ; symphonia, tympaniolum. (tympanellum), margaretum, tymbris, tambula, tambura, tamburlum, tabornum, taborinum, tabur (thabur), tarburcinum, nacaria (anacaria), atabala (timbanala), et en vieux français : tympan, tymbre, tabor, taborin, bedon, nacaire (naquaire). Les Allemands se servaient aussi du latin tympanum ; ils ont dit ensuite trommel et pauke. Les Anglais ont adopté tabor et drum ; les Espagnols ont tambor, atabal, pandero, les Italiens, tympano, tamburro et tamburrino. Aujourd’hui, nous remplaçons le tympanum des Latins par les mots tambour et timbales.
De tous les instruments de percussion à peau tendue, le tympanum aigu, ou petit tambour, était le plus usité chez les Egyptiens, chez les Hébreux et chez les Grecs. Dans l’ancienne Egypte, le TAMBOUR A MAIN était introduit dans les fêtes sacrées et dans celles de famille. Il y en avait de trois sortes, dont le son, sans doute, différait autant que la forme. L’un était rond, l’autre formait un carré ou un parallélogramme allongé, et le troisième se composait de deux châssis carrés séparés par une barre, et sans doute chaque partie était accordée différemment, comme nos tymbales modernes. Tous se frappaient avec la main et servaient à accompagner la harpe et les autres instruments.
Il est fait mention, très-anciennement dans l’histoire, du tambour à main, que l’on a nommé taboor, tabor, taborin, taborel, taboer, taburin, tabourin, tabourinet, tymbre. On l’employait pour les cérémonies religieuses, pour les fêtes publiques et pour les danses sacrées et profanes. Il y en avait de différentes formes. Dans les uns, le corps de bois, qui servait à, tendre la peau, était rond ; dans les autres, il était carré. Le tympanum le plus ordinaire avait la forme d’un crible (tympanum cribri). Pour jouer de cet instrument, on le tenait en l’air d’une main, et de l’autre main on frappait sur la peau, ou bien ou, frôlait celle-ci légèrement avec un ou plusieurs doigts. Quand le tympanum aigu était garni de sonnettes au de lames métalliques (tintinnabula), il suffisait de l’agiter un peu pour produire quelque bruit. On faisait encore résonner ces petits instruments en frappant dessus avec une baguette. Comme ils étaient très-légers, les femmes les avaient donc adoptés, et c’est surtout dans leurs mains qu’ils figurent sur les monuments. Chez les Hébreux, nous voyons de jeunes filles célébrer avec cet instrument les triomphes d’Israël. Chez les Grecs et chez les Romains, les danseuses qui participaient aux fêtes reli-ieuses, comme celles qui venaient égayer le repas, avaient presque toujours ce tambour à la main ou les crotales. Au sixième siècle, saint Isidore mentionne deux tambours de petite dimension, que l’on peut regarder comme les successeurs naturels de ce tambour antique. L’un se nomme simplement tympanum, l’autre tympaniolum, connu aussi sous le nom de margaretum. Il n’avait en grandeur que la moitié du tympanum. On le frappait avec un petit bâton. (KASTNER, Danse des morts.)
Les tambours de l’espèce du tympanum grave dont on faisait usage au moyen âge étaient, comme ceux des anciens, calqués sur, deux modèles ou types différents, l’un demi-sphérique, l’autre cylindrique ; l’un de cuivre, l’autre de bois. Le modèle de tambour de cuivre prit spécialement le nom de nacaire. L’autre modèle s’appropria la dénomination générique de tympanum, en vieux français tympan, tabour et même tabourin, car ce diminutif fut aussi donné quelquefois, sans raison, à des instruments de percussion beaucoup plus grands que le tambour à main, de même que, par tabour et tabor, on désignait quelquefois ce dernier. Dans les douzième et treizième siècles, on disait tympan et tabour. Tympaner signifiait jouer du tympan ou tabour. On fait dériver le mot tabor de l’arabe, et l’on croit que le grand tambour de bois, dont les Européens font principalement usage à la guerre, date du temps des croisades. Cependant, il en est fort peu question dans les chroniques avant le quatorzième siècle, et l’on ne voit pas que les Français s’en soient servis plus anciennement. pour transmettre des ordres et des signaux. La première mention qui soit faite du tambour dans la Chronique de Frossart se réfère à l’entrée d’Edouard III dans Calais, en 1347.
Les sculptures égyptiennes nous offrent aussi la représentation d’un autre petit tambour encore en usage aujourd’hui chez le peuple de la moderne Egypte. On le nomme DARABOOKA. Il Se rencontre rarement dans les peintures de Thèbes ; mais on doit supposer qu’on s’en servait dans certaines occasions, et qu’il était en usage, comme aujourd’hui, parmi les femmes de la campagne ou les bateliers du Nil. D’après une sculpture de Thèbes, on voit que cet instrument n’a pas changé de forme et qu’il est le même que celui dont on se sert encore.
Cet instrument se compose de feuilles de parchemin fixées sur un pot de terre ressemblant beaucoup à la pomme d’un arrosoir. Si le parchemin se relâchait par excès d’humidité, on le retendait en approchant un moment la peau du feu ou en l’exposant au soleil quelques instants. Il se portait en sautoir au moyen d’un cordon qui entourait le col de l’exécutant, qui en jouait en le frappant avec les doigts.
TAMBOUR, CAISSE, BEDON, tabor, tabur, tabour, atabor, altambor, tambor, quesse, était un instrument de bois de figure cylindrique, couvert, aux deux extrémités d’un cuir ou d’une peau, et en forme circulaire ou hémisphère, également couvert d’une peau, mais seulement dans la partie supérieure ; il s’employait principalement pour la guerre chez les nations barbares. D’après Suidas, les Indiens donnaient cette forme à presque tous leurs tambours ou timbales de guerre ; ils se servaient d’un tronc de palmier pour faire le cylindre. F. Blanchini, d’après Pignorius, donne deux figures de tympana bellica. La première ressemble à l’instrument de percussion que nous appelons particulièrement timbales ; la seconde représente, au contraire celui que nous distinguons des timbales sous le nom de Tambour ou caisse, et qui consistait, dit Blanchini, en un cylindre de bois creux, recouvert à chaque extrémité d’une peau tendue, de telle sorte qu’on pouvait, la frapper des deux bouts avec une baguette. Le tambour formé d’une caisse de bois recouverte d’une peau aux deux extrémités, c’est à dire en dessus et en dessous, se retrouve, à l’époque de la décadence de l’empire romain, désigné par saint Isidore sous le nom de symphonia. On jouait de cet instrument à peu près comme on joue à présent de la. grosse caisse, car on le frappait de chaque côté avec une baguette, tandis que le tambour moderne n’est frappé que d’un seul côté.
LE TAMBOUR SUISSE différait du tambour français par sa grosseur seulement, et on le nommait également colin-tampon en raison du rhythme de sa batterie, et comme nous avions alors battu les Suisses, on dit d’eux pour les railler : Je m’en fiche comme de colin-tampon.
La forme du tambour n’a pas sensiblement, varié depuis le seizième siècle. Comme nous l’apprend, Estienne Pasquier, ce furent les soldats eux mêmes qui vers le seizième, siècle, nommant la partie pour le tout, imaginèrent d’appeler caisse l’instrument. Dans la langue, pittoresque des gamins de Paris l’instrumentiste se nomme actuellement tapin, du verbe taper. Ce nom de caisse a produit les dénominations de caisse claire, caisse roulante et. grosse caisse, lesquelles répondent aux trois variétés de tambours dont on se sept aujourd’hui dans la musique militaire et dans les orchestres.
La CAISSE CLAIRE n’est autre chose que l’ancien tambour, dont le corps principal se fait à présent de laiton, de sorte, qu’il rend un son clair et brillant. Rien, du veste, n’est changé dans le principe de sa construction. Il a une moyenne. circonférence, et il est couvert d’une peau à chaque bout. Le fût ou corps principal de l’instrument, est une feuille, de laiton tournée en forme de cylindre ; on fait tenir les peaux sur le fût par deux grands cercles de bois percés de trous, dans lesquels passent des cordages qu’on serre ou qu’on lâche à volonté, suivant le degré de tension auquel il convient, de maintenir les peaux. On bande, ces cordages ou moyen de morceaux de buffle qu’on nomme tirants. Pour rendre le son de l’instrument plus harmonieux, on fait à l’un des grands cercles du tambour deux petits trous percés vis-à-vis l’un. de l’autre, dans lesquels, on passe, une corde à boyau que l’on appelle timbre. Elle tient, par en bas, à un bouton attaché au corps de la caisse, et, en dessus à une espèce de piton à vis passé dans un écrou que l’on, tourne pour bander où lâcher le timbre. Quand on veut, enlever au tambour son éclat, et en rendre le son mystérieux et lugubre, on le couvre d’un voile : cela se pratique dans la musique funèbre. Bien que le voile soit en quelque sorte la sourdine du tambour, on ne dit point : tambour avec sourdine, on dit : tambour voilé.
La CAISSE ROULANTE Se compose d’un fût cylindrique de bois plus allongé, moins large que celui de la caisse claire ; le son en est doux, et elle se prête surtout à l’exécution des roulements, ce qui lui a valu le nom qu’elle porte.
La GROSSE CAISSE ou gros tambour a une très-grande circonférence ; mais le corps cylindrique aux extrémités duquel sont tendues les peaux, est très bas, et cette forme aplatie, de même que la manière dont on tient l’instrument, qui se place horizontalement et se bat de côté, rappellerait le Tambour à main, si le volume monstre de la grosse caisse n’écartait à l’instant l’idée d’une comparaison semblables. La grosse caisse est principalement en usage dans la musique militaire ; mais Rossini et les musiciens de son école l’ont introduite dans les morceaux d’opéra à grands effets d’orchestre.
Le TAMBOURIN était de deux espèces, le provençal et le basque. Il avait une caisse plus longue, plus droite que celle du tambour ordinaires Le timbre était tendu sur la peau à l’une des extrémités. Une courroie attachée aux deux bouts du tambourin servait à le suspendre en biais.
Le TAMBOURIN BASQUE se composait d’un instrument nommé bedon ou tambour. Il avait la caisse longue de 66 centimètres et large de 16 centimètres environ ; une ouïe ou rosette se trouvait pratiquée à chaque bout ; cette caisse était surmontée de six cordes accordées en quinte et fixées à des chevilles aux extrémités du corps sonore. Le musicien suspendait le bedon à son col et le portait en bandoulière le long du côté gauche, puis maintenait la caisse avec le bras gauche, et avec la main droite il frappait sur les cordes avec un bâton recouvert de velours.
Le TAMBOUR DE BASQUE (tambour de Biscaye), ou vulgairement tambourin, servait encore, il y a quelques années, dans, la musique militaire, et il n’a pas cessé d’être employé dans la musique de ballet.
C’est une peau tendue sur un petit cerceau dans l’épaisseur duquel où pratique des ouvertures pour y insérer des grelots ou des lames de cuivre que l’on fait sonner en remuant l’instrument de différentes façons et en le frappant, soit à pleine, main, soit du bout des doigts, et quelquefois des poings, des coudes, et des genoux, lorsqu’on joue en dansant. Au théâtre, on s’en sert peur empreindre, de la couleur qui leur est propre, les danses de bohémiens de Basques, etc.
On nomme TIMBALES des tambours. de métal de forme demi-sphérique, dont le type remonte à la plus haute antiquité et avait été très répandu en Orient. Pline définit les timbales : un corps creux, arrondi d’un côté, d’où on donna, dit-il, le nom de tympania aux perles qui avaient la même forme, c’est-à-dire qui étaient plates d’un côté et arrondies de l’autre. Salomée. voulant imiter le tonnerre de Jupiter, entraînait après son chariot des timbales ou chaudrons couverts d’une peau tendue par dessus l’ouverture : Pelles detractas in curru cumœneis tebetibus agitans dicebat se tonare. Ces exemples prouvent, d’une manière concluante, l’existence simultanée du tympanum aigu et, du tympanum grave ; mais tandis que la première de ces timbales prenait la place primitivement occupée par la seconde dans les réjouissances et les cérémonies religieuses, cette dernière devenait un instrument guerrier. Plutarque dépeint les timbales des Perses dans la vie de Crassus, et Arien dit que « ces peuples ne se servent ni de cors, ni de trompettes pour donner le signal du combat, mais de certains gros bassins creux couverts d’un cuir qui est attaché et tendu par des clous d’airain ; on frappe ces bassins de tous côtés, et ils rendent un son creux et terrible, semblable à celui du tonnerre. »
Rien ne donne lieu de croire que les timbales rendissent un son musical déterminée, comme aussi rien n’autorise à penser le contraire. L’Orient qui a servi de berceau aux timbales, devait voir leur usage se perpétuer, mais bien entendu avec des changements de forme et d’application.
En Perse, on. avait coutume de jouer des timbales pendant le repas du roi.
Les seigneurs Migréniens se servaient d’une petite timbale pour chasser l’aigle et le faucon ; en entrant dans la forêt, ils frappaient violemment leurs timbales afin de faire envoler les aigles, et de pouvoir les tirer.
Brofferio, en parlant des mœurs musicales de la Syrie, s’exprime en ces termes- : « On emploie parfois jusqu’à huit timbales d’inégale grandeur, et rendant. chacune un ton différent ; on les dispose à terre en forme de cercle, la plus grosse au milieu, et les musiciens, accroupis sur leurs jambes, devant leurs instruments, les frappent avec le poing ; ils jouent sans musique, donnant leur note quand elle arrive, suivant la combinaison mélodique ou harmonique. Cette sorte de musique sert particulièrement aux bals, fêtes et autres divertissements donnés par le souverain. »
Les timbales sont encore usitées aujourd’hui dans tout l’Orient. La timbale était souvent portée sur les épaules d’un serviteur, et le musicien en jouait en marchent par derrière ; cet instrument est de rigueur dans le mariages mahométans : on s’en sert pour conduire l’épouse dans la maison de l’époux. Enfin, Bonnani nous fournit encore un modèle de deux petites timbales perses : le bassin est en métal, la peau est une peau de bœuf ; on les attache à la ceinture et on les joue des deux mains.
Selon toute probabilité, les timbales furent introduites en Europe par les Sarrasins, lors de l’invasion d’Espagne. Leurs timbales, à ce que l’on croit, étaient beaucoup plus grosses que celles des anciens ; on les suppose à peu près de la même forme que les nôtres.
M. Kastner dit, dans sa Méthode complète et raisonnée des Timbales, que le premier emploi des timbales, après qu’ elles eurent été introduites en Europe, dut être celui d’un instrument guerrier.
En 1457, Ladislas, roi de Pologne, envoya une ambassade en France, et la chronique de Lorraine dit que les ambassadeurs s’arrêtèrent à Nanci et qu’on n’avait « ni, mi oncques vu des tambourins, comme des gros chaudrons, qu’ils faisaient porter sur des chevaux. »
On fit également servir les timbales comme instrument d’honneur, et elles continuèrent depuis à cumuler ces deux diverses fonctions. Dans Prætorius, qui vivait à la fin du seizième siècle et au commencements du dix-septième, il est fait mention des timbales, sous ce double aspect, comme d’une coutume déjà ancienne : « Les timbales, dit cet auteur, s’emploient à la guerre ; on s’en sert aussi à la, cour, dans les bals, dans les repas, et pour signaler l’entrée, la sortie ou le passage des princes. » Prætorius l’appelle tympanum Hieronymi.
Le tambour, comme on sait, fut définitivement adopté pour l’infanterie et les timbales devinrent l’instrument caractéristique des troupes à cheval ; on leur adjoignit une certaine quantité de trompettes pour former une musique guerrière. On attachait un grand point d’honneur aux timbales ; dans l’origine, il n’était permis à aucun régiment français d’en avoir, sauf ceux qui les avaient prises à l’ennemi ; dans la suite, on les introduisit dans presque tous les corps de cavalerie, et l’usage en devint général par toute l’Europe. Dans les marches, dans les parades et dans les revues, le timbalier se tenait ordinairement en tête de son escadron, mais, pendant le combat, il se portait à l’aile de l’armée.
Lorsqu’un régiment se distinguait, on lui donnait parfois des timbales d’argent. Le timbalier devait être d’un courage éprouvé et défendre son instrument au péril de sa vie, comme le cornette et l’enseigne leur drapeau. En campagne, on se servait de timbales au lieu de cloches, pour le service divin. Les timbales se plaçaient en avant de la selle du cheval que montait le timbalier ; elles étaient généralement garnies d’un tapis de la plus grande richesse avec des franges d'or, appelé tablier des timbales. Quelques régiments prenaient un nègre pour timbalier, l’habillaient à la turque et lui faisaient monter un cheval blanc ; cet usage ne confirme-t-il pas l'opinion que les timbales furent originairement introduites en Europe par les Sarrasins. On se servait parfois du timbalier comme parlementaire.
Les timbales et le timbalier n'étaient pas en moins grand honneur à la cour qu'à l'armée, ainsi que nous l'avons déjà dit; ici on adjoignait également aux timbales une certaine quantité de trompettes qui jouaient ensemble ou alternativement : ces sortes de fanfares se nommaient ordinairement entrées : elles avaient lieu, comme nous l'avons déjà observé, pour célébrer l'arrivée de quelque grand personnage. Aux bals, aux festins, aux noces, bref à toutes les cérémonies, il n'était point de belle fête sans timbales; mais tout le monde n'y avait pas droit et il n'était permis de les faire intervenir que pour des princes, des nobles, ou tout au plus, dans la bourgeoisie, pour des docteurs et des individus revêtus de quelque charge publique.
On comprend que, par toutes ces causes, l'art du timbalier avait acquis une grande importance et était devenu d’une difficulté extrême,; on n'exigeait pas moins de six années pour faire un bon artiste; les timbaliers allemands étaient, en général, les plus renommés.
Aujourd'hui, à la guerre, comme dans les cours, l'usage des timbales est presque totalement tombé en désuétude ; mais en revanche, les timbales sont triomphalement entrées dans l’orchestre et y occupent. une place distinguée. Il serait fort intéressant de savoir quel est le compositeur qui, le premier, introduisit les timbales dans l'orchestre ; mais, malgré toutes nos recherches, il nous a été impossible d'éclaircir ce point. (KASTNER, Méthode complète et raisonnée des timbales.)
DEUXIÈME FAMILLE.
INSTRUMENTS À PERCUSSION SONORES.
Au premier rang des, instruments à percussion sonores nous placerons l'HARMONICA, instrument, qui rend des sons harmoniques. Il y en a de deux espèces. La première sorte d'harmonica se compose d’une planche longue de un mètre et large de cinquante centimètres, sur laquelle, on range et on assure des gobelets de verre de différentes grandeurs, que l'on accorde en y versant plus ou moins d'eau. On mouille les bords supérieurs des gobelets avec une éponges et, après avoir un peu humecté le plat des doigts, on frotte légèrement ce bord supérieur en tournant rapidement le doigt tout autour. L'étendue de cet harmonica peut avoir trois octaves. La seconde sorte d'harmonica fut imaginée par Francklin, en 1760, et cet instrument était composé d'un cylindre, sur lequel on assujettissait les vases de verre, faits en forme de timbres de carillon, et qui y étaient fixés l'un à la suite de l'autre. Le cylindre était placé horizontalement sur deux pieds, et tournait au moyen d'une roue mue par une corde attachée au pied qui jouait l'instrument. Pour obtenir les sons, on mouillait les verres pendant quelque temps. avec une éponge en faisant tourner le cylindre ; on mouillait ensuite les mains et on ne faisait qu'appuyer les doigts sur les verres. On chercha, longtemps à substituer le clavier aux doigts ; on fit de nombreux essais. Hessel, mécanicien allemand, fixé à Saint-Pétersbourg, fut le premier, en 1785, qui réussit complètement à faire un harmonica à clavier, qui paraît n’avoir rien laissé à désirer. Klein, de Rudelsdorf, en Moravie, imagina en 1789, une nouvelle espèce d'harmonica à clavier, et substitua. des lames de verre aux gobelets. On avait vu, en 1786, un nommé Harling construire un harmonica avec quarante-six. cloches de verre, sans touches ni clavier elles étaient mises en vibration au moyen d'une roue.
Le CLAQUEBOIS ou échelettes est un instrument à percussion du genre harmonica, C'est un assemblage de petits bâtons cylindriques d'inégale longueur, et chacun proportionnellement plus petit que l’autre. ils sont ordinairement faits d’un bois résonnant et enfilés par ordre, à commencer du plus grand jusqu'au plus petit. Le nombre peut varier de douze à vingt, suivant la quantité de sons ou, pour mieux dire, l’étendue qu'on veut donner à l'instrument. On frappe les bâtons cylindriques avec deux petites baguettes à tête arrondies ou en forme de marteau, qui, sont aussi de bois. Par ce moyen on en obtient des sons qui ne laissent pas d’avoir quelque analogie avec ceux de l’harmonica, bien qu’ils soient plus doux et attaquent moins les nerfs. Le système de construction de cet instrument, aussi bien que ses dénominations , a varié suivant les pays. où il a été et en usage. Le modèle dont on s'est le plus communément, servi en Allemagne est l’instrument de bois et de paille appelé Strohfiedel (violon de paille) ; son nom vient de ce que les bâtons cylindriques sont assemblés et échelonnés sur deux liens ou coussinets de paille que l’on place de chaque côté du triangle, car telle est à peu près la figure ordinaire que présente l’arrangement des bâtons. Les Russes, les Polonais, les Cosaques, les Tartares, les Lithuaniens, les monts Karpathes et ceux des solitudes de l’Ural, ont, de temps immémorial, cultivé parmi eux une espèce de claquebois nommée Jérova i salamo. Cet instrument n’a pas cessé d’être en usage dans la plupart de ces contrées, où l’on rencontre assez souvent des musiciens ambulants (Spieleutte) et des ménétriers de village qui continuent de s’en servir. De tout temps le claquebois a été très-populaire, et, de la manière dont Prætorius en parle, il n’y ai pas lieu de douter, qu’on ne le rangeât dans la classe des instruments de la musique ambulante. On pouvait en jouer en marchant ; on portait le claquebois de la même manière que le psaltérion. On le maintenait suspendu horizontalement devant soi au moyen d’un grand cordon passé autour de son cou, et dont chaque bout est fixé à l’un des côtés latéraux de l’instrument.
Le public parisien s’occupa, il y a une quinzaine d’années, de ce petit instrument, qu’un artiste doué d’un talent, extraordinaire avait su rendre digne de lui. Cet artiste, nommé Gusikow, était un pauvre israélite de la Pologne russe. La nature l’avait doué d’une âme de feu et d’une intelligence remarquable. Simple musicien ambulant dans les premiers temps de sa vie, il s’était pris d’affection pour son chétif gagne-pain il l’avait perfectionné peu à peu, au point d’en faire un instrument de concert. Il y déployait une rare habileté d’exécution et y jouait des fantaisies d’une extrême difficulté. Pour se servir de cet ingénieux et modeste appareil, qu’il appelait Holzharmonica ou harmonica de bois, l’artiste le posait sur une petite table et employait pour frapper les cylindres deux bâtons ou baguettes de bois dur qu’il tenait entre le pouce et le doigt du milieu. Le son qu’il tirait de son instrument était surtout favorable à l’expression d’un sentiment tendre et douloureux. C’était un timbre métallique tenant de la cloche et du verre, mais avec plus de douceur et moins d’éclat. On ne saurait rien imaginer de plus étrange, de plus incisif et de plus pénétrant. Le modèle de Strohfiedel dont nous venons de parler semble avoir été à peu près inconnu en France, il n’en a pas été de même de deux instruments de la même famille vulgairement désignés sous les noms d’ESCHELETTES ou échelettes, patouilles, xylorganon, claquebois et régale de percussion (en italien sticcato). Le xylorganon ou les échelettes se composaient d’une certaine quantité de morceaux de bois sec durcis au feu, ordinairement au nombre de douze, tous de même grosseur, mais de longueur différente ; ils étaient percés de deux trous, un à chaque bout. Un cordon passant à droite et à gauche par ces trous tenait les bâtons enfilés et suspendus parallèlement, depuis le premier en haut, qui était le plus court, jusqu’au dernier en bas, qui était le plus long. On ménageait entre eux des intervalles pour qu’ils ne portassent pas les uns sur les autres, soit en faisant deux nœuds au cordon pour chaque bâton, soit en y enfilant une petite rondelle. Quand on jouait de cet instrument, on le tenait suspendu en l’air de la main gauche, au moyen d’une corde, et l’on frappait de la main droite les bâtons avec un petit marteau. M. Clapisson, notre aimable et spirituel compositeur. possède dans son cabinet harmonique un ancien instrument de cette espèce fort bien conservé. Nous signalons aux amateurs et aux facteurs la belle et intéressante collection d’instruments de M. Clapisson. Nous avons eu le bonheur d’être admis dans le sanctuaire, et nous avons tout d’abord admiré, au milieu de tant de richesses, un chef-d’œuvre : c’est une petite épinette renfermant cinquante-deux cordes, d’un travail parfait et d’une conservation étonnante ; cet instrument porte pour étiquette : Francesco de Portalesqui, Veronen, MDXXIII.
La Flandre passe pour avoir inventé le CLAQUEBOIS ou régale de bois, mais toute cette invention se réduit à avoir adapté un clavier aux échelettes. Les bâtons cylindriques étaient fixés sur la table supérieure d’un petit coffre plat, long et trapézoïde, dans l’intérieur duquel il y avait des sautereaux ou marches qui frappaient chaque bâton quand on faisait mouvoir la touche correspondante à ce dernier. Ces touches étaient de simples palettes rangées de file sur la face antérieure de la boîte. Il y en avait dix-sept, autant que de bâtons.
LES CLOCHES, petites ou grandes, étaient des instruments sonores souvent employés dans les orchestres anciens. On désignait généralement, suivant Strabon, par le terme de campana, une cloche plus grande que celle qui servait à donner des signaux. Grégoire de Tours dit que du temps de Sidoine Apollinaire, qui vivait en 480, les Auvergnats usaient de petits sings. Dans la suite il y en eut de fort grandes ; telles étaient celles que l’on plaçait dans les beffrois, sortes de tours qui furent d’abord portatives, et que l’on éleva ensuite à demeure dans les communes, sur les places publiques.
La cloche du beffroi, dit M. Kastner, auquel nous sommes toujours forcé d’emprunter, parce que, en fait d’érudition musicale, il est un véritable accapareur (et dans le champ de cette science, il est difficile de glaner après lui sans toucher à sa récolte), prit aussi le nom de cloche banale, ou bancroche (bancloque), à cause, d’une des significations du mot bannir, qui était l’équivalent d’appeler, convoquer, publier. Dans les églises et dans les monastères, la cloche principale était celle qui appelait les fidèles aux offices divins, c’était aussi la plus grosse. On croit cependant que, dans l’origine, elle ne dépassait. pas la grandeur d’une sonnette ou tintinnabulum. Un moine ou un clerc la tenait à la main et la faisait tinter à la porte du temple ou du haut d’une plate-forme. Bientôt elle prit un tel accroissement de volume, qu’il fallut bâtir, dans la partie la plus élevée des édifices religieux, un petit corps de logis spécial, en forme de tour, pour qu’elle y pût manœuvrer à l’aise et produire des sons qui s’entendissent de fort loin. Guillaume Durand , évêque de Mende au treizième siècle, fait voir, dans son Rationale divinorum officiorum, qu’il y avait de son temps plusieurs sortes de cloches employées pour le service du culte et pour l’usage des prêtres : « Il faut noter, dit-il, qu’il y a six espèces de timbres qu’on sonne dans l’église, à savoir : le squille, la cimbale, la nole, la nolète, ou la cloche double, la campane, le seing (signum). La squille est sonnée dans le dortoir et le réfectoire, la cimbale dans le cloître, la nole dans le chœurs, la nolète dans l’horloge, la campane dans la campanile, le seing dans la tour. » Chacune de ces espèces, ajoute-t-il, peut généralement s’appeler cloche (tintinnabulum). Cependant le nom de tintinnabulum s’appliquait plus particulièrement aux petites cloches ou clochettes ; il y a lieu de supposer que la squille, la cymbale et la nole en faisaient partie. Au moyen âge, les vieux auteurs français appellent communément toutes ces variétés de petites cloches : tintinable, campane, campanelle, cloques, cloquettette (clocette, clochestre), cymbale, sonneau, sonnaille. Tintinable, cymbale n’exprimaient pas-seulement de petites cloches, des sonnettes ou des grelots, ils s’appliquaient aussi à des instrument d’une autre nature, comme les crécelles et les castagnettes.
Les CLOCHETTES OU SONNETTES sont de petits instruments de percussion fait de métal, en forme de poire, creux en dedans, ouverts par en bas, fermés par en haut, et résonnant, soit au moyen d’un battant intérieur, qui en frappe les parois lorsqu’on agite l’instrument, soit à l’aide d’un marteau, dont les coups réguliers tombent sur la surface extérieure de la clochette. Ces instruments sont en petit ce que les grosses cloches d’église sont en grand. Ils étaient connus des anciens ; on les appelait du nom génétique de tintinnabula. Leur origine est mieux constatée que celle des grandes cloches, dont l’usage passe pour être moderne et particulier à l’occident, quoique, à. vrai dire, on lie sache rien de positif à cet égard. Les sonnettes étaient souvent garnies d’un manche qui servait à les faire vibrer.
Outre ce tintinnabulum, il existait un autre instrument composé de plusieurs clochettes de divers calibres, suspendues en file à une barre de bois ou de fer, et donnant des sons différents quand on les frappait l’une après l’autre en cadence avec un petit marteau. Ce tintinnabulum, dont Gerbert a donné le dessin, ne tarda pas à produire les CARILLONS plus ou moins compliqués, et donna naissance à celui dont on se sert encore aujourd’hui dans les musiques militaires. On appelait SONNATES un instrument de cette espèce composé de douze timbres, élevés et fixés sur une tige.
On nomme GRELOT une boulette de cuivre ou d’argent, creuse et fendue, dans laquelle sont enfermés un ou plusieurs morceaux de métal, qui tintent quand le grelot remue. De même que les petites sonnettes ouvertes par en bas, les grelots s’employaient au moyen âge pour l’utilité et pour l’agrément. Il était de mode d’en mettre aux riches parures des seigneurs, d’en former des colliers complets et d’en orner la pointe, aiguë et courbe des souliers à la poulaîne. Les grelots ont fourni un supplément de sonorité bruyante à quelques instruments de percussion, par exemple aux tambours de basque. Souvent aussi, dans les quinzième, seizième et dix-septième siècles, on mettait aux Castagnettes ou cliquettes un appendice de grelots destiné à mêler son éclat argentin aux roulements secs de l’instrument de bois. Prætorius donne, dans sa Sciagraphia, le dessin d’une paire de ces castagnettes à grelots, et l’on en trouve un exemple plus ancien dans la Musurgia de Lucinius. C’est peut-être à cause de cette alliance que le nom de crotales fut appliqué pendant longtemps tantôt à des castagnettes, tantôt à des grelots.
Le SISTRE, d’origine égyptienne, fut en usage aussi dans les premiers temps de l’ère chrétienne. Le sistre avait conservé son caractère primitif. C’était toujours un cercle de métal traversé par des baguettes pareillement de métal, auxquelles on passait quelquefois un certain nombre d’anneaux.
On a, pendant longtemps, discuté sur le sistre, sur sa forme et son emploi ; les uns ont voulu que ce fût une trompette, d’autres un instrument à cordes. Enfin, l’expédition d’Égypte a mis fin à ces incertitudes et nous a donné du sistre une description certaine.
Des auteurs ont cru que le sistre fut inventé pour effrayer Typhon ou le mauvais esprit. Plutarque, qui a mentionné ce fait (Plut. ; de Isid., s. 63), ajoute que, sur la partie convexe de cet instrument, se trouve un chat avec la figure humaine, et sur la gauche la figure d’Isis, tandis que, sur le côté opposé, on voit celle de Neptis.
Cet instrument avait la forme ovale et à jour, presque semblable à nos raquettes. Ses branches étaient percées à égales distances pour recevoir trois ou quatre petites baguettes mobiles, qui servaient elles-mêmes quelquefois à enfiler de petites plaques de métal de différentes grandeurs. Dextra quidem ferebat aureum crepitaculum cujus per augustam laminam, in modum balthei recurvatam, trajectœmediœ paucœ virgulœ, crispante bracchio trigeminos jactus, reddebant argulum sonum. (Apuleus, Metap liv. XI.)
Ne doit-on pas être étonné de voir imprimé, en 1834, à une époque où il n’était plus permis à personne d’ignorer ce que c’est qu’un sistre, dans un livre destiné à la jeunesse, que le sistre est un instrument à cordes ? Ouvrez le troisième volume de la traduction de Virgile par M Villeneuve, faisant partie de la collection de Pankoucke, vous lirez aux notes du neuvième livre, page 181 : « Le sistre, égyptien était une petite harpe à quatre cordes ; on le voit sur les monuments qui représentent Isis, etc., » confondant ainsi le, sistre égyptien avec le cistre en usage chez nos ancêtres.
Le sistre parait avoir été inventé par les prêtres, comme les cimbales et le tambour. Cet instrument employé dans les cérémonies religieuses, se faisait surtout remarquer pendant ces grandes solennités qui avaient lieu à l’occasion du débordement du Nil. Les Hébreux réservaient aussi l’usage du sistre pour un jour non moins remarquable : Ainsi, quand le Roi Prophète revient de l’armée après avoir tué le Goliath si terrible, les femmes et les vierges sortent de la ville dansant et chantant, animées par le son du sistre et du tambourin. Plus tard, chez les Grecs, il servit à marquer la mesure dans l’exécution de la musique notée. A Rome, nous le retrouvons consacré à des usages qu’on ne peut plus appeler, à la vérité, religieux, mais qui ont pris leur source dans les croyances divines. Le sistre y fut spécialement affecté à la folie des superstitions égyptiennes, qui passèrent en Italie avec un crédit étrangement ridicule. Que de personnes, réputées, même de bon sens, ajoutant foi à cette futilité, agitaient leurs sistres, à certaines heures de la journée, pour repousser le malheur ! ce qui fait dire à Properce que Cléopâtre voulait, avec le sistre, chasser la trompette romaine. Cet instrument était employé aussi, chez les Romains, dans les cérémonies lugubres, ainsi que dans les pompes funèbres.
Le sistre avait ordinairement de 15 à 18 pouces de long ; il était fait de bronze ou de cuivre : quelquefois on l’enrichissait d’argent, de dorure et d’autres ornements. Il y avait aussi quelques sistres dont la partie ovale se trouvait inférieure et se composait de différentes pièces mobiles se contre-carrant mutuellement.
Le cabinet des antiquités de la Bibliothèque Royale de Paris, ainsi que le Musée Egyptien du Louvre, possèdent des sistres ; ils sont tous garnis de barres, mais sans anneaux. Une chose assez remarquable dans les trois sistres de la Bibliothèque, c’est que, semblables par la forme, le dessin, par la. nature même du métal employé à leur fabrication, et qui sont de la même époque, ils ont juste un ton de différence dans leur son. On tenait l’instrument d’une main par le manche, qui était ordinairement placé à sa partie inférieure, et on le secouait pour agiter les verges de métal ainsi que les anneaux de l’ébranlement desquels résultait un frémissement sonore. Dans les premiers temps du moyen âge, le sistre disparut et l’on ne rencontre plus sur les monuments que le triangle.
Le TRIANGLE, chez les Latins, s’appelait alors cymbalum, crotalum, tripos colyœus. En vieux français en lui donna le nom de TRÉPIE (trois pieds). Cet instrument est cité dans Guillaume de Machault : « Trépie, l’eschaqueil d’Angleterre. » Au treizième siècle, et même antérieurement, la trépie avait une forme semblable à celle du triangle moderne. Elle consistait en trois verges de fer attachées ensemble, ou bien se composait d’une seule tringle du même métal, ployée en forme de triangle. Quelque fois le triangle présentait la figure d'un trépied de fer creux à jour, comme dans le modèle que Gerbert nous fait connaître d'après un manuscrit de saint Eméran, du neuvième siècle. Il y a cette différence entre l'ancien et le nouveau modèle, que, dans le premier, des anneaux mobiles sont passés au fil de fer ou d'acier du triangle, tandis que le triangle est aujourd'hui sans anneaux. On agitait et l'on promenait ces petits cercles de métal avec la verge ou baguette de fer qu’on tenait à la main, tout en frappant de temps en temps en cadence sur les côtés de l'instrument. Les anneaux ajoutés au triangle furent de mode jusqu'à la fin du dix-huitième siècle ; le nombre n’en était pas fixé et variait de trois à cinq ; du temps de Mersenne, et plus récemment, il y en avait ordinairement cinq. Du reste, on employait très-souvent l'instrument sans y joindre ces supplément de sonorité.
Les Egyptiens avaient aussi un instrument que l'on a nommé sistre fort improprement, car il était loin d'avoir avec lui la moindre similitude. Il ressemblait à nos triangles modernes ; il avait la forme d'un delta grec D. C'est de cet instrument dont il est parlé dans le triomphe de David. Les femmes allèrent au devant de Saül et de David au son des tambours et des scalischim. On le trouve représenté sur différents bas-reliefs égyptiens.
Comme le triangle n'exige de la part de celui qui en joue que le sentiment naturel de la mesure, et qu'il ne présente d'ailleurs aucune difficulté, les ménétriers, ainsi que les mendiants appelés jadis truands, l’avaient introduit dans leurs concerts de musique ambulante. Au dix-huitièmes siècle, ils l'employaient jointe à la vielle à roue ; le triangle s'appelait alors cymbale, bien qu'on appliquât en même temps ce nom aux plaques rondes d'airain, dont on mêle maintenant les frappements avec les coups de la grosse caisse.
On fait aujourd'hui un grand abus de cet instrument, comme de tout ce qui perce, mugit, éclate, tonne, grince et siffle. Son timbre métallique ne convient qu'aux morceaux très-brillants dans le forté et d'une bizarrerie sauvage dans le piano ; cependant, on perçoit avec plaisir, au milieu des airs de danses, le timbre cristallin et –un peu mordant du triangle.
Par CYMBALES, on entend une sorte d'engin métallique qui n'est pas une clochette ou un grelot, mais qui consiste en deux plaques de cuivre mobiles trouées à un endroit et assemblées deux par deux, de manière à frapper l'une contre l'autre. Dans quelques provinces de la France, par exemple, en Alsace, on rencontre des attelages de meuniers et de rouliers dont les chevaux portent à leurs harnais des plaques rondes de cuivre à peu près semblables.
Cet instrument de percussion est composé de deux plaques circulaires d'airain, d'un pied de diamètre et d'une ligne d'épaisseur, ayant chacune à leur centre une petite concavité et un trou dans lequel on introduit une double courroie. Pour jouer de cet instrument, on passe les mains dans ces courroies et l'on frappe les cymbales l'une contre l'autre du côté creux. Le son qu'elles rendent, quoique très-éclatant, n'est pas appréciable.
On réunit les frappements des cymbales à ceux de la grosse caisse pour marquer le rhythme, ou seulement la mesure, dans les marches guerrières, les airs de danse fortement caractérisés et les ouvertures, symphonies et chœurs qui ont une couleur militaire.
« Les cymbales antiques étaient fort petites, dit M. Berlioz et leur son est d'autant plus aigu qu'elles ont plus d'épaisseur et moins de largeur. J'en ai vu au musée de Pompéi, à Naples, qui n'étaient pas plus grandes qu'une piastre. Le son de celles-là est si aigu et si faible, qu'il pourrait à peine se distinguer sans un silence complet des autres instruments. Les cymbales servaient, sans doute dans l'antiquité, à marquer le rhythme de certaines danses, comme nos castagnettes modernes. »
TAM-TAM. Instrument de musique à percussion, originaire des Indes-Orientales ou de la Chine. Il se compose d'un large plateau de métal, sur lequel on frappe avec un marteau ou avec une forte baguette garnie d'un tampon. de peau. Le son qui en résulte est d'un caractère lugubre. Il a d'abord une très-grande force, qu'il perd ensuite, dans des vibrations prolongées. Ce son étrange, qui réveille un sentiment de terreur, ces vibrations lentes, et continues sont dus à la combinaison des métaux dont l'instrument est forgé, et plus encore à la manière dont il est trempé. Le tam-tam, fort en usage chez les Orientaux, ne s’emploie, chez nous que bien rarement, avec beaucoup de réserve, et seulement dans la musique funèbre, ou dans certaines scènes de musique dramatique destinées à produire des effets d'un caractère sombre et terrible.
Le cuivre rouge en usage pour faire, en Chine, les, tams-tams et les cymbales, doit être allié avec de l'étain pur. On prend, dit l'Encyclopédie chinoise TIAN-KONG.-KAÏ-WE, qui se trouve à la Bibliothèque Impériale, pour fabriquer les tams-tams, huit livres de cuivre rouge qu’on allie avec son quart de poids d’étain, et auquel on fait subir un tour de main, qui consiste dans la trempe de l’alliage. Si l’on veut fabriquer des clochettes, des cymbales, le cuivre rouge et l’étain doivent être beaucoup plus purs et plus raffinés que pour les tam-tams. Pour fabriquer ces derniers, il ne faut pas couler, mais forger à coups de marteau ; on commence par fondre une feuille épaisse de métal, on la taille en rond, puis on la bat à coups de marteau. Lorsqu’on veut battre un tam-tam, on étend sur le sol la feuille de métal arrondie, et si l’instrument doit être d’une grande dimension, quatre ou cinq ouvriers se rangent en :rond et la frappent à coups de marteau. De petite qu’elle était, la feuille s’étend et s’élargit sous le marteau, et les bords se relèvent ; alors l’instrument commence à laisser échapper des sons qui imitent ceux d’une corde sonore. Au milieu de ce tambour de cuivre on forme une bosse ou saillie arrondie, ensuite on la frappe, et les coups de marteau lui donnent le ton. On en distingue deux dans le tam-tam : le ton mâle et le ton femelle dépendent de la saillie plus ou moins grande que l’on doit donner avec une pression vigoureuse à la partie relevée en bosse, selon que l’on veut obtenir l’un ou l’autre ; en doublant les coups de marteau, on donne à l’instrument un ton grave.
On fait forger en cuivre rouge ou en laiton, dit un autre procédé, le modèle de l’instrument ; on donne à ce modèle exactement les formes voulues en y faisant pénétrer plus ou moins la paume du marteau sur les deux surfaces, de manière à y former la continuité d’enfoncements sphériques et de parties saillantes que l’on remarque sur les cymbales et surtout sur les tambours. Le modèle achevé on s’en sert pour faire un moule en sable ou potée ; on compose un alliage de quatre-vingts parties de cuivre et vingt d’étain fin ; on coule cet alliage en lingot, on le fait refondre, et on coule la pièce moulée. Cette pièce, sortie du moule, est ébarbée, et on la trempe comme on fait pour l’acier. Si la pièce s’est déformée en la plongeant dans l’eau froide, on en rectifie la forme au moyen du marteau et en la planant à petits coups. On lui donne le ton convenable, soit, primitivement, en forçant plus ou moins la trempe, soit en recrouissant la pièce par un martelage suffisant. On la gratte au moyen d’un tour, comme on le fait pour les chaudrons de cuivre, et l’instrument est terminé.
Dans la nomenclature des instruments sonores, nous ne devons pas oublier un des plus anciens, la REBUTE ou GUIMBARDE, composé de deux branches de fer ou plutôt d’une branche pliée en deux parties, entre lesquelles est une languette d’acier (anche libre) attachée par un bout pour faire ressort, et soudée à l’autre bout. On tient cet instrument avec les dents de manière à ce que les lèvres ne touchent pas à la languette. On la fait remuer en passant la main promptement par-devant et en frôlant le bout recourbé. La modification de la langue et des lèvres achève le reste. La guimbarde ou l’anche libre a donné naissance à une foule d’instruments dont nous parlerons plus tard.
Les instruments de percussion composés de plusieurs petites pièces de bois, d’or ou de métal, que l’on place entre les doigts, et que l’on fait bruire par le choc en les appliquant l’une contre l’autre, sont simples et élémentaires : c’est au choc des mains qu’ils doivent sans doute leur origine. Lorsqu’on voulut approprier à un usage plus sérieux ces instruments de percussion, on les perfectionna et on en varia la forme de différentes manière. Ceux qu’employaient les peuples de l’antiquité, et que les auteurs désignent presque toujours indifféremment par les mots cymbales et crotales, consistaient ordinairement chacun en deux pièces de bois ou de métal, tantôt plates, tantôt concaves. On en jouait des deux mains lorsqu’ils étaient d’un certain volume et d’une seule main lorsqu’ils étaient plus petits.
De là deux types différents que l’on a distingués quelquefois et que l’on a souvent aussi confondus sous les noms de cymbale et de crotales, aujourd’hui CYMBALES et CASTAGNETTES. La première de ces dénominations est à présent attribuée à des instruments composés de deux plaques rondes de métal, ayant chacune à leur centre une petite concavité et un trou dans lequel on introduit une double courroie. Nous appelons aussi cymbales antiques d’autres instruments de métal ayant, uns partie convexe présentant à peu près la forme semi-sphérique des timbales avec lesquelles elles furent, par cette raison, très-souvent confondues. La seconde dénomination s’applique, de nos jours à deux petites pièces de bois concaves, faites en forme de noix, et accouplées au moyen de cordons peu serrés, dans lesquels on passe un ou deux doigts, pendant qu’on se sert des autres doigts pour frapper les deux parties de l’instrument 1’une contre l’autre.
On rencontrait en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, les crotales bombées, dont le nom espagnol castanuelas eut d’abord pour équivalent dans notre langue, à ce que l’on croit, le mot maronetes, et fut ensuite francisé dans celui de CASTAGNETTES. Moins simples et mains grossières que les cliquettes, les castagnettes des quinzième, seizième et dix-septième siècles se rapprochent davantage de celles dont nous nous servons par leur forme à peu près semblable, comme le dit Mersenne, à celle d’une cuiller, avec cette différence qu’elles sont plus allongées et moins concaves. Ce qui les distingue principalement des castagnettes actuelles, c’est que, au lieu d’être divisées en deux parties séparées, elles se composaient généralement, comme les cliquettes ou tablettes de trois ou quatre pièces ou lames mobiles attachées ensemble et frappées d’une seule main. Aujourd’hui, au contraire, quand il y a quatre parties ou coquilles de bois, on les partage en deux groupes et l’on en prend un couple dans chaque main.
Indépendamment de ces castagnettes, que l’on emploie surtout pour la musique de danse, il en est d’autres qu’affectionnent particulièrement les gamins et les écoliers : elles se composent ordinairement de simples morceaux d’ardoises ou de débris de pots cassés. Les plus artistiques consistent en deux petites-planchettes longues et étroites, que l’on garnit intérieurement de pointes de fer ou d’acier en forme de têtes de clous. Ce modèle est celui qui rappelle le mieux les crotales plates dont on se servait au moyen âge, et qu’on appelait CLIQUETTES. Elles consistaient dans un assemblage de plusieurs petites plaques ou languettes mobiles tenant par leur extrémité inférieure, à un manche à l’aide duquel on leur imprimait des secousses qui leur faisaient produire, en s’entre-choquant, un cliquetis plus ou moins fort. Les ladres, les crétins, les cagots étaient assujettis, pur mesure sanitaire, à porter sur eux des cliquettes et à s’en servir dans les rues, afin de signaler leur présence et d’engager le public à s’écarter de leur chemin.
La CRECELLE est composée d’une lame de bois qui est fixée par une extrémité, et dont le bout résonne au moyen d’une roue dentée qui l’attaque. Les grandes et les petites crécelles ont souvent remplacé les cloches dans le culte chrétien. L’abbé Amalaire, diacre de l’église de Metz, dit que, durant les persécutions, les fidèles s’assemblaient au bruit de certains instruments de bois qui étaient à peu près semblables aux crécelles. L’Eglise d’Orient avait adopté, à ce que l’on croit, l’usage de TABLES DE BOIS ou de plaques de fer ou d’airain, nommées également tablettes. Balsamon, qui vivait vers la fin du douzième siècle, observe que l’on battait trois fois le fer et l’airain pour assembler les religieux aux offices : la première fois s’appelait le petit coup ; la deuxième, le grand coup, et la troisième, le coup de fer. Ces trois coups avaient une signification symbolique. Le coup de fer signifiait le jugement dernier et la trompette au son de laquelle 1es morts sortiront de leurs tombeaux. Dans la semaine sainte, pendant les Ténèbres, on fait encore usage des crécelles. En Espagne, on se sert alors d’un instrument particulier qui y supplée et qui y tient lieu, par le grand bruit qu’il fait, d’une multitude de crécelles. On l’appelle matracca.
On nomme CHAPEAU CHINOIS un instrument dont la tête en cuivre a la forme d’une coiffure chinoise adaptée à une longue tige, et qui est garnie de clochettes de différents calibres, que l’on fait résonner en secouant la tige qui entre librement dans un manche, comme le sabre dans le fourreau.
Le BACCIOLO est un instrument usité en Toscane ; il consiste dans un vase qui a la forme d’une écuelle. On le tient de la main gauche, et de la main droite on le frappe avec un pilon de la longueur de quatre pouces environ et assez semblable à ceux que l’on emploie pour mortiers en bronze. Les sons que l’on tire de cet instrument ne sont pas harmonieux, mais ils plaisent aux paysans de cette contrée.
CHAPITRE X
QUATRIEME DIVISION
INSTRUMENTS MIXTES.
Nous comprenons, dans cette division, tous les instruments qui n’ont pu trouver place dans les familles spéciales dont se composent les divisions précédentes, soit parce que ces instruments réunissent en eux diverses qualités inhérentes à plusieurs familles particulières, comme le piano-viole qui est à la fois instrument à cordes frappées et instrument à archet, soit parce que ces instruments n’ont pas assez de parties distinctives pour Former une spécialité ; leur isolement d’ailleurs, et fréquemment leur petit nombre, rendait une classification particulière inutile. Souvent ces instruments n’ont fait que paraître, ils n’ont jamais eu de frères, et, pour la plupart, le jour de leur apparition n’a pas eu de lendemain. De tous ces instruments si divers, construits presque tous par des mains fort habiles, mais conçus par des hommes peu musiciens, nous avons composé une nomenclature alphabétique ; c’était le seul ordre qu’il nous a paru convenable d’adopter.
On reconnaîtra presque toujours dans la construction de ces instruments un grand talent de mécanique ; mais comme ce sont rarement des musiciens qui en ont eu l’idée, la majeure partie, n’ayant pas raison d’être, est tombée presque aussitôt dans l’oubli. Ces malheureuses productions, véritables loups, n’ont que trop souvent dévoré leur inventeur, qui espérait la fortune en courant après une chimère. Ce sort attend tout créateur d’instrument qui ne satisfera pas un besoin, qui ne comblera pas une lacune, qui n’offrira pas à la musique une voix nouvelle, qui ne construira pas, enfin, un instrument d’un timbre spécial, qui trouve, dès sa création, sa place marquée dans les orchestres.
Les instruments ou les moyens imitateurs n’ont pas chance de succès, parce que l’imitation ne peut jamais valoir la réalité, et que les moyens mécaniques destinés à remplacer l’homme seront toujours impuissants, car il y a des choses auxquelles on ne saurait suppléer, et aucun moyen artificiel ne pourra remplacer le vouloir et le génie qui font agir la machine humaine. Ainsi, un clavecin à archet n’est plus, avec ce perfectionnement, qu’un mauvais clavecin, auquel on a enlevé le charme de l’attaque et de la percussion, pour lui faire imiter mécaniquement un instrument à frottement, qui, sans le sentiment qui dirige l’archet, n’est d’aucune valeur.
AMPHICORDUM. Nom donné à la lyre barbarina construite, en 1673, par un praticien florentin, nommé Donis. Cet instrument avait la forme de la basse de violon, mais avec douze à quinze cordes, et se jouait également avec un archet.
ANGÉLIOUE (l’) est un instrument ancien de la famille des luths, employé en Angleterre, et que l’on croit avoir été inventé dans le dix-septième siècle par Rotz, fabricant d’orgues à Mulhouse, en Alsace.
ANEMOCORDE (l’), instrument à clavier, construit, à Paris, par un facteur allemand du nom de Schnell. Ce facteur entendit, un jour de l’année 1784, une harpe, suspendue au-dessus de son établi, rendre des sons. Un courant d’air, établi dans sa chambre, faisait résonner les cordes comme celles dame harpe éolienne ; frappé de ce phénomène, Schnell chercha à produire mécaniquement ce que le hasard avait fait, et de forcer l’air à faire parler les cordes ; de là la création de l’anémocorde, qui demanda quatre ans de travail et d’essai. Dans cet instrument les cordes se trouvent mises en vibration par l’action d’un courant d’air ménagé sous chacune d’elle, à la distance voulue.
APOLLON (l’) est le nom d’un instrument en guise de luth à vingt cordes, inventé, à Paris, en 1678, par un artiste nommé Promt.
ARCHICEMBALO (l’) fut inventé, en 1557, par Nicolas Vicente, de Vicence. Cet instrument était un clavecin ayant plusieurs claviers, divisés en cinq parties et de telle sorte qu’on pouvait, suivant son auteur, appliquer, par leur moyen, les genres diatoniques, chromatiques et enharmoniques des anciens à l’harmonie de la musique moderne.
ARCHI-VIOLE (l’) était une espèce de clavecin auquel on avait adapté un jeu de vielle, qu’on accordait avec le clavecin et qu’on faisait aller au moyen d’une roue et d’une manivelle.
ARCHI-VIOLE DE, LYRE (l’) était un instrument à cordes, usité anciennement en Italie, et qui ressemblait, par sa structure et son jeu, à la basse de viole, excepté son manche, qui était beaucoup plus large, pour pouvoir supporter les quinze ou seize cordes dont l’instrument était monté. Il avait deux cordes, au grave, qui débordaient le manche et qui se jouaient à vide.
BASSE DE VIOLF A CLAVIER, inventée et construite par Risch, de Ilmenau (grand-duché de Weimar), en 1710. Cet instrument était monté de cordes de boyau, mises en vibration par de petites roues enduites de colophane, qu’une roue plus grande, placée sous la caisse, mettait en mouvement. (Voir Clavecin-viole.)
BASSON A FUSÉE (le) (Racketten fagott) fut inventé, vers 1680, par Denner, de Leipsick. Cet instrument était d’un maniement assez facile ; mais il parait qu’il fatiguait horriblement la poitrine, à cause des neuf tours que faisait le tube, et il était difficile de saisir exactement les trous pour les boucher, sur ce tube si souvent recourbé.
BISSEX (le) était un instrument monté de douze cordes, qui ressemblait à la guitare. Il avait été inventé en 1770, par un chanteur de Paris, nommé Van-Hecke,. L’étendue de cet instrument était de trois octaves et demie. On lui avait donné le nom de bissex à cause du nombre de ses cordes, deux fois six. La table de cet instrument était plate, mais ayant le dos voûté comme celui des luths. Le manche, divisé en vingt cases, portait cinq cordes ; les autre cordes, placées à gauche et en dehors de la touche, se pinçaient à vide.
BONACORDO (le) était un clavecin dans lequel l’espace des octaves pouvait s’adapter aux petits doigts des enfants.
BUCHE (la), en allemand swied-holz, est un instrument très-peu connu, qui consistait dans une caisse longue et à peu près ronde, ressemblant à une bûche. Sur la table sonore de cet instrument étaient tendues trois cordes, par le moyen de chevilles. Ces cordes étaient à 1’unisson, et ensuite on fixait, à l’aide d’un petit crochet, une de ces cordes de façon que la partie située entre le chevalet et le crochet donnât la quinte supérieure. Pour jouer de cet instrument on touchait les cordes à la fois avec le pouce de la main droite, tandis qu’on produisait le chant, en promenant, de la main gauche, un petit bâton poli sur la corde la plus élevée ; la partie qui servait de manche était divisée par touches comme le manche de la guitare.
CARILLONS (les) sont de la même espèce que les jeux de clochettes (voir ce mot). La grosseur des timbres et le mécanisme pour les faire vibrer font seuls la différence. On doit à Foerster, de Silésie, en 1686, de grands perfectionnements dans les carillons ; appelé, en 1710, à Saint-Pétersbourg, par Pierre le Grand, il y construisit le beau carillon de la tour Saint-Jacques. Les grands carillons ne peuvent être placés que dans les clochers. Presque toutes les églises de Hollande en ont ; ceux d’Amsterdam sont les plus fameux. L’église paroissiale de Berlin en possède aussi un, et celui de la Samaritaine, à Paris, était mis en jeu par des cylindres, qui marchaient au moyen de roues hydrauliques.
CELESTINO (le), sorte de clavecin à archet inventé en Allemagne par le mécanicien Walker, en 1784. Un cordon de soie placé sous les cordes était mis en mouvement au moyen d’une roue de pédales, et de petites poulies mises au bout de chaque touche approchaient ce cordon des cordes et les faisaient vibrer avec une expression plus ou moins forte.
CHORDAULODION (le) ou Harmonicorde avait la forme d’un piano vertical ; il était monté de cordes métalliques mises en vibration par le frottement d’un cylindre ou par une roue que l’exécutant faisait mouvoir avec les pieds. La qualité des sons avait de l’analogie avec ceux de l’harmonica, mais ils étaient plus intenses.
CLAVECIN ARCHET (le). Cet instrument était monté de cordes de boyau, qu’on faisait résonner au moyen d’un archet garni de crins et mis en mouvement par une roue. Il y a quelques années, on a construit à Venise des clavecins à archet avec des améliorations importantes.
CLAVECIN A CONSTANT Accord) (le). Cet instrument fut construit à Mémel, en 1756, par Jean-Daniel Bertin. On prétend qu’il ne changeait jamais de ton quelle que fût la. température de l’air.
CLAVECIN ACOUSTIQUE (le) et le CLAVECIN HARMONIOUE sont deux instruments inventés, il y a soixante ans, par un certain de Verbès, à Paris. Ils se distinguaient par leurs sons, qui pouvaient imiter plusieurs instruments à cordes, à vent et de percussion, sans qu’il existât, dans leur construction, ni tuyaux, ni marteaux, ni pédales.
CLAVECIN A DOUBLE RÉSONNANCE (le) fut inventé, en 1770, par Frederici, de Mérona. Cet instrument était muni d’un mécanisme à l’aide duquel on obtenait d’une seule corde une double résonnance harmonique.
CLAVECIN A MARTEAUX (le) fut inventé, au milieu du dix-huitième siècle, par un prêtre napolitain, natif de Catane en Sicile. Dans cet instrument, les sautereaux venaient marteler la corde avec tant de vivacité, qu’ils lui faisaient rendre un son aussi fort, aussi brillant que celui que l’on obtenait précédemment par la plume, sans en avoir le glapissement. Ce clavecin avait également un jeu de harpe qui était, disait-on, parfait.
CLAVECIN A TOUCHES BRISEES (le), construit en Toscane, en 1661, par Bonis, pouvait, selon le Père Mersenne, s’accorder, dans une justesse parfaite, suivant les proportions mathématiques des intervalles.
CLAVECIN DIVISEUR (le). Dans cet instrument, construit vers le milieu du seizième siècle, par le facteur Pesaro, de Venise, à la demande de Zerlino, le ton se trouvait divisé en cinq parties par le nombre des touches du clavier.
CLAVECIN ÉLECTRIQUE (le), imaginé par La Borde (Jean-Baptiste), en 1755, était un carillon avec un clavier dont chaque touche correspondait à un timbre particulier ; le clavier faisait mouvoir les verges qui frappaient les timbres, et les touches ne se mouvaient que par l’action d’une commotion électrique.
CLAVECIN-LUTH (le), construit, d’après les idées de J.-Sébastien Bach, par Hildebrand, facteur saxon, à la fin du dix-huitième siècle.
CLAVECIN-ORCHESTRE (le), construit par Blaha (Vincent), à Prague, vers 1780, était une espèce de clavecin auquel il appliqua : 1° une musique turque composée de cymbales, triangles, sonnettes, tambourin, etc., etc. ; 2° un registre de flûte avec son clavier ; 3°, un tambour avec un fifre ; 4° une machine servant à imiter la cornemuse et les castagnettes ; 5° une autre machine à l’aide de laquelle on imitait le bruit de l’ouragan ; 6° un cylindre creux rempli de pois secs, dont le mouvement de rotation imitait le bruit d’une forte pluie d’orage ; 7° enfin, une trompette mise en action par un soufflet.
CLAVECIN ORGANISÉ (le), inventé par Delitz de Dantzig, consistait dans un jeu de flûte ajouté au clavecin et en divers-changements. Cette idée n’était pas nouvelle.
CLAVECIN PARFAIT ACCORD (le) était un instrument imaginé et construit par Luzzasco Luzzaechi, organiste de Ferrare, en 1577 ; il avait un clavier dont les touches étaient disposées de façon a pouvoir exécuter de la musique dans les genres diatoniques, chromatiques et enharmoniques. En 1606, Trasuntino, facteur à Venise, construisit pour le comte de Novellara un clavecin ayant le même but que le précédent. Cet instrument avait l’étendue de quatre octaves et était destiné à pouvoir jouer dans les trois genres. Chaque octave était divisée en trente et une touches.
Le CLAVECIN PARFAIT ACCORD, construit, en 1781, par Germain Goermans. Cet instrument possédait vingt et une touches par octaves c’est-à-dire, sept pour les notes naturelles, sept pour les notes diézées, et sept pour les notes bémolisées. Cette complication, très-ingénieuse comme mécanisme, n’eut aucun succès, vu la confusion des sons et la difficulté du doigté.
CLAVECIN ROYAL (le), construit à Dresde par le facteur Wagner, en 1786, n’était que l’adjonction d’un jeu de flûte, idée déjà essayée par Delitz ; Wagner ne fit que l’améliorer, et cependant il s’attribua l’honneur de l’invention.
CLAVECIN TRANSPOSITEUR (le) fut imaginé et construit à Catane par le même prêtre napolitain, inventeur du clavecin à marteaux. Dans le clavecin transpositeur, plusieurs hausses ou. chevalets mobiles, mis en mouvement par une pédale, donnaient le moyen de changer le ton de tout le diapason de l’instrument à la fois. L’auteur était déjà parvenu, en 1750, à hausser ou baisser de quatre demi-tons.
CLAVECIN-VIELLE (le), imaginé, vers 1711, Par un facteur de pianos ; au lieu d’archet, c’était une, roue qui attaquait la corde. En 1789, un nommé Gerli fit entendre un instrument. en forme de clavecin, dont les cordes étaient mises en vibration par des archets de crin. (Voir Clavecin à archet.)
CLAVEÇIN-VIOLE (le), imaginé par Jean Heyden, en 1600, Prætorius, donne la figure de cet instrument dont le mécanisme consistait, en petits archets cylindriques mis en mouvement par une grande roue que faisait agir une pédale. Les cordes employées par Heyden étaient métalliques et probablement filée. Hohlfeld reprit plus tarda en 1754, l’invention précédente, seulement, sur l’instrument qu’il présenta au roi de Prusse, les cordes étaient de boyau ; elles étaient mues également par un archet mécanique. (Voir Basse de viole à clavier.)
CLAVICITHERIUM (le) était un instrument à clavier ; il était formé par une harpe renversée, dont les cordes de boyau étaient verticales. Il est parlé de cet instrument dans la Musurgia de Nactigall, imprimée, dans la première moitié du seizième siècle.
CLAVI-MANDORE (la), instrument à clavier, construit à Wisbaden, en 1788, par Mahr. On ne trouve aucun renseignement touchant cet instrument.
CIMBALO OU NICORDO était un instruments à cordes appelé aussi Protée, qui fut inventé, en 1650, par un Florentin du nom de François Nigelli.
CLOCHE (la) est un instrument de métal destiné à annoncer les cérémonies du culte divin. Les plus grandes cloches vinrent de la Campanie et de la ville de Nola. Les cloches ont été introduites dans l’instrumentation pour produire des effets plus dramatiques que musicaux. Le timbre des cloches graves convient aux scènes solennelles ou pathétiques ; celui des cloches aiguës, au contraire, fait naître des impressions plus sereines : elles ont quelque chose d’agreste et de naïf qui les rend propres, surtout aux scènes religieuses de la vie des champs. On a tant écrit et on écrit tant encore sur les cloches que nous regardons comme inutile de donner plus de développement à cet article. (Voir Carillon.).
CLOCHETTES (Jeu de). On appelle Jeu de clochettes ou Glockenspiel un carillon à clavier en forme de piano, imaginé vers 1786, où les cordes sont remplacées par un très-grand nombre de petites clochettes ou timbres, semblables à des timbres de pendules. Mozart a donné une partie importante au jeu de Clochettes dans son. opéra de la Flûte enchantée. On se sert, quelquefois, dans la musique, d’un certain nombre de clochettes disposées diatoniquement, sur lesquelles on. exécute quelques mélodies simples et assez lentes au moyen d’un marteau léger. On fait de ces espèces de carillon dans différentes gammes : les plus aigus sont, les meilleurs.
CONSONNANTE (la), Nom donne à un instrument de musique inventé par l’abbé Du Mont, qui participait du. clavecin et de la harpe. Sa forme, était celle d’un grand-clavecin posé à plomb sur un piédestal qui avait des deux côtés de sa table, que l’on touchait comme celles de la harpe.
CORDOMÈTRE (le) est un instrument au moyen duquel on peut, mesurer la grosseur des cordes pour maintenir l’accord d’un instrument dans un égal degré de force Il y en a de plus leurs espèces. Le meilleur cordomètre est celui qui est formé de deux petits morceaux de fer ou de cuivre, de la longueur de six à sept pouces environ, qu’on attache avec des vis à une de leurs extrémités, et qui sont éloignés, à l’autre extrémité, de trois, quatre lignes et davantage, de façon qu’il existe un vide qui va toujours en diminuant et se perd tout à fait auprès des vis. Le premier cordomètre fut donné par Gérard Hoffmann, en 1734
COR DOUBLE (le), inventé à Londres, en 1780, par Clagget (Charles) ; sur cet instrument, les deux tons de ré et de mi bémol étaient accolés sur le même instrument, de manière à donner aux sons ouverts tous les demi-tons de la gamme chromatique par une clef qui mettait en communication l’embouchure avec l’un ou l’autre ton, à volonté.
CRISTALLOCORDE (le). Nom d’un clavecin inventé à Paris, en 1781, par un Allemand, nommé Royer. Cet instrument avait des cordes de cristal ; il succéda et remplaça le jeu des clochettes que Mozart avait introduit dans la Flûte enchantée, mais on dut promptement renoncer à son emploi à cause de la fragilité de l’instrument.
DENIS D’OR (le), inventé à Senflemberg, en 1762, par Diwisch (Procope). Cet instrument., sorte d’orchestrions se jouait, comme l’orgue, avec les mains et les pieds ; il imitait, dit-on, tous les instruments à cordes et à vent, et l’on assure qu’il pouvait produire cent trente variétés de qualités de son.
ECHOMÈTRE (l’) fut conçu, en 1701, par Sauveur, pour déterminer avec précision : la durée des mesures et des temps. Il consistait simplement dans la fixation, sur une mesure connue, de la longueur d’un pendule simple, qui faisait un tel nombre juste de vibrations pendant un temps ou pendant une mesure de mouvements. (Voir Métromètre.)
EPINETTE. A ARCHET (I’) est due à un sieur Renaud natif d’Orléans, artiste, fort ingénieux, qui chercha, en 1715, à augmenter le son de l’épinette en y appliquant un archet sans fin, formé d’un tissu de crin cousu sur une courroies. Les touches, par la pression du doigt, faisaient baisser la corde sur l’archet par le moyen d’un pilote fixé, à la touche, qui saisissait la corde en dessus et la rapprochait. de l’archet. L’instrument. était monté de cordes en boyau. (Voir Clavecin à archet.)
EPINETTE A MARTEAUX (l’), imaginée en Angleterre, vers 1750, était une épinette à laquelle on avait ajouté six rangs de sautereaux en plumes et un rang de sautereaux à marteaux. Les sautereaux en plumes heurtaient la même corde, les uns près du chevalet, les autres plus ou moins loin, ce qui permettait à la corde de rendre des sons d’une qualité différente, aigus, durs, mous, selon le point d’attaque, et cet instrument assure-t-on, faisait le piano et le forte. Ce fut un nommé Virbes, musicien de Paris, qui introduisit en France cet instrument.
EPINETTE À ORCHESTRE (l), construite à Paris, vers l’année 1750, était un instrument qui réunissait dans son corps deux violons, un alto et un violoncelle. Ces quatre, instruments ordinaires étaient posés horizontalement sur une table, ayant les chevalets placés comme de coutume ; mais ces chevalets, au lieu d’être courts et arqués, étaient très-longs et très-droits, et ils occupaient tout l’espace qui se trouve entre les SS. Sur le chevalet de chaque instrument il y avait quatorze cordes de boyau tendues. Chaque instrument avait un grand archet placé à quelques ligues au-dessus des cordes ; une pédale faisait tourner une roue, et cette roue faisait mouvoir le va-et-vient de chaque archet, qui ne jouait pas près des SS des instruments, mais à cinq pouces de distance du sillet des violons. Lorsqu’on mettait le doigt sur une des touches du clavier, la corde s’élevait et venait s’appuyer plus ou moins, fortement contre l’archet.
EPINETTE EXPRESSIVE construite, en 1710, par Berger à Grenoble, renfermait un mécanisme mis en jeu par la pression du genou, et au moyen duquel on obtenais, les effets du crescendo et diminuendo. Son essai, soumis à l’Académie, reçut son approbation ; il offrit de le mettre en œuvre moyennant. une souscription ; mais, comme elle ne fut pas remplie, il détruisit tous ses modèles, et tous ses plans, de telle sorte qu’à sa mort son fils ne trouva rien.
EUPHONE (L’), espèce d’harmonica à frottement, inventé, en 1789, par Chladni, à Withemberg. Cet instrument consistant en une caisse carrée, d’environ 1 mètre de haut sur 50 centimètres de large, contenant quarante-deux cylindres de verre, dont le frottement et, par suite, la vibration s’opéraient par un mécanisme intérieur.
FLUTE HARMONIQUE (la), construite, en 1780, à Paris, par Delusse, habile luthier. Cet instrument était composé de deux flûtes. à bec réunies dans un même corps, et sur lequel on pouvait jouer des duos.
FLUTES OCTAVIANTES (jeu de). Pompenius (Isaïe), facteur d’orgues à Brunswick, inventa, vers 1590, un jeu de flûte en bois (doubles flûtes, doiflœte), qui chantait à la fois comme un huit-pieds et comme un quatre-pieds, c’est-à-dire l’octave.
GUITARE A CLAVIER (la) imaginée, en 1780, par Bachmann, de Berlin. Cet instrument portait, vers la droite de la table, un mécanisme au moyen duquel les cordes étaient frappées par de petits marteaux.
GUITARE-ECHO (la) fut imaginée par un nommé Allix, qui vivait à Aix vers le milieu du dix-septième siècle. Il exécuta un squelette qui, par un mécanisme caché, jouait d’une guitare, tandis que lui-même avait une autre guitare accordée exactement à l’unisson. Après avoir mis les mains de son squelette sur les cordes, il allait se cacher dans un coin de l’appartement, et, quand il jouait, le squelette répétait ses modulations : il fallait que le temps fût calme et serein. Accusé de sorcellerie, ne pouvant ignorer les phénomènes de la sympathie sonore, il fut condamné à être pendu et brûlé en place publique, ce qui fut exécuté en 1664
HARMONICA A CLAVIER (l’). Nicolaï construisit, en 1765, un harmonica à clavier fort remarquable par sa précision et par les moyens mécaniques employés à le faire fonctionner.
HARMONICA A CORDES (l’) était un instrument à clavier inventé, en 1788, par Stein. Cet harmonica consistait dans un excellent piano, accordé et uni avec une espèce d’épinette qu’on pouvait jouer seule, ou conjointement avec le piano. Cette union produisait un effet agréable.
HARMONICA METÉOROLOGIQUE inventé, en 1765., par J.-César Gattoni, à -Rome Il fit attacher quinze fils de différentes grosseurs à une tour très-élevée, et forma ainsi une espèce de harpe gigantesque, qui allait jusqu’au troisième étage de sa maison, vis-à-vis, de la tour ; elle était accordée de manière à pouvoir exécuter de petites sonates. Le tout réussit à. merveille. Mais l’influence des vicissitudes atmosphériques et d’autres circonstances rendirent sans effet cette découverte ; l’abbé Gattoni ne se servit de cet instrument que pour faire des observations météorologiques et pour prédire avec ses divers sons harmonieux les divers changements de l’atmosphère.
HARMONICA VIRGINAL (l’), inventé et construit par Stiffel, cherchait à imiter la voix humaine.
HARMONICON (l’) construit par Stein, d’Augsbourg était de la même espèce que 1’harmonica ; mais le constructeur y avait ajouté quelques perfectionnements dont il est rendu compte dans la Gazette musicale de Spire, année 1789.
HARPE A CLAVIER (la), imaginée par Berger, facteur à Grenoble, en 1774. L’épinette verticale du P. Mersenne lui suggéra l’idée d’ajouter le clavier à la harpe ; il avait dressé les dessins et les tracés de cet instrument ; mais un nommé Frique, qui travaillait pour lui, lui enleva sa mécanique et ses plans.
LUTH-CLAVECIN (le) était un instrument du genre du clavecin, mais monté d’un double rang de cordes en boyau ; il avait été imaginé par Fleischer, en 1715, à Hambourg.
LYRE ALLEMANDE.(la), instrument du genre de la vielle, n’est plus en usage ; il consistait en une caisse de former oblongue, ressemblent à la partie supérieure d’une viole d’amour aux parois latérales de cette lyre, il y avait dix à douze touches qui servaient à raccourcir les quatre cordes attachées dans l’intérieur de l’instrument et formaient une étendue de sons diatoniques qui égalaient le nombre des touches. On obtenait la résonnance des cordes au moyen d’une roue frottée de colophane, que la main droite faisait tourner avec un levier, tandis que les doigts de la main gauche faisaient mouvoir les touches.
LYRE A BRAS (la), instrument de la dimension de l’ancienne viole de ténor à sept cordes ; il s’est éclipsé avec les instruments qui lui avaient servi de type.
MAIN HARMONIQUE (la) est le nom que donna Guido à la gamme qu ‘il inventa, pour montrer le rapport de ses hexacordes, de ses six lettres et de ses six syllabes avec les cinq tétracordes des Grecs. Il représente cette gamme sous la figure d’une main gauche, sur les doigts de laquelle étaient marqués tous les sons de la gamme, tant par lettres correspondantes, que par les syllabes qu’il y avait jointes, en passant, par la règle des nuances, d’un tétracorde ou d’un doigt à l’autre, selon le lieu où se trouvaient les deux demi-tons de l’octave par le bécarre ou par le, bémol, c’est-à-dire selon que les tétracordes étaient conjoints ou disjoints.
MATRACA (la), énorme crécelle, en usage. en Espagne et surtout au Mexique, pendant la semaine sainte. Elle remplace les cloches. C’est une roue de plusieurs palmes de différence, dont la circonférence est armée de marteaux de bois mobile, de sorte que, en tournant la roue, ces petits marteaux frappent quelques petits morceaux de bois plantés comme des dents dans la circonférence de la roue.
MÉLODICA (la), instrument à clavier, ayant la forme du clavecin avec un jeu de flûte. Ce fut André Stein qui construisit cet instrument à Augsbourg, dans la seconde moitié du dix-huitième siècle.
MELOGRAPHE (le). Nous comprenons sous ce nom les différentes machines construites pour retracer sur le papier les inspirations du compositeur. En 1749, le conseiller de justice Unger inventa, à Einbeek, une machine destinée à être appliquée au clavecin pour noter les improvisations. Le mécanisme de Unger consistait en tringles attachées horizontalement. aux touches du clavier et obliquant vers le centre de l’instrument ; à leur extrémité étaient fixées des tiges verticales portant chacune un crayon destiné à tracer des points ou des lignes plus ou moins allongés sur un papier préparé, qui se déroulait d’un cylindre sur un autre. Ce papier était divisé en lignes, qui correspondaient aux touches ut, mi, sol, si, ré, fa, la, etc. ; les points, ou les traits, allongés, que les crayons marquaient sur ces lignes ou dans les intervalles, correspondaient à toutes les notes de l’échelle chromatique, et la longueur des traits était proportionnelle, à la durée des sons. Le plus léger déplacement du papier sur les cylindres et la difficulté de régler la rotation de ceux-ci causaient beaucoup de désordre dans le placement des signes et dans, leurs dimensions, ce qui rendait illusoire le résultat de cette invention. Elle fut reprise, en 1752, par Hohlfeld (Jean), lequel imagina une machine destinée à être attachée à un clavecin pour écrire les improvisations d’un compositeur. Elle consistait en un mécanisme qui faisait tourner deux cylindres, dont 1’un recevait le papier, qui se déroulait de l’autre pendant l’exécution. Lorsque la machine était fixée à l’instrument, de petits parallelipipèdes de bois se trouvaient au-dessus des sautereaux, de manière, que chacun des sautereaux, en s’élevant par l’abaissement de la touche, faisait lever un de ces parallélipipèdes, qui, au moyen d’un fil d’archal très-fort, poussait un levier de bois, à l’extrémité duquel était attachée une pointe de plomb qui marquait sur le papier la, note jouée, par certains signes de convention que l’on traduisait ensuite. Ces signes correspondaient à chaque touche et marquaient de plus le durée de chaque son. Cette invention, exécutées sur la demande d’Euler, fut soumise à l’Académie en 1752. A la mort de l’auteur cette machine fut achetée par l’Académie, en 1771, et placée dans son cabinet des machines.
Un prêtre anglais, nommé Creed, conçut, en 1747, l’idée d’un moyen propre à retracer sur le papier ce qui s’exécutait sur le piano, qu’il publia dans un mémoire intitulé : A demonstration of Possiblily of making a machine that schall write, ex tempore voluntaris, or orther pieces of music.
Freeke, chirurgien à l’hôpital de Saint-Bartholomée de Londres, à la même époque 1747, réclamant la priorité sur l’idée de Creed, écrivit une lettre adressée au président de la Société royale sur une brochure de feu B-.-M. Creed, concernant une machine Pour écrire ex tempore voluntaries ou tout autre morceau de musique.
Dans l’année 1770, Engramelle, moine augustin, publia la tonnotechnie ou l’Art de noter les cylindres, dans lequel on trouve également un moyen mélographe qui consiste dans un g rand cylindre placé sous le clavecin. Ce cylindre était couvert de papier blanc et recouvert d’un papier noirci, à l’huile ; il avait un clavier correspondants à celui où posaient les mains, en sorte que tout Ce que les mains exécutaient était fidèlement reproduit par le clavier factice, dont les marteaux frappaient le papier noirci, au lieu de frapper sur des cordes. Le cylindre était monté sur des bois à vis, en sorte qu’il avançait continuellement de gauche à droite pendant environ quarante cinq minutes, et reproduisait ainsi sans confusion tout ce qui s’exécutait sur le clavier ordinaire.
En 1770, un mécanicien de Londres, nommé Merlin, construisit un appareil analogue, qui fut vendu au prince de Galitzin et envoyé à Saint-Pétersbourg. Il paraît que l’instrument ne répondit pas à l’attente de l’acquéreur, qui fut forcé d’y renoncer, surtout à cause de la difficulté que l’on éprouvait à traduire les signes de la notation.
M. Gattey publia, en 1783, un mémoire relatif à une machine propre à retracer les compositions des improvisateur au moyen également d’un instrument. muni d’un clavier. Ces tentatives n’en restèrent pas là ; nous les verrons se renouveler encore au dix-neuvième siècle, sans plus de succès.
MERLINE (la), ou petit ORGUE A CYLINDRE, composé d’un petit jeu de flûte aigu, sert à siffler les merles et les bouvreuils. Il est plus fort que celui qu’on emploie pour le serin, parce que la voix des bouvreuils et des merles est plus grave.
MÉTROMÈTRE (le), instrument servant à battre la mesure et les temps de tous les airs, fut inventé, en 1732, par d’Oms-Embray. Il était basé sur les mêmes principes que le chronomètre de Loulié. (Voir Sonomètre.)
MICROSCOME MUSICA. C’est ainsi que se nommait un mécanisme inventé et construit, en 1770, par Triklir, de Dijon, au moyen duquel on pouvait mettre les instruments à cordes à l’abri des variations de l’air.
OCTÉOPHONE (l’), instrument inventé, à Londres, en 1789, par un mécanicien viennois, nommé Vanderburg. On y trouvait un mécanisme pour donner aux sons plus ou moins d’intensité.
OISEAUX MÉLOMANES (les), imaginés et construits par Fritz, de Brunswich, en 1730. Avec le mécanisme ces petits automates chantent plusieurs airs. Nous avons vu Debain, l’ingénieux inventeur de tant d’instruments, reprendre cette idée, il y a quelques années, et construire, par d’autres moyens un oranger garni de fleurs et d’oiseaux, lesquels chantaient, gazouillaient, battaient des ailes ; pendant ce temps, on voyait, entre les feuilles, apparaître un point vert ; puis il grossissait, devenait bouton, s’épanouissait, se renfermait et s’évanouissait.
ORCHESTRION (l’) fut inventé par Antoine Kunz, de Prague, construit par les frères Still. et fini par Gaspard Sthvrid, à la fin du dix-huitième siècle. Cet instrument avait la forme d’un piano organisé, mais dont la caisse était beaucoup plus élevée et renfermait un orchestre complet. On y trouvait deux claviers à main et un clavier de pédales. Le premier clavier, destiné à jouer le mécanisme du piano ordinaire, attaquait les cordes de métal mais ce même clavier pouvait également faire vibrer des cordes de boyau par le moyen d’un archet, mis en mouvement au moyen d’une manivelle. Le second clavier, ainsi que celui des pédales, étaient destinés à l’orgue, qui renfermait quinze registres de huit pieds bouchés, sonnant les seize pieds ; de huit pieds ouverts ; de quatre et deux pieds, qui fournissaient des jeux de flûtes, de clarinettes, de hautbois, de bassons et de cors. Les différents jeux des deux claviers pouvaient être réunis par un accouplement. Ces jeux possédaient le crescendo et le diminuendo.
ORGANO (l’), imaginé par Todini, de Rome, qui fut dix-huit ans occupé à sa construction, fut achevé en 1675 ; mais son mécanisme trop compliqué en rendit 1’usage incommode.
ORCANO (ARCHI), inventé par Vicentino, de Venise, en 1561, sur lequel on pouvait exécuter les trois genres de musique, diatonique, chromatique et enharmonique.
ORGANO-CHORDON, construit, à Stockholm, par Roohwitz, comme le précédent, sur les plans et indications de l’abbé Vogler. On croit que cet instrument n’était qu’un essai de l’Orchestrion.
ORGUE MECANIQUE. Langsaw construisit, en 1745, des cylindres mécaniques qui furent adaptés à un grand orgue. Haendel composa quelques morceaux pour cet instrument, que Langshaw nota sur ses cylindres, qui faisaient leurs révolutions dans divers systèmes de mouvements, et dont la combinaison produisait des effets majestueux.
ORGUE MÉTALLIQUE (l’), instrument inventé, à Londres avant 1789, par Clagget, était composé de fourches d’acier, ressemblant, pour la forme, à nos diapasons modernes, qui étaient mises en vibration par le frottement.
ORPHÉON, instrument de musique monté avec des cordes en boyau, que l’on faisait parler au moyen d’un clavier et d’une roue portant un archet ; il avait la forme d’un très petit piano.
ORPHÉORON (l’), instrument de la famille des luths, était armé de huit cordes de métal.
PANHARMONICO MATHÉMATIQUE. Instrument inventé, en 1711, par Bulyowski, à Durlach, en Hongrie. Il fut présenté à l’empereur Léopold, qui accorda à l’inventeur une riche récompense.
PAVILLON CHINOIS (le,) est un instrument de musique à. percussion. C’est dans sa forme, une espèce de chapeau de laiton terminé en pointe et garni de plusieurs rangs, de clochettes. Le pavillon chinois est fixé sur une tige de fer rentrant dans une coulisse. Celui qui veut en jouer le tient d’une main par cette tige, et lui donne, avec l’autre, un mouvement de rotation sur lui même ; ou bien il le secoue fortement en cadence, de manière que toutes les clochettes frappent ensemble sur la temps fort de la mesure le pavillon chinois, comme son nom l’indique nous vient de la Chine. On l’emploie avec succès dans la musique militaire.
PENTECONTACHORDON (le), instrument imaginé à Naples, en 1618, par Fabio Colonna, fut ainsi nommé parce qu’il avait cinquante cordes inégales. Chaque ton y était divisé en cinq parties égales, pour pouvoir moduler dans les trois genres, diatonique, chromatique, enharmonique. Trois parties faisaient un demi-ton majeur et deux parties un demi-ton mineur.
PIANO A CLAVIER DE PEDALE (le), construit, en 1789, par Bellmann, de Dresde. La note la plus basse de ce clavier, ayant deux octaves, descendait à l’ut de seize pieds, que l’on trouve aujourd’hui dans les pianos à six octaves et demie.
PiANO DOUBLE (le), Hofmann, de Gotha, construisit, en 1779, un piano double où deux claviers se trouvaient placés à chaque extrémité pour être joué par deux personnes. Ces quatre claviers pouvaient être également assemblés pour n’être joués que par un seul exécutant.
PiANO A DOUBLE CLAVIER. Buhler imagina et construisit à Bayhingen dans le Wurtemberg, en 1786, un instrument simple ayant seulement deux claviers superposés.
PIANO MÉCANIQUE (le), inventé à Mayence, en 1786, par Milchmayer, possédait trois claviers produisant jusqu’à deux cent cinquante variétés de sonorité ; on pouvait également diviser cet instrument eu plusieurs parties, pour qu’il pût être joué par plusieurs personnes à la fois.
POLY-TONI-CLAUCORDUM (le) était un instrument à peu près dans le même genre que la Mélodica (voir ce mot) ; il fut construit pat Stein, d’Augsbourg, en 1760. On peut en voir la description dans la Gazelle d’Augsbourg de l’année 1788.
RHYTHMOMÈTRE (le) fut inventé, à Paris, en 1782, par Duclos, horloger. Cette machine était destinée à indiquer la division des temps de la musique ; elle fut approuvée par les professeurs de l’Ecole Royale de Chant, et Gossec, directeur de cet établissement, fit sur elle un rapport favorable, (Voir Sonomètre.)
SERINETTE (la) est un très-petit orgue à cylindre qui joue des airs sans aucun accompagnement et qui sert à l’éducation musicale des oiseaux, et particulièrement des serins.
SONOMÈTRE. Loulié, musicien au service de mademoiselle de Guise, imagina, en 1699, un instrument, nommé sonomètre, pour mesurer le temps dans la musique. Il se composait d’un tableau gradué de un à soixante-douze degrés de vitesse, avec un pendule mobile, composé d’une boule de plomb suspendue à. un cordonnet, pouvant s’allonger ou se raccourcir à volonté, et que l’on plaçait dans les trous correspondants à toutes les divisions de l’échelle.
En 1701, Sauveur produisit son Echomètre. (Voir ce mot.)
En 1732, d’Oms-Embray construisit un instrument à mesurer le temps. (Voir Métromètre.)
Harisson, mécanicien anglais, chercha à obtenir le même résultat, en 1775, au moyen d’un monocorde de son invention, dont il donna la description, sous le titre de Mécanisme propre à parvenir à une mesure exacte et vraie du temps.
Davaux publia, en 1784, deux lettres sur un instrument ou pendule nouveau, qui avait pour but de déterminer, avec la plus grande exactitude, les différents degrés de vitesse, etc.
Burja, professeur de mathématiques à Berlin, donna, en 1790, la description d’un nouveau chronomètre, sous le titre de Beschreibung, eines musicalischen zeitmessers.
En 1782, Duclos, horloger, produisit également un instrument ayant le même but. (Voir Rhythmomètre.)
SOURDINE (la). Lebrun, corniste, -imagina, en 1786, une sourdine pour son instrument, composée d’un cône de carton, ouvert à son sommet et percé d’un trou à sa base, qu’il introduisait dans le pavillon du cor ; il tirait de cette sourdine quelques beaux effets dans les adagio.
STAHLSPIELS (le), instrument à clavier, composé de lames d’acier mises en vibration par le frottement, inventé à Torgau, ou 1780, par Lingko
TÉLIOCHORDE (le), instrument à clavier, imaginé à Londres, en 1775, par Clagget ; il était accordé sans aucune considération de tempérament, et les différences enharmoniques se faisaient sentir au moyen d’une pédale.
THÉORBE,CLAVECIN (le), inventé par Jean- Christophe Fleischer, vers l’année 1700, était un instrument à clavier, ayant trois registres, dont deux de cordes à boyau et le troisième de cordes d’acier.
XYLORGANON (le). Espèce de claquebois avec une touche. Il est aussi appelé xitarganon.
Voilà tous les instruments que nous avons rencontrés ; il en existait sans doute beaucoup d’autres, mais leurs noms ne nous sont pas parvenus. On peut remarquer, par la lecture de cette nombreuse nomenclature, l’absence d’un véritable instrument, tel que nous. l’avons défini au commencement de ce chapitre. On voit, en, effet, tous les facteurs, ne cherchant pas à créer une voix nouvelle, mais s’efforçant d’imiter, par des moyens plus ou moins ingénieux, des instruments déjà connus, et d’un emploi beaucoup plus simple, dans leur nature qu’avec le mécanisme de leur imitation.
Nous croyons ne pas devoir cacher à nos lecteurs les sources où nous avons puisé, et nous nous faisons un devoir de leur indiquer les principaux ouvrages où ils pourront trouver des renseignements utiles à leurs recherches sur les divers instruments de l’antiquité et du moyen âge.
ADELUNG., Musica Mechanica organ.,.. (Berlin, 1768).
AGRICOLA (Martin), Musica instrumentalis deudsch (Wittemberg, 1529).
ARBEAU-THOINOT, Orchésographie (Langres, 1589).
AVERRANUS, Dissertation sur l’antologie.
- Dissertation sur Thucydide.
BACCHINI, de Sistris eorumque figuris (1696).
BARTHOLONI, de Tibiis veterum eorumque antiquo usu (Roma, 1677).
BEDOS DE CELLLES (don), l’Art du facteur d’orgues (1766 –1778).
BERMUDO (Juan), Libro de la declaration de instrumentas (Granad, 1555).
BIANCHINI, De tribus generibus instrumentorum musicoe veteris organicœ (Roma, 1742).
BOILEAU (Estienne), Etablissement des métiers de Paris.
BONAMI, Gabinetto armonico pieno d’instromenti sonori (Roma, 1722)
BOSSIUS, Libella de sistris (Médiol, 1612).
BOTTÉE DE TOULMONT, Dissertation sur les instruments de musique au moyen âge (Paris, 1838).
BRODEUS, Miscellanea (Bâle, 1585).
BROSSARD, Dictionnaire de musique (1730).
CALMET (don), Dissertation sur la musique des Hébreux (Amsterdam, 1723).
CARRÉ, Théorie générale du son et sur le monocorde (Histoire de l’Académie des Sciences, 1704).
CAUX.(Salomon) les Raisons des forces mouvantes, avec diverses machines (Francfort, 1615).
CHALDNI, Traité d’acoustique (Paris, 1810).
COUSSEMAKER, Essai sur les instruments du moyen âge,
DACIER (madame), Remarques sur Térence.
DESIDERI, Discorso della musica (Bologne, 1671).
DONI (Œuvres de) (Florence, 1743).
Du CANGE, Gloss. ad scrip. med., et inf. œtat. (1778)
ELI.IS, Traité sur les cymbales (Rotterdam, 1727).
ENGRAMEL, la Tonotechnie (1775).
FÉTIS, Revue musicale (1826).
- Musique mise à la portée des gens du monde (Paris, 1830).
- Antoine STRADIVARI (Paris, 1856).
FORKEL, Allgem. Geschichte des musik (Leipsick, 1792).
FRANCOEUR, Diapason général de tous les instruments à vent, avec des observations sur chacun d’eux (1772)
ABLER (Math.), Ab-handlung von, Instumental ton (lnglostadt, 1776).
GALLAND, -Dissertation sur l’origine et l’usage de la trompette chez les anciens (Mémoires de l’Académie).
CERRBERT, De Gantu et Musica sacrâ (San-Blasianis, 1784).
GERSON (J.), Tractatus de cantis, opera omnia (Anvers, 1706).
GRAETANUS, De Proprietatibus rerum (1448). -
ISIDOR De SEVILLE, EtymOlogie (1577).
JABLONSKI, Allgemeine Lexikon de Künste and Wissen chafften.
JONES, Musical and poettical relicks of the Welch bards (Londres, 1786).
KASTNER, la harpe d’Eole (Paris, 1856).
- Dissertation sur les danses des morts (Paris, 1852).
- Manuel général de musique militaire (Paris, 1848).
- Méthode complète et raisonnée de timbales.
KIRCHER, Musurgia (Roma, 1650).
KIRNBERGER, le Compositeur de menuets et de polonaises (1757).
LABORDE, Essai sur la musique ancienne et moderne (1782) (figures souvent inexactes).
LA CHAUSSEE, Museum romanum JJ. (Roma, 1690).
LAMPE, De Cymbalis veterum (Brem, 1700).
LAURENTIUS, Gronovii Thesaurus (tome 8),
LICHTENTAHL, Dictionnaire de musique (1839).
LUSCINUS, OTTOMARUS OU NACHTGALL, Musurgia (Argentan, 1536)
LUDWIG, Reliquiœ manuscript. omnis moedi oevi.
MAGUIS, Miscellanea (1564).
MAGIUS, de Tintinnabulis (Amsterdam, 1664).
MANUTIUS, de Tibiis vetorum (Soral, 1641).
MATHESON, Premier Orchestre (Hambourg, 1713).
MAUPERTUIS, Mémoire sur la forme des instruments (1724).
MEISTER, de veterum Hydraulo (Mémoires de la Société Royale des Sciences (Goëttingue, 1771.
MÉNAGE, Dictionnaire étymologique (Paris, 1694.)
MERSENNE, -Harmonica (1655).
MILLIN, Dictionnaire des Beaux-Arts (1806).
MOLINEUX, Letter containing some thoughts concernng the ancient greek and roman lyre (1702).
MONTFAUCON, Antiquité dévoilée (Paris, 1719).
PAULLINUS, Rerum et Antiquitatum germanicorum. (Francfort,1698).
PIGNORUS, De servis et eorum apud veteres ministeriis (Amsterdam), 1674).
PRAETORIUS (Mich.), Syntagmatis musici. De Organographia (1618)
ROA (de), Singular. s. script.
ROESER, Essai sur l’instruction à l’usage de ceux qui composent pour la clarinette, et les cors (1781).
SAVART, Recherches sur les usages de la membrane du tympan et de l’oreille externe (Mémoires de l’Académie des Sciences, Paris, 1824)..
- Sur la voix humaine (Paris, 1825).
SCALICHIUS, Miscell. de rerum causis (Cob, 1570).
SIBIRE (l’abbé), la Chélonomie (1806).
SPON, Dissertation sur les cymbales crotales, etc., des anciens (Lyon, 1683)
SPONSEL, Orgel historie (Nuremberg, 1791).
STEWECHIUS, comment. in.Fl. Vegelium de re militari (Antwerp., 1585)
VENCE, Dissertation sur la musique des Hébreux.
VILLOTEAU, Mémoires sur la musique des Egyptiens. (Description de l’Égypte.)
VINCENT DE BEAUVAIS, le Miroir historial (Strasbourg, 1473).
VIRDUNG, Musica dedusch und ausgezogen durch (Strasbourg, 1511)
WALKER, Hist. men. of Irish bards (Londres, 1786).
YOUNG, An Enquiry into the principal Phaenomen of sounds and musical strings (London, 1784).
ZULLERMANN, de Tibiis et corum usu in bello.
ZORN, Commentat. de usu œror. tripod et cymbalorum in sacris Græcorum (Kil, 1715).
Deleneatio tractatus de cymbalis veterum (Brême, 1700).
Observations sur la flûte et la lyre des anciens (Paris, 1726).
De instruments musicis, Dissertatio (Upsal. 1717).
Nous voici arrivé à 1789 ; ici finit notre première partie. A cette époque, il y a halte forcée pour la facture instrumentale ; la musique se tait pour faire place aux hurlements de la tourbe qui se précipite sur Versailles. Bientôt on n’entendra, en fait d’instruments, que les cris du peuple courant aux armes ; que le canon faisant frémir les vitres de la cité ; que le sombre bruit des charrettes entraînant les condamnés à l’échafaud ; que le roulement éclatant du tambour couvrant les dernières paroles de la Royale victime. A cette époque malheureuse, où l’honneur était partout et le bonheur nulle part, le facteur avait déposé son tablier de travail pour endosser l’uniforme de garde national, et, dans ses mains, le fusil avait remplacé le rabot.
FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.
TABLE DES MATIERES
DU PREMIER VOLUME.
PREMIERE PARTIE
DÉDICACE...................................Page III
PREFACE.......................................Page V
CHAPITRE PREMIER.
INTRODUCTION. - Méprise sur les véritables conditions de la prospérité des peuples. -Expansion des sciences, de l’industrie et des arts.- l’artisans du laisser-faire. - Accroissement du bien-être et élévation progressive des classes laborieuses. - Prestige des noms des Médicis. Physionomie de Louis XIV dans la postérité. - Napoléon 1er , la plus imposante des figures des temps modernes. - Encouragement donnés aux sciences et aux arts par ce monarque. - La force et la stabilité des gouvernements sont en raison directe du mouvement imprimé à l’industrie et aux arts. -Forces intellectuelles et physiques des sociétés. - Enchaînement de l’organisation sociale. - Protection due par l’autorité à l’industrie et aux arts. - Encouragements dus par l’Etat aux industries prospères et florissantes, ainsi qu’à toute industrie faible et inférieure. Changement de rôle d’une nation par suite des perfectionnements successifs apportés dans telle ou telle branche do travail. -Puissance de l’industrie. - Les hommes les plus célèbres sont en même temps les plus pieux. - Naissance de la musique dans les Eglises. - Le jury accorde à la facture instrumentale des récompenses égales à celles données aux autres branches de l’industrie ; étonnement de plusieurs personnes à cet égard. - Peinture mise, à tort, au-dessus de la musique. - L’inventeur d’un bon instrument est-il au-dessous de celui qui sait en faire usage ? - Question d’art jointe à la question industrielle. - Gouvernement de Napoléon 1er , imité par Napoléon III. - Action tutélaire comprise par ce dernier souverain. - Rôle civilisateur de la musique. - Puissants protecteurs de la musique, depuis la Renaissance, en Italie, et en Allemagne, - Enseignement de la musique dans toutes les écoles. - Facture instrumentale, auxiliaire indispensable de la musique. - Extension rapide de la facture des instruments. - Production active d’instruments pour l’instruction de la musique. - La qualité des instruments doit suivre le niveau du mouvement progressif de la consommation. - Infériorité de la France,
comparée a l’Angleterre, dans la facture de certaines familles d’instruments....... 11
CHAPITRE II.
Utilité générale des beaux-arts. - Incertitude Sur leur origine. - Antiquité de la musique, première de toutes les sciences. - Musique, Première langue et universelle. - Vénération pour la musique dans l’antiquité. - Inexactitude dans les documents consultés attribuée aux écrivains, aux poëtes, aux peintres, aux sculpteurs et aux statutaires. - Prætorius. - Données incomplètes. - Contresens -inévitables commis par les poëtes. - Citation de M Kastner. - Recherches fructueuses et infructueuses. - Sons produits. par la nature. - Ascendant impérieux de la musique sur l’homme. - Description de la musique. Appréciation du son. -Gravité ou acuité du son dépendant du nombre des vibrations. - Fréquence des vibrations dans les instruments à cordes. - formation de l’octave aiguë. - Mise en mouvement d’un corps par le son. - Sensation causée par l’harmonie et la mélodie. - Modifications des organes dans les passions violentes. - Retour à leurs dimensions naturelles. - Accent, cris et gestes ; langage primitif, de l’homme. - Développement chez l’homme en société de passions inconnues à l’homme de la nature. - Ambition de l’homme non satisfaite. - premiers autels élevés à la reconnaissance par les sociétés encore dans l’enfance. - Actions héroïques embellies par la musique à sa naissance.- Premières idée de la flûte ou du chalumeau. - Incertitudes sur les premières inventions. - Sons réglés sur les dimensions des corps sonores. - Echelle des peuples musiciens. - Décomposition du chant naturel. - Recherche de notre échelle dans la nature. - Division des sons et formation des intervalles dans la dimension des premiers instruments. - Chaque peuple a sa musique. - Chant véritable des oiseaux, des animaux. - Instrument imitant le ramage du rossignol. - Résistance de la musique à l’expression qu’on lui attribue. - Lois fixes de la musique. - Voix humaine considérée comme l’instrument le plus parfait. - Développement des premiers éléments de la musique instrumentale chez le peuple égyptien. - Emploi par les égyptiens de flûtes de différentes espèces. - Complication du système instrumental des Hébreux. - Mercure, inventeur de la lyre. - Division du peuple en classes ou centuries. - Emploi d’instruments au milieu des festin des anciens. Institution de prix pour la musique. - Musique pendant les repas. - Proscription de la musique instrumentale dans les premiers siècles du christianisme.- Premiers rois de France sensibles aux charme de la musique. – Introduction du chant à plusieurs voix dans l’Église romaine. - Principes de l’art et premiers rudiments de la langue musicale apportés d’Italie. - Goût de la musique répandu dans la société civile. - Ennui des barons féodaux durant la paix. – Multiplication des Ménestrels et des Jongleurs. - Corporation des Écoles de Paris. - Bannissement des Ménestrels jusqu’à saint Louis. - Ménestrels portés au nombre des officiers de Philippe le Hardi. - Progrès de la musique instrumentale, dans la vie civile et religieuse. - Grande faveur, dès le treizième siècle, de la musique instrumentale. - Révolution de la musique instrumentale au commencement du quinzième siècle. - Notables progrès de la musique en Italie. - Concerts moins monotones que ceux d’aujourd’hui. Progrès incontestable dans les formes de l’art. - Invention de la composition à plusieurs parties. - Révolution dans l’état de la musique. - Musiciens de François 1er , presque tous joueurs de hautbois. - Savantes compositions de l’école flamande. - Art de combiner les ressources de la voix et celles des instruments, enseigné par des compositeurs français et allemands, - Ere de la renaissance de l’art musical sous François 1er . - Musique instrumentale jetée dans un moule nouveau par Pierre Aloïs da Palestrina. - Pièces cuivreuses du compositeur Clément Jannequin. - Construction de trente-huit instruments par ordre de Charles IX. – Organisation, en Italie, de sociétés musicales, d’académies d’instruments et de chant. - Renaissance de la musique instrumentale due à la création de Conservatoires fondés en Italie.- Etablissement de Conservatoires à Naples et à Venise. -Goût de la musique de plus en plus répandu. - Régénération du Théorbe. - Construction du violon ne remontant qu’au seizième siècle. - Brillant éclat du violon en Italie. - Archangelo Corelli, un des premiers violonistes de l’Italie. - L’instrument de Torelli rivalisant avec celui de Corelli. - Harmonies de l’orgue jusqu’alors inconnues. - Progrès de la musique en France, malgré les désordres politiques. - Remplacement du contre-point au théâtre par le récitatif. - Premiers progrès de l’harmonie dus à Monteverde. - Madrigal musical cultivé avec succès en Italie, en Flandre et en Angleterre. - Nouvelles formes données à la musique dramatique par Monteverde. - Les ballets ne sont assujettis à aucune règle dramatique. Progrès de la musique dus principalement au théâtre. - Grande vogue de la Pastorale de Cambert. - Réorganisation de la musique de Louis XIV confiée à Lulli. - Désunion entre les associés de l’Académie de musique dirigée par l’abbé Périn. - Lettres patentes de Louis XIV nommant Lulli surintendant et compositeur de musique de sa chambre. - Lulli, fondateur de notre première scène lyrique., - Forme nouvelle prise par la musique dans les symphonies du dix-septième siècle. - Distinction particulière des symphonies de Lulli, considéré comme compositeur. - Progrès de la musique instrumentale. - Musiciens gagés par Louis XIV. Musique de la Chapelle, - Musique de la Chambre. - Musique instrumentale. - Grande -bande des vingt-quatre violons. -Musique de l’Écurie pour fêtes et tournois. – Disparition, sous Louis XV, de la petite bande créée par Lulli. - Corporation des musiciens, dite des Ménétriers. - Inhabileté des membres de l’orchestre de l’Opéra. – Commencement de faveur accordée aux duos de chambre. - Stagnation, sous la Régence, de la musique religieuse et théâtrale. - Déchaînement des partisans de Lulli contre Rameau. - Arrivée à Paris d’une troupe de chanteurs italiens. - Duni, compositeur de l’un des premiers opéras comiques français. - Mouvement vers le perfectionnement déjà imprimé lors de la visite de Grétry, à Paris. - Progrès de l’opéra comique. - Troisième voyage de Mozart à Paris. Première symphonie de Mozart pour l’ouverture du Concert spirituel - Lettre à ce sujet. - Succès obtenus par Gluck avec Orphée et Alceste. - Fondation d’un prix pour le meilleur opéra. - Faiblesse du style de la musique d’église. - Nouveau développement de la musique instrumentale. Gossec, organisateur du Concert des Amateurs. - Bons organistes comptés parmi les musiciens français - Place honorable tenue par les violonistes de l’école française. - Aridité de la musique instrumentale. - Développement de la musique concertante. - Fixation du quatuor par Boccherini. - Perfectionnement de la symphonie par Haydn et Beethoven. - Situation de la musique dramatique........................26
CHAPITRE III
Importance de la musique militaire. - Musique, puissant moyen d’action sur les sentiments humains. - Joueurs de flûte et de trompette placés à la tète des troupes des Grecs. - Origine probable de la musique militaire. Enthousiasme guerrier secondé par la puissance de la musique. Pouvoir du rhythme sur les soldats. - Usage de placer des musiciens en tète des troupes. - Grande extension des musiques militaires en Europe. - Usage, au seizième siècle, des instruments à cordes pour les musiques militaires. - Ouverture de la tranches du siège de Lérida en 1647, par le régiment de Champagne précédé de vingt-quatre violons, du prince de Condé. - Emprunts faits à des milices étrangères par les musiques des régiments français. - Reproche de J.-J. Rousseau aux chefs de musique de son époque. - Adoption par les Gaulois des instruments de guerre des Romains. - Clairons de la chevalerie française. - Trompes et trompettes, instruments des fantassins. - Silence sur la musique militaire vocale. - Cloche montée, sur une espèce de châssis et transportée par un chariot. - Cymbales importées, dans le huitième siècle, par les Maures. - Intervention des Ménétriers dans les entrées triomphales des souverains, des seigneurs et des chevaliers. - Introduction, sous François 1er, du fifre dans la musique française. - Manière de battre du tambour et de jouer du fifre, enseignée par Thoinot Arbeau. – Hautbois joint au tambour et au tambourin pour faire danser. – Compagnies des Gardes du Corps, sous Louis XIV, avec Trompettes et timbalier. - Tambours et hautbois des dragons. - Conque des fusiliers des montagnes opposés aux miquelets espagnols. - Véritable importance de la musique militaire sous Louis XIV. - Ordonnance réglant les différentes batterie de tambour de l’infanterie. - Fort petit nombre de marches possédées par les Français. - Ordonnance consacrant, en style noté, les batteries de caisse et leur partie musicale pour fifres et hautbois. - Adoption de plusieurs instruments nouveaux. - Adjonction d’une flûte ou deux trompettes, un contre-basson ou serpent à la musique militaire allemande. - Genre de musique particulier à la Russie. - Sarti, compositeur italien, chargé d’organiser la musique de Catherine de Russie. - Existence légale, dans les Gardes Françaises, des instruments de cuivre, à anches et à clefs. - Vie nouvelle de la musique militaire. – Savant mémoire de M. Kastner sur ce sujet.......... 93
CHAPITRE IV.
Fille de la musique, la facture instrumentale a eu part à ses tâtonnements, à ses haltes comme à ses progrès. - Vie errante de la musique. Elle n’est d’abord qu’un métier. - Ecoles fondées pour étudier la musique. - Instruments devenus accessibles à tout le monde, grâce à la liberté du travail. - Faculté de travailler non limitée dans les premiers siècles de la monarchie. - Maîtrises, établies aux premiers temps de la féodalité. - Faiseurs d’instruments du moyen âge, appartenant à plusieurs corporations. - Organisation du métier de fabricant d’instruments de cuivre. - Encouragements donnés aux arts et à l’industrie par saint Louis. - Lettres patentes de Henri II, autorisant à délivrer, sans chef-d’œuvre ni finance, des lettres de maîtrise à tout compagnon ayant enseigne un art ou un métier aux enfants des hôpitaux. - Communautés des arts ou métiers. considérées comme un moyen d’impôt ou d’emprunt. - Luthiers français constitués en corps par lettres patentes de Henri IV. - Création des offices de jurés avec survivance, aliénables moyennant une certaine somme. - Arrêt ordonnant que tous les facteurs d’orgues, faiseurs de hautbois, flûtes et tout autre instrument de musique de Paris resteront réunis en un seul corps de maîtrise et jurande. - Communautés existantes ajoutées à d’autres communautés. multiplication de la création des offices. - Offices vendus aux corporations. - Paiement, outre le droit de maîtrise, des droits de confirmation et de joyeux avènement. - Les tabletiers font saisir des fifres et des flageolets. - Administration de la communauté très dispendieuse. - Charge de juré obtenue après l’admission au grade d’ancien. - Apprentissage soumis à des formalités et à des rétributions réglées. - Fils de maîtres exempts d’apprentissage. - Grandes distinctions établies entre les aspirant à la maîtrise, les fils de jurés, les anciens maîtres, etc. - Noms des luthiers maîtres-jurés-complables. - Irrégularité dans la tenue des comptes de la corporation des luthiers-facteurs. - Pièce constatant le nombre de facteurs d’instrumenta à vent. - Situation faite à la facture instrumentale jusqu’à l’édit de 1776. – Détresse pécuniaire de la corporation des faiseurs d’instruments. - Energie de ladite corporation pour soutenir ses droits. - Situation des, communautés jusqu’à 1776. - Préambule de l’édit supprimant les corporations. - Edit accordant à toute personne la liberté d’exercer l’industrie qui lui plaît. Les vieux abus trouvent toujours des défenseurs. - Luthiers attachés à la maison du Roi. - Fabrication d’instruments dans les faubourgs. Ouvriers passés maîtres après dix ans d’aggrégation. - Nullité des progrès de la facture avec les corporations. Entraves pour parvenir là la maîtrise, presque inaccessible aux pauvres. - Sévérité des prescriptions des statuts. - Derniers signes d’existence de la corporation des luthiers. - Liberté industrielle sous Necker.
CHAPITRE V.
Coup d’œil rétrospectif sur les instrumentistes. - La musique interprète les sentiments religieux, avant de servir aux amusements des hommes et leurs plaisirs intellectuels. - Humanité consolée en tous temps et en tous lieux par les chants. - Union intime de la musique et de la poésie. - Mœurs et luxe des Romains florissant dans la gaule. Barde, musicien parasite. - Vieux Bardes gaulois remplacés, dans Lutèce, par le Collège des instrumentistes. - Distinction de ce Collège avec toutes les autres sociétés. - Musiciens des temples, des demeures particulières, des places publiques, fournis par le Collège des Joueurs d’instruments soumis à une règle, à une tradition. - Retraite des joueurs de flûte à Tibur. - Commencement, apogée et décadence du Collège des instrumentistes. - Profession précaire des musiciens durant plusieurs siècles. - Joug de la domination dos Romains secoué par la Gaule. - Traces de la musique des Bardes. - Livres, d’Aristide Quintilien répandus dans les Gaules. Tableau des principales divisions de la musique établies par ce maître et enseignées dans les écoles. - Connaissance de l’harmonie simple et figurée par les Grecs, - Célébrité des musiciens Sacados et Clonas dans ces sortes de compositions. - Mélodies et harmonie des Grecs empruntées par les Romains. - Corruption de l’harmonie au temps de Platon. - Proscription, par Calvin, de la musique comme une invention infernale. - Quelques traces du bardisme gaulois. – Fondation, au cinquième siècle, des monastères. - Ils servent de refuge à la musique. - Fuite des Bardes devant l’épée de César. - Bardes devenus Jongleurs. - Récit du poëte Gaimar -sur un jongleur normand, nommé Taillefer. - Jongleurs guerriers attachés à la personne des princes. - Chansons de geste écrites par les Troubadours. - Confusion, sous le titre de trouvères, de deux, classes bien ;distinctes. - Lois portées contre les jongleurs par les Conciles. - Plusieurs genres de poésie chantés par les jongleurs. - Talents physiques, Connaissances et instruments possédés par un trouvère-jongleur. - Querelle entre deux de ces hommes, - Trouvères et ménestrels, presque tous jongleurs,. joueurs d’instruments ou chanteurs. - Jongleurs et ménestrels, sous saint Louis, soumis à un règlement de police. Position honorable et lucrative des ménestrels à la cour. – Création d’un corps de musique dans le palais de Jacques II, roi de Maïorque. Instruments des jongleurs ou des ménétriers. - Nom nouveau posé à coté de celui de jongleur. - Projet de règlement présenté au Prévôt de Paris par trente-sept jongleurs et jongleresses. - Premiers membres de cette association. - Métier de ménétrier peu productif. - Chef de la société et jurés élus chaque année par tous les intéressés. - Fondation d’un hospice par les musiciens réunis en communauté. -Titre de Roi donné au chef des instrumentistes.- Première charte faisant connaître un Roi des ménestrels. - Célébration d’une fête par la corporation des ménétriers. - Poëte de cour remplacé par le chanteur des rues. - Introduction de la grande chanson politique et historique. Approbation, sous Charles VI, des statuts des ménétriers. - Confirmation successive de ces statuts par Charles VII, Louis XI. Charles VIII, Louis XII, François 1er , Henri III. - Titre de Roi des ménétriers confirmé, par lettres patentes. - Les musiciens de province organisés en corporations. - Révolution dans la musique au milieu du quinzième siècle. - Gens de grand talent parmi les ménétriers. - Importance de plus en plus grande de la corporation. - Réunion des ménétriers, la nuit, pour exécuter des sérénades. - Récit fait à ce sujet par Michel Henry. - Intervention du parlement pour défendre ces promenades trop multipliées. - Musiciens de la grande bande, reçus maîtres sur la simple présentation de leur brevet de nomination dans la bande. - Arrêt du parlement, portant défense à tous ménétriers non reçus maîtres de jouer d’autres violons que le rebec. - Lettres patentes portant établissement d’une académie de danse, et art de la danse exempt de toute maîtrise. - Opposition de Dumanoir 1er , roi des ménétriers, à l’enregistrement de ces lettres patentes. - Long procès où chaque partie intéressée produit de nombreux mémoires. – Par des mises hors de cour et de procès par arrêt du parlement. - Coup d’éclat de Dumanoir II. - Désastres de la corporation des ménétriers. Nouveaux échecs de cette corporation. - Offre de rachat, par la communauté de Saint-Julien, des offices des nouveaux jurés et trésorier. - Preuve de capacité comme instrumentiste et comme danseur exigées pour être maître. - Jean-Pierre Guignon émule des plus fameux violons du siècle, devenu son chef. - L’apprentissage fixé à un certain nombre d’années considéré par ce nouveau roi comme n’étant plus de ce siècle et dégradant pour les arts libéraux. - Tolérance de certains instrumentistes populaires. - Somme distribuée aux maîtres pauvres à chaque réception - Suppression des charges des vingt-quatre violons de la grande bande. - Nouvelle confirmation des privilèges accordés à l’Académie Royale de Musique. Création en province des charges de lieutenants du roi des violons. - Abdication de Guignon. - Noms des divers rois de la communauté mentionnés dans l’histoire. - Les hommes voués au culte de la musique forment deux catégories. - Musique, représentée aujourd’hui par cinq classes de musiciens. - Relevé de la population des garnis existant, en 1848, dans les douze arrondissements de Paris, établissant qu’il s’y trouve peu de gens appartenant à la musique, soit comme exécutants, soit comme ouvriers. - Association des Artistes-Musiciens, fondée par le baron Taylor. - Défense des droits de tout sociétaire par le comité, lorsqu’il reconnaît la moralité de la cause. - Conseil médical attaché l’association. - Comité central composé de soixante membres divisés en quatre commissions. - Organisation de comités dans plusieurs villes de la province. - Nombre des sociétaires à Paris, dans les départements et à l’étranger. - Recettes de l’association.,- Répartition des secours entre les pensionnaires. - Etablissement d’un registre de demandes d’emplois et de demandes d’artistes. - Utilité de cette association prouvée par des faits. - Adoption de trois orphelins par le comité. - Noms des hommes de bien qui, les premiers, se sont joints à M. le baron Taylor. - Composition des orchestres des vingt-cinq théâtres de Paris en 1828. - Nombre de bals, tant particuliers que publics, donnés chaque année dans cette capitale............................. 133
CHAPITRE VI.
Travaux divers de la facture instrumentale : l’Ouïe et la Voix. Chefs-d’œuvre de la création, étudiés sans cesse par le facteur.- Parole, poésie, musique perçus par l’organe de l’ouïe. - Etymologie. - Puissance et réalité d’un Créateur suprême. - Remarquable analogie de fonctions de l’organe de l’ouïe avec les yeux. - Attention beaucoup plus grande d’un de ces organes en l’absence de l’autre. - Aperçu de la construction anatomique de l’oreille. - Sympathie entre les organes de l’ouïe. - Sens de quelques animaux plus parfaits, à certains égards, que ceux de l’homme. - Oreille de I’homme sauvage plus fine que celle de l’homme civilisé. - Appareil extérieur construit par la nature. - Description de la caisse du tambour. - Ebranlements communiqués au marteau et à l’enclume par la membrane du tympan, - Orifices des trois canaux demi-circulaires. - Place du limaçon dans la partie antérieure du rocher. - Division du limaçon. -Vie et sentiment de l’oreille. -Positions des nerfs de l’oreille. - Ondes sonores de l’air tombant sur l’oreille. - Manifestation de la puissance. du Créateur dans la structure de l’oreille. - Description du nerf. - Secousses élastiques de l’air arrivant aux nerfs auditifs.. - Distinction des sons occasionnés par l’ébranlement du nerf acoustique. – Etendue de la sympathie de l’oreille d’après des naturalistes. - Grandeur de l’oreille ne faisant rien à sa bonté. - Description de la voix, par Charles Nodier. - Pomme d’Adam, principal organe de la voix. - Délicatesse, justesse et promptitude des mouvements produisant la musique. - Division de l’octave en trois cent une parties. - Confusion des sons par l’imagination, distingués par la nature. - Instruments à vent, les plus propres à harmonie, non comparables à la voix. - Manière dont se forme la voix. - Mesure de la voix déterminée par la quantité d’air poussée par les poumons. - Voix aiguë des femmes. - Différence peu marquée entre les tons aigus et graves. - Différence de la parole dans la prononciation des lettres. - Difficulté d’assigner la cause de la diversité des tons.......................... 183
CHAPITRE VII.
Idée des produits de la facture instrumentale des âges précédents. Partage de ces instruments en cinq grandes divisions. - Grand nombre de noms d’instruments appliqués au même instrument. - Appellations diverses des grandes familles d’instruments. - INSTRUMENTS A VENT ; leur composition. - Les instruments à vent, sont, à l’exception des crotales, les premiers instruments dont l’homme ait fait usage. Classification adoptée pour les instruments à vent. Première famille composée de deux sections.- Instruments à anche simple.- Flûte, un des plus anciens instruments. – Distinction, chez les anciens, de plusieurs flûtes. - Très-grande simplicité de la flûte dans les premiers temps. Flûte, dans son enfance, faite de roseaux. - Importation et non invention de la flûte chez les anciens Grecs. - Flûte simple, peu estimée. -Flûtes doubles, jouées chacune d’une main. - Flûtes doubles, garnies de chevilles dans la partie. supérieure. - Flûte longue et droite, la plus ancienne des flûtes. - Flûte à six trous, nommée arigot au seizième siècle. -Flûte traversière, moins populaire que la flûte droite. - Seconde clef ajoutée par Quantz à la flûte. - Flûte à trois clefs, formant une famille entière. - Flûte de Pan, instrument dont l’invention se perd dans la nuit des temps. - Perfectionnement de l’ancien chalumeau allemand. - Naissance de la clarinette. - Cor de basset, doux et sombre à la fois..- Instruments à vent à anche double. - Description du chalumeau. - Hautbois semblable au chalumeau, à l’exception de la dimension, du nombre de clefs et de trous. - Quatre sortes de hautbois. Améliorations du hautbois au dix-septième siècle. - Hautbois et gros bois, instruments employés aux seizième et dix-septième siècle. - Instruments en forme de crosse, nommée cromornes ou tournebouts. Basson, ainsi nommé à cause de la douceur de son timbre. - Cor anglais, hautbois d’une dimension plus grande. - Instruments à vent avec bocaux. - Cor et trompette, famille d’instruments d’une origine aussi ancienne que la flûte. - Invention, d’après Athénée, de la trompette et du cor par les Tyrhénéens. - Préjugé défavorable à la trompette dans certaines parties de l’Egypte. - Trompettes employées par les Israélites dans la guerre et dans les fêtes. - Invention de ces instruments due au hasard. - La corne remplacée par l’ivoire. - Description de différents instruments, le cor, l’oliphant, le huchet, le menuel, le graiste. -. Bois tantôt courbés, tantôt droits, employés pour ces instruments. - Cors ou cornets, percés de trous comme les flûtes et les hautbois, formant la famille des cornets à bouquin. - Bois de cormier, prunier ou autre, employé pour leur fabrication. Buccine faite en différentes matières. - Trompes et trompettes composées, dans l’origine, d’un simple tube droit. - Tube, ordinairement de métal, quelquefois en bois. - Incommodité des longues trompettes droites. - Clairon, espèce de trompette d’un son plus mordant que la trompette ordinaire. INSTRUMENTS A VENT, AVEC RÉSERVOIR D’AIR. – Instruments avec réservoir d’air sans clavier. - Cornemuse simple ou composées Cornemuse, désignée par Varron sous le nom du pythaules, et sous celui de chorus par M. Kastner. - Légère différence entre la cornemuse, la musette, la sourdeline et la zampogne. - Cornemuse d’origine celtique. Apparition, sous Louis XIV, de la musette dans les concerts de la cour. - Instruments à vent, avec réservoir d’air et avec clavier. - Orgue, le plus riche, le plus complet à le plus puissant des instruments. – Très petit nombre de tuyaux de l’orgue dans les premiers temps. - Orgue pneumatique donné en présent, en 754, à Pépin. - Autre orgue existant dans la cathédrale d’Aix-la-Chapelle.- Différents noms des petites orgues, appelées orgues portatives ou orgues positives. - Orgue portatif, renfermant une ou plusieurs rangées de tuyaux. - Orgue positif, premier instrument introduit dans nos églises. - Orgues hydrauliques mises en jeu par le moyen de l’eau. - Soufflerie, partie principale dont on s’occupa d’abord. - Tuyaux classiques en diverses matières. - Disparition des petites orgues portatives, à mesure de l’usage général des grandes orgues. - Perfectionnement de l’orgue dès le quinzième siècle. - Essais multipliés pour remédier aux défauts reprochés à l’orgue. - Orgue expressif inventé par Claude Perrault. - Idem par Schrœter. - Piano organisé construit par André Stein,. - Innombrables essais de Sébastien Erard appliqués à un orgue construit pour Marie-Antoinette.......................192
CHAPITRE VIII.
INSTUMENTS A CORDES. - Adoption de trois familles pour les instruments à cordes. - Instruments à cordes pincées ou grattées. - Monocorde, instrument à une corde, dont l’ancienneté sE perd dans la nuit des temps. - La lyre ancienne.- Mercure, d’après Diodore, inventeur de cet instrument. - Grande estime de la lyre chez les Grecs. - Cythare, variété de la lyre. - Psaltérion, tantôt carré, tantôt triangulaire, comme l’était quelquefois la cythare. - Composition du nable et de la sambuque. - Diverses modifications, au moyen âge, subie par le psaltérion antique. - Nombre de cordes, aussi variable que la grandeur du psaltérion. - Peu estimé, d’après Prætorius, au seizième siècle. - Joueurs de psaltérion musiciens du roi. - Le psaltérion reprend sa forme primitive. - Harpe, instrumentale de la plus haute antiquité. - Harpe égyptienne au Musée de Paris. - Importation. de la harpe chez les Grecs. - Usage très-commun, au moyen âge, de la harpe en France. Harpe à trois rangées de cordes imaginée par Luc-Antoine Eustache, chambrier du pape Paul V. - Rote, instrument participant de la harpe et du psaltérion. - Espèce de petite rote nommée, en Italie, arpanetta. - Luth, instrument très-ancien en Egypte. - Mandore, petit luth ou dessous de luth. - Ressemblance de la mandoline avec le luth, quant à la forme du corps sonore. - Théorbe, sorte de grand luth. - Divers noms de la guitare. - Ressemblance du cistre ou cithre avec le luth et la guitare. - Pandore, espèce de luth à dos plat. - Table de résonnance composant le clavecin. - Substitution, en 1758, par Richard, facteur à Paris, de petits morceaux de cuir à la plume faisant résonner les cordes du clavecin. – Clavecin, longtemps le roi des instruments à touche - Distinction entre le clavecin angélique et le clavecin à queue. - Impossibilité de nuancer les sons, grand défaut du clavecin. - Instruments à cordes frappées. Remplacement du chevalet mobile du monocorde par un léger marteau. - Il sert à calculer les quantités et les proportions de l’échelle musicale.- Clavier, son origine. - Tvmpanum, espèce de, monocorde. - Idée du piano conçue, en 1717, par Gottlob Schrœter. - Système des marteaux adopté par les imitateurs de Schrœter. - Substitution, par Bartolomeo Cristofali, des marteaux aux sautereaux du clavecin. Godefroid Silbermann, un des premiers constructeurs réguliers de pianos. - Application d’un système de marteau au clavecin. -Impossibilité de signaler tous les changements subits par le piano. - Clavecin supplanté par le piano après un long combat. - Fabrication de pianos carrés par Zumpe. - Guerre acharnée au piano en France et en Angleterre. - Petits pianos fabriqués par Erard frères. - Nouvelles améliorations introduites par lesdits frères. -, pianos carrés sortis de leurs mains. - Anecdote de M. Fétis, relative à Mozart. - Essais tentés pour obtenir un meilleur son dans les pianos. - Instruments à cordes frôlées et frottées. - Idée de tendre une corde sur un corps sonore et celle de taire vibrer cette corde, chose naturelle à l’homme. - Monocorde, type primitif de tous les instruments à cordes. - Description d’un instrument appelé tympanischiza. - Bedon, sorte de trompette marine. - Harpe d’Eole, seul instrument produisant des sons sans le secours d’un joueur ou d’un mécanisme. - Antiquité de la vielle. - Perfectionnements subis par la vielle. - Faits intéressants pour l’histoire de la vielle, puisés dans les sculptures des monuments anciens. - Connaissance de la vielle par les anciens. - Goût de la vielle importé d’Italie. - Vielle, dans le principe, espèce de guitare. - Emploi sous saint Louis, de la vielle dans toutes les réunions. - Vielle, instrument du comte Thibaut peur accompagner les vers adressés à la reine Blanche. - Long usage de la vielle. - Ménestreux, sans indication de leur genre d’instrument, titre de ceux qui jouaient de la vielle. - Emploi de la vielle, vers le quatorzième siècle, par les aveugles et les pauvres pour gagner leur vie. - Vielle, instrument de l’indigence, d’abord négligé par la court. - Vielleux composant le corps de musique et assistant au cortège de François 1er à son entrée dans Paris. - Commencement du dix-septième siècle défavorable à la vielle. - Lenteur de la vielle dans l’exécution. - Vielle devenant l’instrument de la cour. - Vielle, en 1701, pareille aux anciennes vielles de Normandie. - Exécution de la musique de la vielle changée, pour la première fois, par Denguy. - Sol d’en haut changé à cet instrument par Douvet. - Famille spéciale pour les instruments à cordes, à manche et à archet .- Recherches historiques de M. Fétis sur les instruments à archet. - Opinions de MM. Kastner et Fétis sur l’origine de ces instruments. - Crouht, premier instrument à archet. - Deux sortes de crouth appartenant à des époques différentes. - Description des crouth par M. Fétis, - Chevalet du crouth décrit par Ed. Jones. - Rapport du crouth avec les violes de grande dimension. – Lyra, instrument à archet. - Dissemblance de la lyre avec la lyre ancienne. - Embarras causé par le défaut de déterminations génériques. - Vielle ou viole, même signification que les mots viella et viola. - Remplacement définitif de la vielle par la viole. – Rubèbe, instrument à deux cordes accordées en quinte. - Rebec, instrument plus grave que la vielle. - Rubèbe et rebec, deux variétés de la même espèce. Forme variable du rebec. - Rabbel ou arrabel, violon commun. - Famille fort nombreuse de la viole. - Dessus de viole, chef de famille du violon moderne. - Tètes sculptées mises à l’extrémité du manche d’un grand nombre d’instruments. - Mention de la gigue dans les écrits des vieux poëtes. - Opinion différente des auteurs à l’égard de la gigue. - Vielles ou violes aperçues sur les monuments à la fin du onzième siècle. - Violes à cinq cordes sur les monuments du treizième siècle. - Violes ou vielles avec ou sans chevalets. - Remplacement des dépressions d’une courbe. sur les côtés d’un instrument, par des échancrures. - Cases imaginées sur le manche des instruments à cause de l’inhabileté des exécutants. - Suspension à l’épaule droite, au moyen d’un ruban, de la viole d’épaule. - Son agréable du baryton. - Viola di gamba, timbre moins perçant que celui de la violoncelle.- Viola bastarda, instrument plus long et moins large que la viola di gamba. - Sébastan Bach, inventeur de la viola pomposa. - Son doux et agréable de la vielle d’amour. - Violet anglais, famille de la vielle d’amour. - Sons sourds et dépourvus d’énergie du violone et de l’accordo. - Changements et améliorations subits par les violes ou vielles. - Volume de la viola diminué par un luthier milanais. - Violon, roi des instruments par la beauté, l’harmonie et la flexibilité de ses sons. - Facilité des vibrations à raison de la forme régulière du violon. - Violon composé du manche, du corps ou caisse et des accessoires. - Description de ces objets.- Grande influence du vernis sur les qualités du violon. - Secret des anciens luthiers pour fabriquer leur vernis enseveli dans la tombe. - Violon non accordé par quinte par quelques artistes célèbres. - Affaiblissement de la sonorité des instruments à cordes au moyen de sourdines placées sur le chevalet. - Alto, instrument plus grand que le violon. - Violon piccolo, plus en usage. - Quinton, instrument plus ramassé de forme que le violon ordinaire. - Introduction du violoncelle à l’orchestre de l’Opéra, par Battistini. - Contre-basse, longtemps le plus grand des violons. - Deux espèces de contrebasse. - Apparition de cet instrument, en 1700, à l’orchestre de l’Opéra . -Contrebasse à quatre cordes préférable à l’autre. -.Essais infructueux pour changer la forme du violon. - Lutte des anciennes violes contre la famille des violons.
CHAPITRE IX.
INSTRUMENTS A PERCUSSION. - Percussion premier moyen employé par l’homme pour produire un son, un bruit. - Un seul son rendu par les instruments à percussion. - Division des instruments à percussion en deux familles. - Instruments à percussion bruyants. Tambour placé au premier rang. - Le dada de l’écrivain, archéologue ou Musicologue. - Tambour, chez les Egyptiens, employé dans le sacerdoce et dans la guerre. - Description du tambour égyptien. - Ressemblance d’un autre tambour égyptien avec le nôtre. - Connaissance du tambour par les peuples les plus anciens. - Tympanum aigu ou petit tambour, instrument de percussion en usage chez les Egyptiens, les Hébreux et les Grecs. - Antiquité du tambour à main. - Modèles ou types différents des tambours. – Darabooka, petit tambour encore en usage en Egypte. - Feuilles de parchemin composant cet instrument. Tambour, caisse, bedon instrument de bois de forme cylindrique. - Différence du tambour suisse avec le tambour français. - Légère variation de la forme du tambour. - Son clair et brillant de la caisse claire faite, avec le laiton. - Corps cylindrique de bois de la caisse roulante. - Grosse caisse ou grand tambour, en usage dans la musique militaire. - Deux espèces de tambourin. - Description du tambour de basque. - Haute antiquité des timbales. - Incertitude sur le son musical des timbales. - Coutume des rois de Perse d’entendre les timbales durant leur repas. - Petite timbale à l’usage des seigneurs Migréniens. - Usage des timbales dans tout l’Orient. - Timbale, instrument de rigueur dans les mariages mahométans. - Introduction des timbales en Europe par les Sarrasins. - Premier emploi des timbales en Europe comme instrument guerrier. Envoi d’une ambassade en France par Ladislas, roi de Pologne. Emploi des timbales comme instrument d’honneur. - Adoption du tambour par l’infanterie et des timbales par la cavalerie. - Timbales d’argent à un régiment qui se distinguait. - Timbales et timbaliers en grand honneur à la cour et à l’armée. - Grande importance de l’art du timbalier. - Instruments à percussion sonores. - Sons harmoniques de l’harmonica. - Claquebois ou échelettes genre d’harmonica. - Engouement du public parisien pour cet instrument. - Adoption d’un clavier aux échelettes. - Emploi des cloches dans les orchestres anciens. - Cloche du beffroi appelée cloche banale ou bancloche. - Clochettes ou sonnettes. - Autre instrument composé de plusieurs clochettes de divers calibres. - Grelot, boulette de cuivre ou d’argent. - Usage du sistre dans les premiers temps de l’ère chrétienne. - Discussion sur la forme et l’emploi du sistre. - Invention du sistre. - Forme de cet instrument. - Sistre, désigné à tort comme instrument à cordes. - Invention du sistre par les prêtres. - Longueur du sistre ordinaire. - Sistres des musées de Paris. - Triangle appelé trépie en vieux français. - Ressemblance du triangle égyptien appelé à tort sistre, avec nos triangles modernes. - Introduction du triangle dans les concerts de musique ambulante. - Grand abus du triangle. - Cymbales, sorte d’engin métallique. - Inappréciation du son de cet instrument. - Réunion des frappements des cymbales à ceux de la grosse caisse. - Description des cymbales antique par M. Berlioz.. - Tamtam, originaire des Indes-orientales ou de la Chine. - Cuivre rouge allié à de l’étain pur pour faire des tam-tam. - Modèle du tam-tam forgé en cuivre rouge ou en laiton. - Rebute on guimbarde, instrument sonore des plus anciens. - Simplicité des instruments de percussion joués tantôt d’une main, tantôt des deux mains. - Distinction de deux types différents sous les noms de cymbales et de crotales, aujourd’hui cymbales et castagnettes. - Rencontre des crotales bombées en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne. - Affection particulière des gamins et des écoliers pour une espèce de castagnettes. - Remplacement des cloches, dans le culte chrétien, par les grandes et petites crécelles - Résonnance du chapeau chinois. - Usage du bacciolo en Espagne..................... 260
CHAPITRE X.
INSTRUMENTS MIXTE. -Réunion de diverses instruments ayant des qualités inhérentes à plusieurs familles. - Grand talent de mécanique dans la construction de ces instruments.- Impuissance des moyens mécaniques destinés à remplacer l’homme. - Construction de l’Amphicordum par un praticien florentin. - Angélique, instrument de la famille des luths. - Anémochorde, instrument à clavier. - Apollon, instrument à vingt cordes. - Archicembalo, clavecin à plusieurs claviers. - Archi-viole, espèce de clavecin. - Archi-viole de lyre, instrument à cordes. - Invention et Construction de la Basse de viole à clavier par Risch. - Invention, en 1680, du Basson à fusée. -- Ressemblance du bissex à la guitare. - Adoption du bonacordo pour les petits doigts des enfants. - Bûche, instrument très-peu connu. - Carillons, même, espèce que les jeux de clocettes. - Celestino, sorte de clavecin. - Ressemblance de l’Harmonicorde ou Chordaulodion avec le piano vertical. - Clavecin à archet, instrument monté de cordes de boyau. - Construction du Clavecin à constant accord. - Imitation de plusieurs instruments à cordes, à vent et à percussion par le clavecin acoustique et le Clavecin harmonique. - Invention du Clavecin à double résonnance. - Invention, au milieu du dix-huitième siècle, du clavecin à marteaux. - Clavecin à touches brisées construit par Bonis. - Construction du Clavecin diviseur vers le milieu du seizième siècle. - Clavecin électrique, carillon avec un clavier correspondant à un timbre particulier. - Construction du Clavecin-luth à la fin du dix-huitième siècle. - Clavecin-orchestre imitant un grand nombre d’instruments. - Invention du clavecin organisé par Delitz. - Clavecin parfait accord. - Instrument ayant le même but, construit par Trasuntino. - Autre clavecin parfait accord construit par Goermans. - Clavecin royal. - Clavecin transpositeur imaginé et construit par un prêtre napolitain. - Clavecin-vielle inventé par un facteur de pianos. - Clavicitherium, instrument à clavier. clavi-mandore. - Cimbalo ou Nicordo, instrument à cordes. - Cloche, instrument de métal pour annoncer les cérémonies du culte divin. – Clochettes, carillon à clavier en forme de piano. - Consonnante, instrument participant du clavier et de la harpe inventé par Clagget. - Cristallocord, espèce de clavecin. – Denis d’or imitant tous les instruments à cordes et à vent. – Echomètre déterminant avec précision la durée des mesures et des temps. - Epinette à archet inventée par un Orléanais. - Epinette à marteaux. - Réunion de deux violons dans l’Epinette à orchestre. - Construction de l’Epinette expressive par Berger. - Euphone, espèce d’harmonica à frottement. - Flûte harmonique. - Flûtes octovantes inventées par Pompenius. - Guitare a clavier imaginée par Bachmann. - Guitare-écho. -Précision remarquable de l’Harmonica a clavier construit par Nicolaï. - Invention de l’Harmonica météorologique. - Imitation de la voix humaine par l’Harmonica virginal. - Harmonicon, même espèce que l’harmonica. - Harpe à clavier imaginée par Berger. - Luth-clavecin. - Lyre allemande, plus en usage. - Ressemblance de la Lyre à bras avec la viole de ténor à sept cordes. - Main harmonique imaginée par Guido. - Matraca, énorme crécelle. - Mélodica, instrument à clavier. - Mélographe, machine retraçant sur le papier les inspirations du compositeur. - Idée d’un moyen pour retracer sur le papier ce qui s’exécutait sur le piano. - Réclamation de la priorité de cette idée par Freed. - Autre mélographe inventé par Engramelle. - Construction d’un appareil analogue par Merlin. - Publication d’un mémoire pour retracer les compositions des improvisateurs. – Merlin. - instrument pour siffler les merles et les bouvreuils. - Métromètre servant à battre la mesure et les temps de tous les airs. - microscome musical mettant les instruments à cordes à l’abri des variations de l’air. - Octéophone, donnant aux sons plus ou moins d’intensité. - Oiseaux mélomanes imaginés et construits par Fritz. - Orchestrion construit à la fin du dix-huitième siècle. - Achèvement de l’organo. - Exécution de trois genres de musique par l’Archi-Organo. - Organo-chordon construit comme le précédent. - Construction de l’Orgue métalique. - Orphéon monté avec des cordes en boyau. - Orchéoron, famille des luths. - Panharmonico mathématique inventé par Bulyowski. Pavillon chinois, instrument à percussion. - Pentecontachordon imaginé au commencement du dix-septième siècle. - Piano à clavier de pédale construit par Bellmann. - Construction du Piano double par Hofmann. - Piano à double clavier imaginé et construit par Buhler. - Piano mécanique produisant deux cent cinquante variétés de sonorité. - Poly-toni-claucordum, même genre que la mélodica. - Rhythomètre indiquant la division des temps de la musique. - Serinette, très-petit orgue, servant surtout à l’éducation musicale des serins. Indication du temps dans la musique par le Sonomètre. - Même résultat obtenu par Harisson au moyen d’un monocorde, - Deux lettres de Davaux sur un nouvel instrument. - Description d’un nouveau chronomètre par Burja. - Production, par Duclos, d’un instrument ayant le même but. - Invention de la Sourdine par Lebrun. - Stahlspiells, instrument inventé en 1780. - Téliochorde imaginé par Clagget. - Téorbe-clavecin, instrument à clavier. - Xylorganon ou xitarganon, espèce de claquebois. - Moyens plus ou moins ingénieux de tous ces instruments.................284
INDEX des principaux ouvrages consultés, et conclusion de la première partie.......... 301